Table des matières
-
Établissement d’un programme
Objectifs - Établissement d'un programme
- Présenter un aperçu des priorités possibles en vue de l’établissement d’un programme.
- Cerner les décisions et les réunions clés des 30 premiers jours.
Établissement d’un programme
Le gouvernement a établi un programme ambitieux pour faire progresser le Canada qui s’appuie sur une vision de croissance inclusive et d’avenir plus propre et plus écologique
Il est possible de réaliser d’importants progrès par rapport aux engagements en matière d’agriculture et d’agroalimentaire au cours des 18 prochains mois, mais pour y parvenir nous devons :
- établir un plan ambitieux pour faire progresser les initiatives en tenant compte des réalités du secteur agricole et en collaborant étroitement avec nos collègues ministériels;
- établir de solides relations avec les intervenants sectoriels et tenir des consultations avec ces derniers, incluant les groupes sous-représentés et les champions de l’agroclimat;
- trouver un terrain d’entente avec nos homologues provinciaux et territoriaux (PT) en vue de parvenir à une entente dans les domaines de compétence partagée;
- tirer parti de nos forces, notamment de la capacité scientifique et de la souplesse des programmes, pour positionner stratégiquement AAC et pour intervenir rapidement face aux problèmes urgents au fur et à mesure qu’ils surviennent
Principaux engagements d’agriculture et agroalimentaire canada
Une bonne capacité d’adaptation est nécessaire à une mise en œuvre réussie
L’envergure des initiatives dépend des programmes et des décisions budgétaires et du Cabinet.
Les problèmes et événements urgents pourraient entraîner des appels d’intervention stratégique immédiate, tels que :
- la détection de peste porcine africaine au Canada et/ou dans la zone continentale des États-Unis;
- la persistance des conditions de sécheresse durant la période des semis de 2022;
- des avancées concernant des questions persistantes liées au commerce international, dont les décisions des groupes spéciaux de règlements des différends;
- Crises ou autres événements menant à l’aggravation de problèmes existants dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, comme la fermeture des frontières.
Les « mégadonnées » transforment rapidement les pratiques agricoles partout dans le monde. Pour que le Canada demeure aux premières lignes de cette tendance, le Ministère devra appliquer des principes et des pratiques similaires à ses activités, afin d’exercer son leadership.
Priorités possibles du cabinet pour un nouveau mandat
████████████████████████████████████████████████
- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████
- █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ████████████████████████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- █████████████████████████████████████████
█████████████████████████████
- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ████████████████████████████████████████████████████████
- ██████████████████████████████████████████████████████████████████
- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████
- ███████████████████████████████████████████
- ████████████████████████████████████████
- ██████████
- ████████████████████
- ██████████████████████████████████████████████████████████
- ██████████████████████
Priorités des 30 premiers jours
1. Donner le ton
- Le Ministère proposera une série de réunions préliminaires avec ses partenaires principaux soit :
- homologues provinciaux et territoriaux;
- principaux intervenants de l’industrie;
- homologues internationaux;
- chefs agricole des organismes du portefeuille.
Des visites régionales hâtives pourraient permettre de consulter directement les producteurs :
- P. ex. Visiter l’ouest du Canada pour évaluer les répercussions de la récente sécheresse et les programmes d’Agri-relance financés par les gouvernements fédéral et provinciaux.
███████████████████████████████████████
- ███████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
2. Premières décisions
Approche liée à la Conférence annuelle FPT et à l’énoncé de politique du PCS
- Provisoirement fixée du 8 au 10 novembre à Guelph
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Affaires courantes du gouvernement et du Ministère :
- Budget supplémentaire des dépenses de 2020-2021, délégations, nominations, prochaines étapes en matière de programmes, affaires réglementaires liées à l’ACIA
3. Séances d’information sur des dossiers clés
Votre trousse d’information de transition comprend des renseignements préliminaires sur :
- les dossiers clés et les priorités;
- le Ministère et notre travail;
- la situation du secteur agricole et agroalimentaire;
- les responsabilités ministérielles (p. ex., nominations).
Le Ministère a préparé un calendrier proposé des séances d’information sur les dossiers et les décisions clés pour vous aider à faire progresser le programme au cours des prochains mois.
Autres questions
Les intervenants du Ministère sont impatients de vous accueillir, ainsi que votre cabinet, et ont préparé d’autre matériel pour vous aider :
- Orientation en matière d’administration et de ressources humaines pour vous aider à aménager votre bureau, à obtenir de l’équipement et des outils et à intégrer de nouveaux employés
-
Messages clés
Sécheresse
Question - Sécheresse
- La sécheresse qui a sévi dans l’Ouest du Canada cet été a entraîné d’importantes pénuries d’eau et d’aliments du bétail pour les grands éleveurs.
- En date du 14 septembre 2021, Statistique Canada prévoit des pertes de rendement pour les cultures de céréales et oléagineux de 35 à 46 % par rapport à 2020.
- Il pourrait y avoir une réduction de 5 à 10 % des troupeaux de bovins, et jusqu’à 50 % de réduction du rendement en foin.
Situation actuelle - Sécheresse
- Jusqu’à 825 millions de dollars de financement conjoint fédéral et provincial seront versés dans le cadre des accords d’Agri‑relance conclus avec les cinq provinces touchées.
- Ces programmes aideront les producteurs à couvrir les frais exceptionnels liés à la sécheresse, notamment à assurer l’approvisionnement en eau et en nourriture de leur bétail.
- Le Programme de report de l’impôt pour les éleveurs du gouvernement fédéral a aussi été annoncé; il permettra aux éleveurs de bétail frappés par la sécheresse de reporter des revenus découlant de la vente forcée d’animaux reproducteurs afin de minimiser l’impôt sur le revenu.
Messages clés - Sécheresse
Les montants précis par province seront mis à jour une fois que toutes les ententes de contribution auront été signées.
- Nous aidons nos familles agricoles à relever les défis auxquels elles font face aujourd’hui et à bâtir un avenir durable.
- Nous avons travaillé avec la Colombie‑Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario pour fournir jusqu’à 825 millions de dollars en financement fédéral et provincial à frais partagés afin d’aider les éleveurs de bétail à couvrir les frais supplémentaires découlant de la sécheresse et des feux de forêt.
- Nous avons aussi travaillé avec les provinces pour permettre aux producteurs agricoles d’avoir un accès précoce à 75 % de leurs paiements d’Agri‑stabilité de 2021, au lieu de 50 %.
- Nous avons pris des dispositions pour que les producteurs des régions touchées par la sécheresse en Colombie?Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario qui ont été forcés de vendre leur bétail en raison d'une pénurie d'aliments du bétail puissent reporter à l'année prochaine l'impôt sur les revenus de ces ventes.
- Nous avons appuyé les provinces des Prairies pour qu'elles apportent des changements immédiats au programme à frais partagés Agri-protection afin d'aider à couvrir les coûts liés au foin, aux aliments du bétail et au transport et ainsi accroître les cultures dont peuvent disposer les éleveurs de bétail en ces temps difficiles.
Hay west
Question - Hay west
- L’initiative « Hay West » (Foin pour l’Ouest) vise à aider les producteurs agricoles des Prairies à gérer les pénuries de foin causées par la sécheresse.
- Le 12 août 2021, la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) a annoncé son intention de lancer l’initiative Hay West pour répondre aux besoins en foin exprimés par les producteurs agricoles de l’Ouest canadien et pour donner suite au souhait des producteurs de l’Est d’apporter leur aide.
- En date du 17 septembre 2021, la FCA était à la recherche de candidats pour recevoir et fournir du foin.
- De plus, le groupe Mennonite Disaster Service a annoncé un programme pour le transport du foin donné de l’Ontario au Manitoba. Les premiers chargements de ce programme ont commencé pendant la semaine du 13 septembre 2021.
Situation actuelle - Hay west
- De petites cargaisons de foin ont été transportées, avec un financement par des contributions privées (dont 50 000 dollars de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario et les coûts liés au transport de trois conteneurs, financés par le gouvernement de l’Île‑du‑Prince‑Édouard).
- La FCA a d’abord demandé un financement fédéral de 6,2 millions de dollars pour couvrir les coûts liés au transport d’environ 60 000 balles de foin à travers le pays (d’est en ouest).
- Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a approuvé un financement d’au plus un million de dollars pour le projet Hay West 2021 dans le cadre du Programme des priorités stratégiques de l’agriculture canadienne. Cela correspond à la quantité de foin qui, selon la FCA, pouvait être acheminée vers l’ouest au moment de sa demande et devrait permettre de répondre à la demande au cours des semaines à venir. Le Ministère s’est engagé à envisager un financement supplémentaire, au besoin.
Messages clés - Hay west
- La sécheresse a durement touché nos producteurs de céréales et nos éleveurs de bétail.
- Nous continuons de collaborer avec les provinces, les producteurs et leurs organismes pour répondre aux besoins criants des producteurs agricoles et grands éleveurs canadiens, qui sont touchés par une grave sécheresse.
- AAC verse jusqu’à un million de dollars pour soutenir l’initiative Hay West 2021 de la FCA.
Accès aux marchés et commerce
Question - Accès aux marchés et commerce
Exportation de graines de canola vers la Chine - Accès aux marchés et commerce
- La Chine n’a pas rétabli l’admissibilité de deux entreprises canadiennes (Richardson et Viterra) à exporter des graines de canola vers la Chine. Cette situation persiste depuis mars 2019 en raison de la présumée détection de ravageurs de quarantaine préoccupants.
Mesures liées à la COVID‑19 de la Chine - Accès aux marchés et commerce
- À la suite des mesures prises par la Chine à l’égard des produits alimentaires importés en raison des inquiétudes liées à la pandémie de COVID‑19, dix établissements canadiens de transformation de la viande ont été suspendus.
Situation actuelle - Accès aux marchés et commerce
Exportation de graines de canola vers la Chine - Situation actuelle - Accès aux marchés et commerce
- En raison de l’absence continue de progrès dans la levée de la suspension de deux entreprises canadiennes de canola, le Canada a demandé la mise sur pied d’un groupe spécial, ce que l’Organisation mondiale du commerce a accordé lors de la réunion de l’Organe de règlement des différends de juillet 2021.
Mesures liées à la COVID‑19 de la Chine - Situation actuelle - Accès aux marchés et commerce
- Le Canada consulte la Chine pour lever la suspension des établissements.
- À l’instar d’autres partenaires commerciaux, le Canada est d’avis qu’il n’existe aucune preuve que les aliments ou les emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission probable de la COVID‑19.
Messages clés - Accès aux marchés et commerce
Commerce général - Accès aux marchés et commerce
- Notre gouvernement est déterminé à aider les entreprises et les entrepreneurs canadiens à tirer parti des nouvelles possibilités qu’offrent nos récents accords commerciaux.
- L’année 2020 a été une année record pour les exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires et produits de la mer : près de 74 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 10 %.
- Le Canada continue de promouvoir le respect de normes et de règles commerciales internationales qui sont transparentes et fondées sur la science.
Exportation de graines de canola vers la Chine - Commerce général - Accès aux marchés et commerce
- Le Canada est convaincu que ses exportations de graines de canola et d’autres produits répondent aux exigences chinoises en matière d’importation.
- Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec la Chine pour assurer un commerce prévisible et stable.
Mesures liées à la COVID‑19 de la Chine - Commerce général - Accès aux marchés et commerce
- À l’instar d’autres partenaires, le Canada est d’avis qu’il n’existe actuellement aucune preuve scientifique que les aliments ou les emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission probable de la COVID‑19.
- Le Canada consulte la Chine pour lever la suspension des établissements.
Gestion des risques de l’entreprise
Question - Gestion des risques de l'entreprise
- Les programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) sont un ensemble d’outils qui visent à aider financièrement les producteurs en cas de perte de revenus et de production.
- Ils fournissent en moyenne environ 1,6 milliard de dollars par année pour aider les producteurs, et le gouvernement fédéral verse 60 % de cette aide financière. En raison de la vague de sécheresse extrême cet été, on s’attend à ce que les paiements au titre des programmes de GRE augmentent de façon importante pour l'année de production 2021. Cela comprend un financement conjoint fédéral‑provincial d’au plus 825 millions de dollars en paiements d’Agri-relance pour les éleveurs de bétail dans les provinces touchées ainsi que des paiements à grande échelle d’Agri-protection pour les pertes de récoltes.
(Veuillez noter que les estimations pour 2021 sont en cours d’élaboration, mais on s’attend à ce que les paiements au titre d’Agri‑protection et d’Agri‑stabilité soient plus élevés.)
Situation actuelle - Gestion des risques de l'entreprise
- Des évaluations récentes ont permis de conclure que l’ensemble de programmes fonctionne raisonnablement bien, mais que des préoccupations subsistent en ce qui concerne la complexité, l’équité, la prévisibilité et la capacité de faire face adéquatement à l’évolution des risques auxquels le secteur est confronté.
- En 2021, la limite de la marge de référence a été supprimée du programme Agri‑stabilité, ce qui pourrait faire augmenter les paiements versés aux producteurs agricoles d’environ 95 millions de dollars. De plus, les paiements provisoires pour 2021 sont passés de 50 à 75 % dans de nombreuses administrations.
- L’offre fédérale de faire passer le taux d’indemnisation d’Agri-stabilité de 70 à 80 % est toujours en vigueur, mais le soutien des provinces et des territoires à ce jour est insuffisant pour mettre en œuvre cette amélioration.
- À l’heure actuelle, ces programmes ne tiennent pas directement compte des considérations relatives à la gestion des risques climatiques, bien qu’ils constituent un soutien essentiel pour la reprise des activités à la suite de catastrophes comme les sécheresses et les inondations.
- Les programmes de GRE demeurent une priorité tant pour les producteurs que pour les provinces et les territoires, et AAC continue d’évaluer les moyens d’améliorer leur fonctionnement.
Messages clés - Gestion des risques de l'entreprise
- Nos programmes de GRE aident les producteurs à protéger leur entreprise contre les pertes de revenus et de production et à gérer les risques qui menacent la viabilité de leur exploitation agricole.
- Nous nous réjouissons de poursuivre notre travail avec les provinces, les territoires et les producteurs agricoles, y compris les Autochtones et les jeunes agriculteurs, pour aider le secteur à mieux gérer les risques auxquels il est confronté, y compris les risques climatiques.
- Avec l’appui des provinces, nous avons supprimé la limite de la marge de référence d’Agri-stabilité, ce qui pourrait permettre de verser jusqu’à 95 millions de dollars supplémentaires aux producteurs agricoles à l’échelle nationale.
Travailleurs étrangers temporaires
Question - Travailleurs étrangers temporaires
- Au cours d’une année type, environ 70 000 travailleurs étrangers temporaires (TET) travaillent dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Le Programme des TET est administré conjointement par Emploi et Développement social Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
- Compte tenu des pénuries chroniques de main-d’œuvre dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, les TET ont été, et continueront d’être, une source essentielle de main-d’œuvre, en particulier dans les secteurs de l’horticulture et de la transformation.
- Les partenaires fédéraux ont collaboré étroitement tout au long de la pandémie pour assurer l’arrivée continue des TET, tout en prenant des mesures pour améliorer la sécurité des travailleurs dans les exploitations agricoles et les usines de transformation des aliments.
- AAC a élaboré des programmes d’urgence de durée limitée pour compenser certains coûts que les employeurs de TET ont dû engager en raison de la pandémie.
Situation actuelle - Travailleurs étrangers temporaires
- Malgré une baisse de 15 % des arrivées de TET en 2020, les arrivées pour 2021 sont en voie de dépasser les tendances antérieures à la pandémie de COVID‑19.
- Compte tenu du rôle essentiel que jouent les TET dans le système agricole et agroalimentaire, des politiques temporaires ont été mises en place pour faciliter l’arrivée rapide des TET qui participent à la production alimentaire, notamment en ce qui concerne le traitement prioritaire des demandes.
- Depuis juillet 2021, les TET du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire qui ont été entièrement vaccinés avec un vaccin approuvé n’ont plus besoin d’être mis en quarantaine ou de subir des tests après leur arrivée.
- Les taux de vaccination dans les principaux pays sources restent faibles, mais de nombreux TET travaillant au Canada pendant la saison 2021 se sont vu proposer la vaccination, soit parce qu’ils étaient admissibles en vertu des cadres provinciaux, soit grâce à des efforts ciblés des provinces et des unités sanitaires locales.
- Les voyageurs non vaccinés doivent encore demeurer en quarantaine pendant 14 jours après leur arrivée au Canada.
- AAC a cessé d’accepter les demandes le 31 août 2021 pour ses programmes d’urgence visant à compenser les coûts liés à l’isolement obligatoire des TET.
- Les investissements fédéraux (par l’entremise d’EDSC et d’IRCC) renforcent le Programme des TET et aident à protéger la santé et la sécurité des TET, y compris par l’établissement d’exigences minimales pour les logements fournis par les employeurs.
Messages clés - Travailleurs étrangers temporaires
- Les travailleurs canadiens et étrangers sont essentiels à la production d’aliments salubres et fiables au pays.
- Nous continuerons de travailler fort pour favoriser l’arrivée sécuritaire des TET en temps opportun.
- De plus, le gouvernement continuera de travailler avec l’industrie sur une stratégie visant à les aider à surmonter les défis permanents en matière de main‑d’œuvre ainsi qu’à renforcer le Programme des TET pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
- Le Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires, doté de 142 millions de dollars, a été mis en place pour soutenir temporairement les employeurs pendant la période la plus aiguë de la pandémie de COVID‑19.
Environnement et changements climatiques
Question - Environnement et changements climatiques
- Le secteur agricole a réalisé des progrès considérables en matière de durabilité à la ferme, permettant ainsi d’augmenter la production tout en maintenant les émissions relativement stables.
- Toutefois, les émissions totales d’origine agricole ne diminuent pas et le taux de piégeage du carbone dans le sol ralentit.
- Les attentes accrues des partenaires commerciaux, des intervenants et des consommateurs en matière de durabilité mettent en évidence l’importance de la lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité, de la gestion de l’eau et du renforcement de la résilience des systèmes agricoles et alimentaires.
- Il faudra déployer des efforts supplémentaires pour contribuer à l’atteinte des objectifs du gouvernement fédéral, soit réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 et atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
Situation actuelle - Environnement et changements climatiques
- Le gouvernement fédéral a récemment annoncé des investissements de plus de 550 millions de dollars pour soutenir la mise au point et l’adoption de technologies propres et de pratiques de gestion bénéfiques.
- Des programmes ont récemment été lancés pour aider à résoudre les problèmes environnementaux, notamment : le Programme des technologies propres en agriculture (165,7 millions de dollars) pour soutenir la mise au point et l’adoption de technologies propres, le Programme des laboratoires vivants (185 millions de dollars) des Solutions agricoles pour le climat (SAC) pour favoriser le piégeage du carbone et la réduction des émissions de GES et le Fonds d’action à la ferme pour le climat des SAC (200 millions de dollars) pour soutenir l’adoption immédiate à la ferme de pratiques de gestion bénéfiques (gestion de l’azote, pâturage en rotation et cultures de couverture).
- Ces nouveaux programmes fédéraux complètent les travaux qui sont menés actuellement en collaboration avec les provinces et les territoires dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA).
- La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC, COP 26) aura lieu du 31 octobre au 12 novembre 2021. Diverses initiatives multipartites qui présentent un intérêt pour le secteur agricole seront lancées à la COP 26, dont le Programme d’action mondial pour l’innovation dans l’agriculture (dirigé par le Royaume‑Uni), l’Agriculture Innovation Mission for Climate (dirigée par les États-Unis et les Émirats arabes unis) et l’Engagement mondial concernant le méthane (dirigé par les États‑Unis et l’Union européenne).
Messages clés - Environnement et changements climatiques
- Un environnement sain va de pair avec un secteur agricole durable qui continue d’offrir de bons emplois et des aliments sains et salubres aux Canadiens.
- Les producteurs agricoles et les transformateurs d’aliments du Canada travaillent fort et utilisent depuis longtemps de saines pratiques de gestion, l’innovation et de nouvelles technologies pour réduire les GES, tout en augmentant la productivité, l’efficacité et les revenus.
- Nous travaillons d’arrache‑pied pour aider les producteurs agricoles à élaborer et à adopter des pratiques de gestion agricole bénéfiques qui favorisent la durabilité et l’utilisation de technologies propres à la ferme, grâce à des investissements de 550 millions de dollars.
- Voici des exemples de programmes conçus pour aider à améliorer la durabilité du secteur agricole : le Programme des technologies propres en agriculture (165,7 millions de dollars), le programme des Laboratoires vivants dans le cadre des Solutions agricoles pour le climat (185 millions de dollars) et le Fonds d’action à la ferme pour le climat (200 millions de dollars).
Peste porcine africaine
Question - Peste porcine africaine
- La peste porcine africaine (PPA) est une maladie contagieuse et mortelle pour les porcs (non transmissible aux humains) qui se répand en Asie, en Afrique, dans certaines parties de l’Europe et, plus récemment, en République dominicaine et à Haïti.
- Aucun cas de PPA n’a encore été découvert au Canada, mais un seul cas positif de cette maladie au pays nécessiterait l’arrêt immédiat de toutes les exportations de porc et de porcs vivants (70 % de tout le porc et des produits du porc du Canada), dont la valeur a été évaluée à 5,48 milliards de dollars selon les chiffres d’exportation de 2020.
- Cela créerait un excédent intérieur qui aurait des conséquences importantes pour les producteurs et les transformateurs de porc et entraînerait des problèmes liés au bien‑être des animaux, à la santé mentale des producteurs agricoles, à l’environnement et aux finances.
Situation actuelle - Peste porcine africaine
- L’Agence des services frontaliers du Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments ont pris des mesures concrètes pour empêcher la propagation de la PPA des pays touchés vers le Canada.
- La collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux et l’industrie a mené à l’élaboration du Plan d’action pancanadien pour lutter contre la peste porcine africaine, qui définit quatre domaines d’intervention : la prévention et le renforcement de la biosécurité, la planification de la préparation, l’assurance de la continuité des activités et la communication coordonnée des risques.
- AAC a investi près d’un million de dollars au cours de la dernière année pour améliorer l’état de préparation de l’industrie, et le Ministère continue de travailler avec l’industrie pour déterminer les besoins supplémentaires.
- AAC collabore avec les provinces et l’industrie pour élaborer des plans visant à soutenir le secteur au cas où la PPA arriverait au Canada.
Messages clés - Peste porcine africaine
- La PPA aurait des répercussions terribles sur l’ensemble de l’industrie porcine canadienne, des familles agricoles aux transformateurs.
- Notre gouvernement est solidaire de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en porc.
- En cas d’éclosion, nous agirons rapidement pour détecter, retracer et éradiquer la PPA tout en veillant à ce que le secteur dispose du soutien dont il a besoin.
- Nous travaillons d’arrache‑pied avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et nos partenaires de l’industrie pour prévenir la PPA et nous y préparer.
- Cela comprend le Plan d’action pancanadien pour lutter contre la PPA, qui jette les bases pour une intervention rapide et coordonnée en vue de circonscrire une éclosion et minimiser les dommages.
Indemnisation des producteurs soumis à la gestion de l’offre
Question - Indemnisation des producteurs soumis à la gestion de l'offre
- Les engagements en matière d’accès aux marchés pris dans le cadre des récents accords commerciaux ont une incidence directe sur la croissance des revenus des producteurs et des transformateurs de produits soumis à la gestion de l'offre (c'est-à-dire les produits laitiers, la volaille et les œufs), car les accords réduisent leurs parts de marché et, par conséquent, leur potentiel de revenu global.
- En réponse, le gouvernement du Canada s’est engagé à indemniser les secteurs soumis à la gestion de l’offre pour les répercussions de ces accords commerciaux.
- Pendant les élections de 2021, le gouvernement s’est engagé à établir l’indemnisation relative à l’Accord Canada–États‑Unis–Mexique (ACEUM) au cours de la première année.
Différend sur les contingents tarifaires pour les produits laitiers dans le cadre de l’ACEUM
- Dans l’ACEUM, le Canada a accepté d’accorder aux États‑Unis un accès supplémentaire au marché des produits laitiers sous la forme de contingents tarifaires.
- Les États‑Unis contestent les pratiques d’administration des contingents tarifaires du Canada pour les produits laitiers au moyen du processus de règlement des différends de l’ACEUM.
Situation actuelle - Indemnisation des producteurs soumis à la gestion de l'offre
- Tous les programmes d’indemnisation de l’Accord économique et commercial global (AECG) et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) ont été lancés, à l’exception du Fonds d’investissement dans la transformation (FIT), qui a été annoncé dans le budget de 2021.
- La mobilisation de l’industrie à l’égard du FIT a été mise en attente en raison des élections. Une mobilisation de l’industrie à l’égard du FIT pourrait aussi avoir lieu cet automne.
- Aucune indemnisation relative à l’ACEUM n’a été annoncée jusqu’à maintenant. AAC a analysé les répercussions de l’ACEUM et continue de mobiliser le secteur à propos des mesures d’indemnisation relatives à cet accord pour orienter les approches en matière de programme.
Contingents tarifaires pour les produits laitiers dans le cadre de l’ACEUM
- En mai dernier, les États‑Unis ont demandé la création d’un groupe spécial de règlement des différends concernant les politiques canadiennes d’administration des contingents tarifaires pour les produits laitiers dans le cadre de l’ACEUM. Le processus de règlement des différends est en cours. L’audience du groupe spécial est prévue pour l’automne 2021 et le différend devrait être réglé en décembre 2021.
Messages clés - Indemnisation des producteurs soumis à la gestion de l'offre
- Nous sommes entièrement solidaires de nos secteurs soumis à la gestion de l’offre, qui soutiennent nos exploitations familiales et favorisent la vitalité de nos régions rurales.
- Nous nous sommes engagés à verser 2,7 milliards de dollars pour indemniser les producteurs de produits laitiers, de volailles et d’œufs admissibles qui ont été touchés par l’AECG et le PTPGP. Nous avons investi des fonds supplémentaires de 100 millions de dollars pour aider les transformateurs laitiers à s’adapter à l’AECG.
- Au cours de la prochaine année, nous travaillerons de concert avec les secteurs soumis à la gestion de l’offre en vue de les indemniser pleinement et équitablement pour les répercussions de l’ACEUM.
Contingents tarifaires pour les produits laitiers dans le cadre de l’ACEUM
- Nous prenons au sérieux nos obligations découlant des accords internationaux, y compris l’accord que nous avons conclu avec les États‑Unis, notre plus proche partenaire commercial.
- Nous sommes convaincus que nos politiques sont entièrement conformes à nos obligations prévues dans l’ACEUM à l’égard des contingents tarifaires et nous défendrons vigoureusement notre position au cours du processus de règlement des différends.
Soutien à l’industrie vinicole
Question - Soutien à l'industrie vinicole
- En avril 2021, le Canada est parvenu à une solution mutuellement acceptable avec l’Australie en ce qui concerne une plainte déposée auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à propos du vin.
- Le gouvernement du Canada a accepté d’abroger l’exonération des droits d’accise fédéraux sur le vin d’ici le 30 juin 2022.
- Les intervenants demandent un soutien pour s’adapter à cette abrogation et pour faire face aux répercussions de la pandémie de COVID‑19.
Situation actuelle - Soutien à l'industrie vinicole
- Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé qu’il verserait un financement de 101 millions de dollars sur deux ans à compter de 2022‑2023 à AAC pour la mise en œuvre d’un programme pour l’industrie vinicole.
- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Messages clés - Soutien à l'industrie vinicole
- L’industrie vinicole canadienne a été une formidable réussite pour le secteur agroalimentaire du Canada au cours des 15 dernières années.
- Dans le cadre du budget de 2021, notre gouvernement a annoncé un financement de 101 millions de dollars sur deux ans pour soutenir l’industrie vinicole canadienne.
- Cet investissement aidera nos établissements vinicoles à s’adapter aux défis actuels et émergents, tout en respectant les obligations commerciales du Canada.
- Le gouvernement continuera de soutenir l’industrie vinicole canadienne et les milliers d’emplois qu’elle offre.
Frais imposés par les détaillants
Question - Frais imposés par les détaillants
- Les frais imposés par les détaillants sont des paiements versés par les fournisseurs aux détaillants en échange de la mise en rayon et de la mise en liste en ligne des produits.
- Les frais imposés par les détaillants sont un problème de longue date pour les transformateurs et les producteurs, tant en ce qui concerne leur niveau que la manière dont ils sont appliqués.
Situation actuelle - Frais imposés par les détaillants
- En novembre 2020, les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture ont créé le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial (FPT) sur les frais imposés par les détaillants.
- Les conclusions du Groupe de travail ayant été publiées en juillet 2021, les ministres ont demandé à l’industrie de diriger un processus visant à élaborer un code de pratique ou de conduite et un cadre pour la résolution des différends.
- AAC et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) appuient les efforts de l’industrie, par l’entremise d’une tierce partie, en vue de dégager un large consensus quant à une proposition concrète visant à améliorer la transparence, la prévisibilité et le respect des principes de probité commerciale. L’industrie devrait informer les ministres au sujet des progrès réalisés d’ici la fin de l’année.
Messages clés - Frais imposés par les détaillants
- Nous dépendons tous de nos producteurs, de nos transformateurs et de nos détaillants pour les aliments que nous consommons.
- Le gouvernement veillera à ce que le Canada ait ce qu’il faut pour que toutes les entreprises prospèrent.
- En juillet dernier, les ministres de l’Agriculture ont demandé à l’industrie de trouver des solutions pour améliorer la transparence, la prévisibilité et le respect des principes de probité commerciale en ce qui a trait aux frais imposés par les détaillants.
- Nous attendons avec impatience une proposition concrète visant à améliorer la transparence, la prévisibilité et le respect des principes de probité commerciale dans notre chaîne d’approvisionnement alimentaire.
Relations fédérales–provinciales–territoriales
Question - Relations fédérales–provinciales–territoriales
- Étant donné que l’agriculture et la diversité régionale de l’agriculture au pays sont des compétences partagées, la collaboration avec les provinces et les territoires est essentielle pour soutenir efficacement le secteur.
- Le cadre actuel du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) prévoit des programmes d’une valeur de 3 milliards de dollars pour les producteurs et les transformateurs sur une période de cinq ans (2019‑2023) dans un large éventail de domaines prioritaires. Le PCA englobe aussi les programmes de GRE, qui fournissent 1,6 milliard de dollars par année en soutien au secteur.
- Les préparatifs sont en cours pour négocier le prochain cadre stratégique, qui succédera au PCA lorsqu’il viendra à échéance en 2023.
Situation actuelle - Relations fédérales–provinciales–territoriales
- On propose que la Conférence annuelle des ministres ait lieu du 8 au 10 novembre à Guelph
- Les provinces et les territoires s'attendent à ce que la conférence comprenne une déclaration stratégique FPT pour le prochain cadre stratégique, que définit une vision et des priorités FPT.
- La déclaration est généralement parachevée deux ans avant l'entrée en vigueur du prochain accord afin de laisser suffisamment de temps pour les négociations avant l'expiration de l'accord actuel du PCA. Les intervenants ont été consultés à l'échelle nationale et provinciale.
- █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Messages clés - Relations fédérales–provinciales–territoriales
- Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont engagés à travailler ensemble pour assurer la réussite et la vitalité du secteur agricole.
- Le PCA et les cadres antérieurs ont fourni un soutien essentiel pour aider le secteur à surmonter les défis, à saisir les débouchés et à stimuler la croissance et la prospérité.
- J'ai hâte de bientôt rencontrer mes collègues provinciaux et territoriaux pour continuer à réaliser les principales priorités du secteur, y compris les priorités relatives au prochain cadre stratégique.
Politique alimentaire
Question - Politique alimentaire
- Le gouvernement du Canada a lancé la Politique alimentaire pour le Canada en 2019. Il s'agit d'une feuille de route qui vise à promouvoir un système alimentaire plus sain et plus durable.
- La vision de la politique est la suivante : que toutes les personnes vivant au Canada puissent avoir accès à une quantité suffisante d'aliments salubres, nutritifs et culturellement diversifiés et que le système alimentaire du Canada soit résilient et novateur, protège notre environnement et soutienne notre économie.
- Malgré les mesures prises par tous les gouvernements, la pandémie de COVID-10 a exacerbé l'insécurité alimentaire; Les intervenants ont demandé au gouvernement de prendre davantage de mesures pour s'attaquer aux causes fondamentales de l'insécurité alimentaire, principalement les conditions sociales et les ressources financières limitées.
Situation actuelle - Politique alimentaire
- Le Fonds des infrastructures alimentaires locales et le Défi de réduction du gaspillage alimentaire ont été lancés dans le cadre de la Politique alimentaire et ont suscité un grand intérêt de la part des intervenants à travers le Canada. Un grand nombre de demandes a été reçu.
- En réponse à l’insécurité alimentaire accrue en raison de la pandémie de COVID‑19, AAC a lancé le Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire en mai 2020 afin de soutenir les banques alimentaires et d’autres initiatives de récupération d’aliments. En date d’août 2021, un financement de 300 millions de dollars a été consacré à cette initiative.
- Un Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies a eu lieu le 23 septembre 2021 et portait sur l’élaboration de voies nationales pour la transformation des systèmes alimentaires. Avant ce sommet, AAC a organisé huit concertations sur les systèmes alimentaires entre avril et juin 2021, dans le cadre desquelles il a consulté un large éventail de spécialistes et d’organismes de partout au Canada pour discuter des difficultés et des possibilités relatives au système alimentaire et déterminer des engagements et des mesures qui permettraient l’établissement d’un système alimentaire plus durable et équitable.
Messages clés - Politique alimentaire
- Notre gouvernement a pour objectif de renforcer notre système alimentaire à chaque étape, de la production et de la transformation durables des aliments à la réduction du gaspillage alimentaire, en passant par une solide infrastructure alimentaire locale.
- Voilà pourquoi nous avons lancé la toute première Politique alimentaire du Canada en 2019.
- Nous voulons que chacun puisse avoir accès aux aliments sains dont il a besoin, dans le respect de sa dignité.
- Dans le prolongement de nos investissements de près de 250 millions de dollars pour améliorer la sécurité alimentaire, le budget de 2021 prévoyait un financement supplémentaire de 140 millions de dollars pour compléter le Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire et le Fonds des infrastructures alimentaires locales pour aider à prévenir la faim, à renforcer la sécurité alimentaire dans nos collectivités et à fournir des aliments nutritifs à un plus grand nombre de Canadiens.
- Pour renforcer la sécurité alimentaire dans le Nord, nous investirons 163,4 millions de dollars sur trois ans pour élargir la portée du programme Nutrition Nord Canada.
Examen de la Loi sur les grains du canada
Question - Examen de la Loi sur les grains du Canada
- À la suite du budget de 2019, AAC a lancé un examen de la Loi sur les grains du Canada (LGC), le cadre législatif pour la réglementation de la qualité et de la manutention des grains au Canada.
- L’examen est soutenu par les intervenants, qui estiment que la LGC est dépassée et doit être modernisée en profondeur.
Situation actuelle - Examen de la Loi sur les grains du Canada
- De vastes consultations des intervenants ont eu lieu au début de l’année 2021, et ils étaient d’avis qu’il était nécessaire de mettre à jour la LGC pour tenir compte des 50 ans d’évolution du secteur.
- Les intervenants attendent une modernisation et des réformes importantes pour répondre aux questions soulevées lors des consultations, mais ils ne s’entendent pas tous en ce qui concerne certains changements précis. Les délais de modernisation dépendront de l’approche choisie, mais les réformes législatives et réglementaires peuvent prendre de deux à trois ans.
Messages clés - Examen de la Loi sur les grains du Canada
- Nous respectons notre engagement d’examiner la LGC en collaboration avec le secteur.
- Notre objectif commun est de moderniser la Loi pour que le Canada demeure concurrentiel sur le marché mondial.
- Nous avons publié un rapport sommaire des consultations, que nous utiliserons pour déterminer la voie à suivre pour la modernisation de la LGC.
Prix des aliments
Question - Prix des aliments
- Pour 2021, le 11e Rapport sur les prix alimentaires canadiens prévoit une hausse de 3 à 5 % des prix des aliments. Cette situation est attribuable à de nombreux facteurs, notamment les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement, la fermeture de restaurants, les feux de forêt en Californie et le « salaire des héros » dans les épiceries.
- Au cours des huit derniers mois, les prix des denrées alimentaires ont moins augmenté que le taux d’inflation global. Les prix à l’échelle de l’économie (mesurés par l’indice des prix à la consommation) étaient 3,8 % plus élevés en août qu’en décembre 2020. Les prix moyens des aliments en août n’étaient que de 2,8 % supérieurs à ceux de décembre 2020.
Situation actuelle - Prix des aliments
- Si les prix moyens des denrées alimentaires ont relativement peu augmenté au cours des huit derniers mois, on observe une plus grande variabilité dans certaines catégories d’aliments. Par exemple, de décembre à août 2021, la moyenne de l’indice des prix à la consommation des fruits frais a augmenté de 1,1 %, tandis que celle des légumes frais a diminué de 4,8 %.
- Selon la dernière Enquête sur les dépenses des ménages de 2019, les Canadiens consacrent environ 9 % du revenu de leur ménage à l’alimentation.
Messages clés - Prix des aliments
- Le gouvernement du Canada s’efforce de faire en sorte que tous les Canadiens aient un accès fiable à des aliments sains.
- Pendant la pandémie, le gouvernement du Canada a soutenu des programmes comme le Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire, le Fonds des infrastructures alimentaires locales et le Programme de récupération d’aliments excédentaires.
- Les consommateurs canadiens ont la chance de disposer d’une abondance de choix alimentaires.
Pesticides
Question - Pesticides
- Des travaux sont en cours pour assurer une utilisation sécuritaire et durable des produits de protection des cultures (par exemple, les pesticides) au Canada.
- Une récente annonce de financement conjoint (4 août 2021) entre Santé Canada, AAC et Environnement et Changement climatique Canada renforcera la capacité et la transparence du processus d’examen des pesticides, augmentera la disponibilité de données indépendantes pour appuyer la prise de décisions à la suite d’examen des pesticides et fournira des fonds à AAC (environ 7 millions de dollars) pour soutenir la recherche et le transfert de technologies au chapitre des solutions de rechange en matière de lutte antiparasitaire.
Situation actuelle - Pesticides
- AAC mène des recherches sur les répercussions et l’atténuation des répercussions des pesticides sur la faune, la gestion des risques liés aux ravageurs et les approches visant à réduire l’utilisation des pesticides. AAC travaillera à l’élaboration et à la communication d’approches de rechange en matière de lutte antiparasitaire.
- Des séances virtuelles de mobilisation auront lieu avec plusieurs associations provinciales de producteurs et certains groupes non agricoles sur la réévaluation proposée et la refonte du programme. Une fois les séances de mobilisation terminées, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (Santé Canada) procédera à la transformation du programme (échéancier à déterminer), sous réserve des décisions de financement.
Messages clés - Pesticides
- Le gouvernement prend la question de l’innocuité des pesticides très au sérieux. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les pesticides utilisés au Canada soient sans danger pour les gens et l’environnement.
- Les producteurs agricoles ont besoin des bons outils pour lutter contre les mauvaises herbes, les insectes et les maladies qui menacent leur productivité et leur rentabilité ainsi que la sécurité alimentaire mondiale.
- Nous investissons 50 millions de dollars pour donner à nos organismes fédéraux de réglementation les outils dont ils ont besoin pour continuer à protéger la santé des gens et l’environnement.
- Cela permettra également de soutenir nos chercheurs en agriculture et en environnement dans leur recherche révolutionnaire de nouveaux outils biologiques pour aider les producteurs agricoles à lutter contre les ravageurs tout en réduisant la dépendance aux pesticides.
-
La sécheresse de 2021
Enjeu
La sécheresse de 2021 est l’une des pires sécheresses jamais enregistrées au cours des 70 dernières années. En date du 14 septembre, Statistique Canada prévoit des pertes de rendement pour les cultures de céréales et d'oléagineux de 35 % à 46 % par rapport à 2020, et des répercussions sur l'approvisionnement en aliments pour animaux et les cheptels bovins.
Les sécheresses peuvent être dévastatrices pour l’agriculture et les économies rurales, et la reprise peut prendre des années.
- Les programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) fournissent aux producteurs un soutien immédiat et essentiel.
- Les investissements dans les domaines de la science, des pratiques de gestion, de l’éducation et du transfert de connaissances aident à renforcer la résilience aux changements climatiques, et favorisent la reprise du secteur.
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) et les intervenants de l’industrie surveillent de près les conditions de sécheresse qui sévissent dans l’Ouest canadien afin d’évaluer la possibilité de prendre d’autres mesures cet automne.
Contexte
Les cycles de sécheresse
- Les sécheresses dans les grandes plaines d’Amérique du Nord ont des cycles selon les conditions climatiques, océaniques et météorologiques.
- De plus petites sécheresses localisées se produisent au Canada sans qu’aucune tendance ne se dessine et sont liées aux conditions météorologiques régionales.
- D’autres grandes sécheresses ont eu lieu au Canada dans les années 1930 (bol de poussière), de 1948 à 1951, de 1960 à 1962, de 1988 à 1989 et de 2001 à 2003.
Les répercussions des sécheresses sur l’agriculture et les leçons apprises
Selon leur durée et leur intensité, les sécheresses peuvent avoir des effets dévastateurs sur le rendement des cultures, les pâturages et les champs de foin, la santé du bétail, l’approvisionnement en eau des exploitations agricoles et les moyens de subsistance ruraux (conditions sanitaires et socio-économiques).
- La sécheresse qui a sévi de 2001 à 2003 a entraîné une perte de revenus agricoles estimée à 3 milliards de dollars et une réduction de 6 milliards de dollars des économies des provinces des Prairies.
La reprise peut prendre des années, mais elle peut être accélérée avec plus de préparation, de planification et de bonnes pratiques de gestion (par exemple, le travail du sol, la rotation des cultures durables et la préservation des terres humides et des zones riveraines).
Conditions météorologiques et de sécheresse en 2021
- Les conditions de sécheresse ont commencé à l’été 2020 et ont persisté tout au long de l’hiver. Le manque de ruissellement printanier a entraîné des problèmes d’approvisionnement en eau en début de saison, un mauvais rétablissement des pâturages et une humidité du sol inadéquate.
- Les températures record enregistrées ont amplifié les répercussions de la sécheresse. Le « dôme de chaleur », qui s’est étendu de l’île de Vancouver au Manitoba et aux Territoires du Nord-Ouest à son apogée, a été d’une intensité et d’une durée sans précédent.
- La période la plus chaude et la plus sèche de la saison est survenue pendant les phases de floraison des cultures et de développement des semences, ce qui a eu des effets irréversibles sur la qualité et la quantité des récoltes.
Pourcentage des précipitations moyennes à l’automne 2020 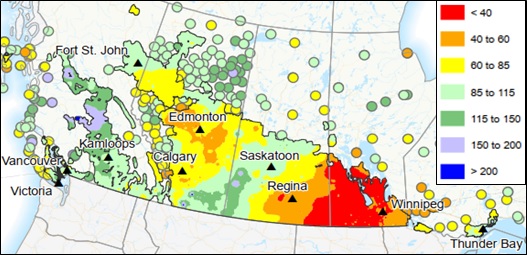
Description de l’image au-dessous
Une carte des provinces de l'Ouest montrant les précipitations moyennes à l'automne 2020 avec des moyennes particulièrement faibles de moins de 40 % ou de 40 % à 60 % de la normale observées en Saskatchewan et au Manitoba.
Pourcentage des précipitations moyennes à l’hiver 2020 
Description de l’image au-dessous
Une carte des provinces de l'Ouest montrant les précipitations moyennes à l'hiver 2020 avec des moyennes particulièrement faibles de moins de 40 % ou de 40 % à 60 % de la normale observées en Saskatchewan et au Manitoba.
Pourcentage des précipitations moyennes au printemps et à l’été 2021 
Description de l’image au-dessous
Une carte des provinces de l'Ouest montrant les précipitations moyennes au printemps/été 2021 montrant des précipitations moyennes de 60 % à 85 %, de 40 % à 60 % ou de moins de 40 % dans la plupart des provinces de l'Ouest
Écart de température moyen par rapport à la normale entre le 22 juin et le 19 juillet 2021 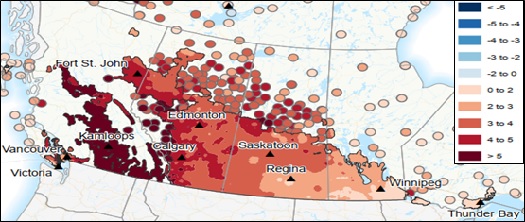
Description de l’image au-dessous
Une carte des provinces de l'Ouest montrant des températures supérieures à la normale, avec des températures particulièrement élevées plus à l'ouest - plus de cinq degrés au-dessus de la normale dans une grande partie de la Colombie-Britannique, comparativement à 0 à 2 degrés ou 2 à 3 degrés au-dessus de la normale au Manitoba.
L’outil de surveillance des sécheresses au Canada — évaluation de 2021
La situation observée en juillet et août 2021 représentait la période la plus sèche et la plus étendue de la sécheresse.
En date du 31 août, la sécheresse :
- couvrait environ 94 % des terres agricoles de l’Ouest canadien;
- touchait 45,9 millions d’acres de terres cultivées, 54 millions d’acres de pâturages et plus de 2 millions de bovins.
- Malgré les précipitations importantes de la fin du mois d’août et une réduction de la gravité de la sécheresse, l’étendue globale de la sécheresse s’est légèrement accrue.
l’intensité de la sécheresse, 2021 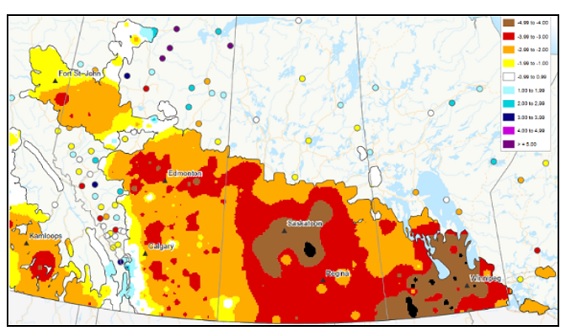
Description de l’image au-dessous
Une carte montrant les catégories de sécheresse dans les provinces de l'Ouest :
- Sécheresse modérée, 1 événement tous les 5 ans
- Sécheresse sévère, 1 événement sur 10 ans
- Sécheresse extrême, 1 événement sur 20 ans
- Sécheresse exceptionnelle, 1 événement tous les 50 ans
Les régions des quatre provinces de l'Ouest connaissent des sécheresses modérées à graves.
Répercussions possibles sur le revenu et la production agricoles
Cultures
Les prix ont été très élevés cette année et devraient compenser les baisses de production causées par la sécheresse. Les premières estimations indiquent que les recettes céréalières devraient augmenter en 2021 de 10,5 % par rapport à 2020, et voir une augmentation supplémentaire de 1 % en 2022.
Certains producteurs font face à un plus grand risque de pénalités financières contractuelles avec les acheteurs de céréales en raison de pertes de rendement.
- Dans l'ensemble, les ventes à l'exportation et sur le marché intérieur seront réduites au cours de la campagne agricole 2021-2022
Bétail
Les pénuries généralisées d’aliments et d’eau augmentent le prix des aliments pour animaux et incitent les éleveurs à réduire la taille de leurs troupeaux de bétail.
- L’augmentation des ventes de bétail est susceptible de réduire le prix des bovins si la demande ne suit pas le rythme de l’augmentation de l’offre. Cette augmentation, combinée à la hausse des prix des aliments pour animaux, nuira à la rentabilité des éleveurs en ce qui concerne les bovins et, potentiellement, d’autres animaux (par exemple, les porcs).
- Les réserves des magasins d’aliments pour animaux risquent d’être épuisés pour l’hiver prochain et les éleveurs qui cherchent à reconstituer leur troupeau dans les années à venir devront probablement composer avec des prix plus élevés.
Résumé des répercussions potentielles de la sécheresse de 2021
Les répercussions prévues sont généralisées dans l’Ouest canadien
- En date du 14 septembre, Statistique Canada prévoit des pertes de rendement de 35 à 46 % pour les cultures céréalières et oléagineuses par rapport à 2020 (blé : 38,3 %, canola : 34,4 %, orge : 33,5 %, pois : 45 %, avoine : 43,6 %, lentilles : 37 % et lin : 34 %).
- La réduction des rendements en foin pourrait atteindre 50 % et la pénurie pourrait dépasser 6 millions de tonnes, alors que les prix du foin ont considérablement augmenté par rapport à la saison dernière.
- Le cheptel bovin pourrait être réduit de 5 à 10 %. Les graves problèmes de disponibilité des aliments et de l’eau, ainsi que le mauvais état des pâturages et des parcours naturels nuisent également à d’autres secteurs de l’élevage (par exemple, bisons et moutons).
- Les feux de forêt dans de nombreuses régions agricoles ont entraîné la perte de pâturages et obligé les producteurs à déplacer leurs troupeaux.
Disponibilité des aliments du bétail 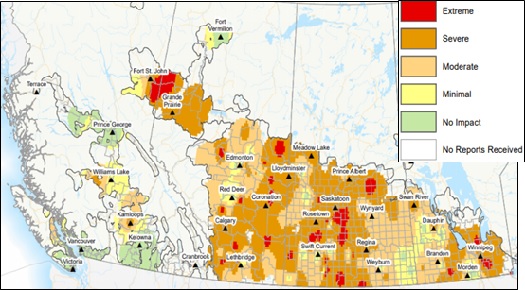
Description de l’image au-dessous
Cette carte montre la gravité des pénuries d'aliments pour animaux avec des pénuries modérées à extrêmes dans les provinces de l'Ouest.
Conditions de pâturage 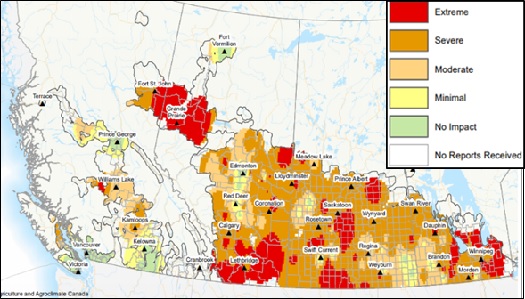
Description de l’image au-dessous
Cette carte montre la gravité des conditions de pâturage avec des impacts modérés à extrêmes dans les provinces de l'Ouest.
Approvisionnement en eau 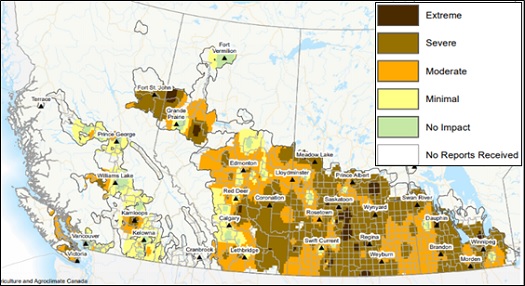
Description de l’image au-dessous
Cette carte montre la gravité des pénuries d'approvisionnement en eau, avec des pénuries modérées à graves et quelques poches de pénuries extrêmes, dans les provinces de l'Ouest.
Programmes de GRE offerts pour composer avec la sécheresse de 2021
Les programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux de GRE à frais partagés offrent aux producteurs une protection contre les pertes de revenu et de production. Ces programmes sont conçus pour fonctionner de façon complémentaire.
Agri-protection
Couvrira une grande partie des pertes attribuables à la réduction des rendements des cultures en raison de la sécheresse. Les estimations préliminaires des provinces des Prairies indiquent les indemnités attribuées à la sécheresse sont estimées à environ 2,5 milliards de dollars.
Des ajustements ont également été apportés au programme pour encourager les producteurs de cultures à récupérer les cultures à faible rendement pour l’alimentation du bétail et aider à compenser les coûts supplémentaires liés aux aliments pour animaux.
Agri-stabilité
Aidera les producteurs qui subissent d’importantes baisses de revenu, y compris ceux qui ne sont pas couverts par Agri-protection.
- Les prestations provisoires sont passées de 50 % à 75 % dans toutes les provinces touchées par la sécheresse, ce qui a permis aux producteurs de recevoir une partie de leur paiement estimé avant la fin de l’année.
- Le Manitoba et la Colombie-Britannique ont autorisé les inscriptions tardives après la date limite.
Agri-relance
Un financement fédéral pouvant atteindre 500 millions de dollars pour les coûts extraordinaires liés à la sécheresse et aux feux de forêt, qui s’ajoute au financement provincial de 330 millions de dollars annoncé. Les producteurs peuvent déjà présenter une demande de soutien financier.
Disposition de report de l’impôt pour les éleveurs de bétail
Permet de reporter l’impôt sur la vente de bétail en cas de sécheresse. Les régions désignées couvrent la quasi-totalité de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi que de vastes régions du sud de la Colombie-Britannique et du nord-ouest de l’Ontario.
Constatations récentes concernant les effet des changements climatiques au Canada
Le climat du Canada s’est réchauffé et les effets des changements climatiques s’intensifieront à l’avenir
Actuellement, on ne constate pas d’augmentation de la fréquence des sécheresses, mais il est évident que la fréquence des inondations et des feux de forêt se produisant plus fréquemment.
Voici quelques-unes des projections (2030 et après)
- Plus de chaleur extrême, moins de froid extrême, des saisons de croissance plus longues, un écoulement printanier de pointe plus hâtif et une certaine augmentation des précipitations dans l’ensemble, mais des étés plus secs.
- Des sécheresses plus fréquentes et plus intenses et des déficits d’humidité du sol plus importants dans le sud des Prairies canadiennes et la région intérieure de la Colombie-Britannique.
- L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des températures augmentera la gravité des vagues de chaleur et contribuera à l’augmentation des risques de sécheresse et de feux de forêt.
Accélération du rythme et de la gravité de l'impact du changement climatique nécessiteront un renforcement du soutien à la planification de l’adaptation, à la surveillance et à l’évaluation des effets, à la transmission des connaissances et des renseignements, ainsi qu’à l’adoption de pratiques visant à atténuer les conséquences futures.
AAC a une longue histoire de soutenir la résilience climatique et l'adaptation aux temps extrêmes
Investissement dans l’éducation et les mesures à la ferme
- Les programmes FPT à frais partagés à la ferme offerts par les provinces et les territoires sensibilisent les producteurs aux risques environnementaux et accélèrent l’adoption de technologies et de pratiques visant à réduire ces risques et à s’adapter aux changements climatiques.
Science et activités de transfert des connaissances visant à accélérer l’adoption et l’innovation
- Développer, évaluer et démontrer des pratiques et des technologies de gestion qui aident à gérer les risques climatiques pour les exploitations agricoles (par exemple, les laboratoires vivants et le programme Solutions agricoles pour le climat).
- Des variétés de cultures résistantes au climat, aux maladies et aux ravageurs et des systèmes d'irrigation plus efficaces.
- Modèles climatiques, météorologiques et de cultures et outils d’aide à la prise de décisions (par exemple, évaluations de la surveillance de la sécheresse et effets des changements climatiques sur la pression future de maladie).
Possibilités de renforcer la résilience aux changements climatiques
Amélioration des programmes du prochain cadre stratégique
- Travailler avec les provinces, les territoires et les intervenants pour explorer les options visant à améliorer la science, les programmes à la ferme et les programmes de GRE afin de répondre aux besoins et de relever les défis futurs.
- Comprend des possibilités d’explorer une infrastructure hydraulique à la ferme plus résiliente.
- Continuer d’améliorer la science et l’innovation (par exemple, variétés de cultures plus résilientes).
Élaboration d’une stratégie nationale d’adaptation (2021-2022)
- Orienter les priorités futures en matière d’adaptation, y compris pour le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Mise en œuvre de solutions climatiques naturelles sur les terres agricoles
- La prestation continue de programmes et les collaborations avec d’autres ministères soutiennent l’adoption de solutions climatiques agricoles basées sur la nature qui augmentent la séquestration du carbone et améliorent la résilience aux changements climatiques des terres agricoles.
Création d’une nouvelle agence canadienne de l’eau
- Travailler avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les partenaires du secteur et d’autres intervenants pour protéger les ressources en eau, y compris en menant de potentielles activités scientifiques et de transfert des connaissances et en optimisant les programmes visant à améliorer la résilience à la sécheresse et aux inondations.
Perspectives d’avenir
- Les programmes de GRE actuels sont intervenus rapidement.
- Les répercussions financières et sur la chaîne d’approvisionnement pourraient s’aggraver en 2022 en fonction des conditions météorologiques de l’automne 2021 jusqu’à la saison de croissance de 2022. Il pourrait s’avérer nécessaire de déployer d’autres programmes de rétablissement et de soutien.
- Les effets des changements climatique sur le secteur de l’agriculture et de l’alimentation se font sentir aujourd’hui, et les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations et les feux de forêt devraient s’intensifier à l’avenir.
- Il est essentiel d’accroître le soutien à la planification de l’adaptation et à la gestion des urgences pour améliorer la préparation aux futurs phénomènes météorologiques extrêmes.
- Poursuivre l’évaluation des options et étudier d’autres possibilités d’amélioration des programmes à la ferme et de GRE—tirer des leçons des expériences passées, notamment celles de 2021.
Annexe : comparaison avec les sécheresses antérieures
- La sécheresse de 1961 a été l’une des sécheresses les plus graves jamais enregistrées. Les faibles précipitations et les températures mensuelles record ont entraîné de mauvaises récoltes à grande échelle et la vente de bétail par les producteurs en raison du manque d’aliments pour animaux et d’eau. Les pertes ont été désastreuses; rien que pour la production de blé des Prairies, elles ont atteint 668 millions de dollars. Les rendements globaux ont chuté de 54 % en Saskatchewan et de 51 % au Manitoba.
- La sécheresse de 1988 représente une autre période de sécheresse importante dans les Prairies. Elle a entraîné une réduction de la production agricole de 50 % en Saskatchewan et de 44 % au Manitoba.
- La sécheresse qui a sévi entre 2001 et 2002 constituait une période plus longue de sécheresse modérée. Bien que les sécheresses d’une année tendent à être moins graves, leurs effets cumulatifs sur quatre à cinq ans ont eu des conséquences de taille, notamment une réduction de 3,6 milliards de dollars de la production agricole en 2001 et une baisse de rendement de 30 % en 2002.
- La sécheresse de 2021 est l’une des sécheresses d’une année les plus généralisées et graves jamais enregistrées. Les répercussions sont encore en cours d’évaluation, mais semblent avoir été atténuées grâce à de meilleures pratiques de gestion, à la préparation à la sécheresse et à l’amélioration des variétés de semences.
17 août 1961 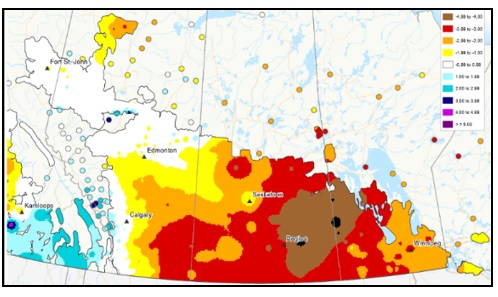
Description de l’image au-dessous
Cette carte montre la propagation et la gravité de la sécheresse occidentale de 1961.
17 août 1988 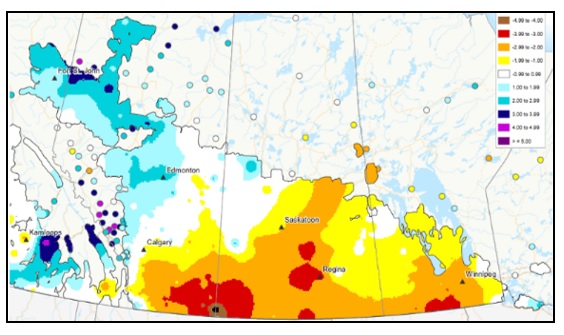
Description de l’image au-dessous
Cette carte montre la propagation et la gravité de la sécheresse occidentale de 1988.
17 août 2021 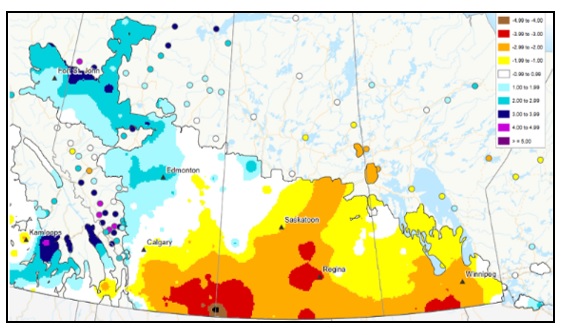
Description de l’image au-dessous
Cette carte montre la propagation et la gravité de la sécheresse occidentale de 2021.
Annexe : répercussions de la sécheresse sur le secteur agricole
Risque accru pour la santé du sol et réduction de l’humidité du sol
- Réduction et épuisement de l’humidité du sol et de l’approvisionnement en eau (par exemple, fosses-réservoirs, puits)
- Intensification de l’érosion des sols et de la salinisation (sels)
- Réduction de la germination des semences et rendements plus faibles
- Augmentation de la demande et de l’utilisation de l’eau d’irrigation, ce qui peut être coûteux
Réduction de la qualité de l’eau
- La baisse du débit et des niveaux d’eau dans les rivières et les fosses-réservoirs réduit la qualité de l’eau
Réduction de la croissance, des rendements et de la qualité des cultures et des aliments pour animaux
- Diminution des revenus agricoles, augmentation des coûts et de la demande d’aliments pour animaux et perte d’occasions commerciales
- Besoin accru de pâturages et de foin, et réduction de la productivité future
Stress accru sur le bétail et enjeux liés au bien-être animal
- Réduction des gains de poids et augmentation du risque de mortalité due aux pénuries d’aliments et d’eau
- Pression accrue pour diminuer la taille des troupeaux, ce qui réduit le futur cheptel reproducteur
Autres enjeux de gestion connexes
- La présence accrue d’organismes nuisibles a des répercussions sur le rendement et la qualité des cultures, des pâturages et du foin
- La fréquence accrue des feux de forêt a des répercussions sur l’accès aux pâturages et menace les bâtiments, les cours et le bétail
- Répercussions accrues sur la santé humaine (mentale et physique) causées par la poussière, le stress et les accidents
-
Prochain cadre stratégique pour l’agriculture
Objet
- Un aperçu du Partenariat canadien pour l'agriculture (PAC) actuel — un cadre fédéral-provincial-territorial (FPT) pour les politiques et programmes agricoles et agroalimentaires
- Préparatifs en cours pour l'élaboration du prochain cadre stratégique (CNS), qui succédera à la PAC à son expiration en 2023
Les cadres fournissent un mécanisme de coopération FPT et un soutien coordonné au secteur
Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire est une compétence partagée où le commun accord, la coopération et l’engagement entre les gouvernements FPT contribuent à faire progresser le secteur.
- Depuis la mise en œuvre du Cadre stratégique pour l’agriculture (CSA) en 2003, les accords-cadres multilatéraux (ACM) quinquennaux conclus entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux jouent un rôle important consistant à orienter et à soutenir le secteur agricole et agroalimentaire canadien.
- Le PCA et les cadres précédents ont permis aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes pour aider le secteur à relever les défis et à saisir des occasions.
- Les investissements de cadres sont administrés conformément aux accords multilatéraux et bilatéraux négociés avec les gouvernements PT, lesquels qui permettent aux administrations de répondre aux divers besoins régionaux tout en appuyant des résultats communs.
Aperçu du Partenariat canadien pour l’agriculture
Le PCA vise à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Ce partenariat FPT comprend un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) dans des initiatives stratégiques et le financement de programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) (moyenne de 1,6 milliard de dollars par année).
Initiatives stratégiques
- Plus d’un milliard de dollars en programmes et activités fédéraux de portée nationale qui sont financés et exécutés par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).
- Deux milliards de dollars sont investis dans les programmes à frais partagés qui sont financés selon un ratio 60:40 (F:PT) et exécutés par les gouvernements PT.
Programmes de gestion des risques de l’entreprise
- Une moyenne de 1,6 milliard de dollars par an pour des programmes de GRE de l’entreprise axés sur la demande pour aider les producteurs à gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation et qui excèdent leur capacité de gestion.
Le PCA fournit des investissements dans un certain nombre de domaines clés
Le PCA vise à atteindre un certain nombre d’objectifs :
- Élargir les marchés nationaux et internationaux et les débouchés commerciaux pour le secteur en cherchant à établir de nouveaux accords commerciaux et en travaillant avec l’industrie pour élargir et saisir les débouchés sur les marchés.
- Renforcer la compétitivité et les avantages concurrentiels en augmentant la capacité en matière de sciences et d’innovation et en encourageant l’adoption de produits, pratiques et de processus.
- Prévoir et atténuer les risques et intervenir afin de favoriser la croissance durable du secteur en donnant aux producteurs l’accès à une série de programmes de GRE et à d’autres outils d’atténuation des risques.
- Favoriser la résilience et la durabilité environnementale du secteur, par exemple par une série de pratiques de gestion bénéfiques et d’initiatives à la ferme.
- Améliorer la croissance du secteur de la transformation des produits agricoles et agroalimentaires à valeur ajoutée par la science, l’innovation et le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises.
- Susciter et accroître la confiance du public dans le secteur par des actions de sensibilisation, d’éducation et autres.
Tracer la voie pour le prochain cadre stratégique
Compte tenu des négociations poussées avec les provinces/territoires et des consultations sectorielles nécessaires, il faudra environ deux ans pour achever un nouveau cadre, lequel serait en vigueur d’avril 2023 à mars 2028.
Le PCS est l’occasion de définir une vision pour le secteur, notamment en tenant compte de l’horizon 2030 élargi et du rôle du secteur agricole dans la lutte contre les changements climatiques et la réalisation des objectifs de développement durable.
Il sera également important de s’appuyer sur les leçons tirées des cadres précédents et d’assurer une transition en douceur des programmes et des politiques, le cas échéant.
Le PAC, soit le cadre quinquennal actuel, doit prendre fin le 31 mars 2023.
Principaux jalons et échéances prévus du PCS
Selon notre expérience de la négociation des cadres précédents, l’échéancier prévu de l’élaboration du prochain cadre stratégique, y compris les accords-cadres multilatéraux (ACM) et les accords bilatéraux, devrait comprendre les jalons suivants :
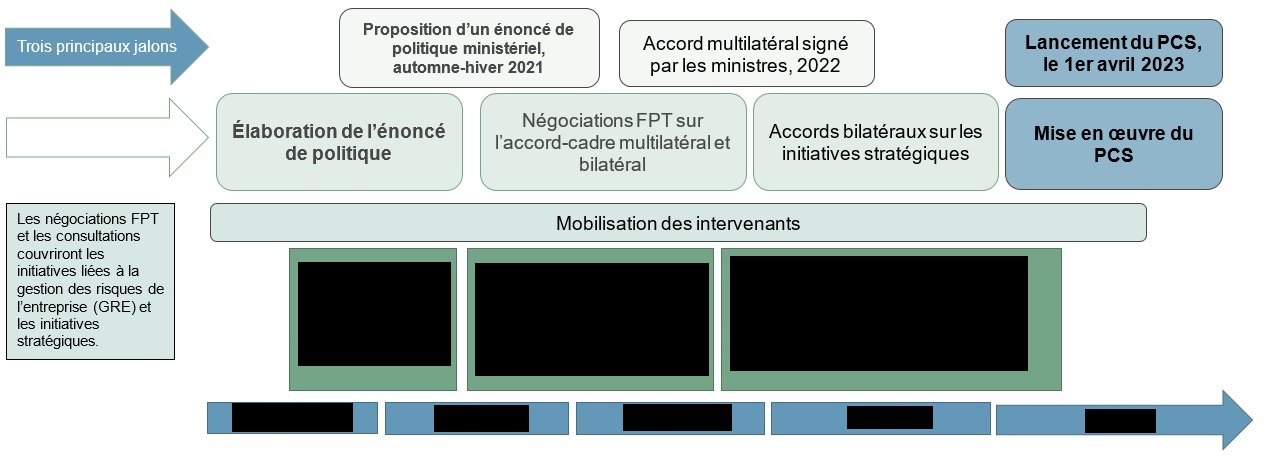
La description de l'image ci-dessus
Principaux jalons et échéances prévus du Prochain cadre stratéguique
Une série d'encadrés graphiques montrant les trois étapes clés du Prochain cadre stratégique :
- proposition d'énoncé de politique ministérielle
- accord multilatéral signé par le ministre d'ici 2022
- le lancement du Prochain cadre stratéguique le 1er avril 2023.
Viennent ensuite les 4 phases du Prochain cadre stratéguique :
- Élaboration de la déclaration de politique
- Négociations fédérales-provinciales-territoriales
- Accord bilatéral
- Mise en œuvre du Prochain cadre stratégique
Les négociations et les consultations fédérales-provinciales-territoriales englobent à la fois la gestion des risques de l'entreprise et les initiatives stratégiques.
█████████████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
État actuel de l’élaboration du PCS
Les mesures visant à faire progresser l’élaboration du cadre comprennent notamment :
- Proposition d’énoncé de politique : Les représentants des gouvernements FPT fédéral, provinciaux et territoriaux négocient actuellement l’énoncé de politique qui sera examiné et approuvé par les ministres de l’Agriculture.
- Positions fédérales pour les négociations d’ACM : Les représentants d’AAC examinent les principaux domaines thématiques, déterminent les points de vue des PT et recommandent des positions de négociation fédérales pour orienter les discussions sur les ACM avec les gouvernements PT.
- Priorités pour les programmes exclusivement fédéraux : Les représentants d’AAC travaillent également à déterminer les domaines d’intérêt particulier qui devraient faire l’objet de programmes exclusivement fédéraux.
- Mobilisation : Les consultations visant à orienter le PCS sont en cours. À ce jour, le gouvernement fédéral a consulté des groupes de l’industrie et des organisations non gouvernementales (ONG), des intervenants autochtones, des jeunes et d’autres groupes.
Les mesures visant à faire progresser l’élaboration du cadre comprennent notamment :
Points à retenir des consultations fédérales
À ce jour, les intervenants se sont prononcés à l’occasion de séances de mobilisation nationales, de consultations auprès de groupes autochtones et d’organisations de jeunes et de réunions avec des représentants du secteur; les intervenants ont également pu soumettre des commentaires en ligne.
De nombreux intervenants ont relevé des liens entre les priorités (par exemple, les enjeux environnementaux, économiques, scientifiques et sociaux et les questions liées à l’innovation et au commerce) et la nécessité de mieux mesurer le rendement. Voici une liste non exhaustive d’exemples de commentaires :
- Environnement : Perçu comme un défi ou un risque important, bien que les points de vue concernant les mesures recommandées diffèrent.
- Marchés et commerce : L’accent est mis sur les nouveaux débouchés dans les marchés émergents ainsi que sur les problèmes existants tels que les barrières commerciales interprovinciales et les risques géopolitiques croissants.
- Science et innovation : Considéré comme essentiel pour faire progresser la productivité et la compétitivité.
- Production de rapports : Les intervenants ont souligné l’importance de la mesure et de la transparence, en faisant remarquer que la capacité à comprendre les résultats des programmes à ce jour a été limitée et devrait être améliorée.
- Valeur ajoutée et transformation des aliments : Il faut explorer les possibilités offertes par les produits à valeur ajoutée.
Travailler en collaboration avec les provinces et les territoires
Bien que les gouvernements PT aient leurs propres perspectives et points de vue, il est possible d’harmoniser les positions fédérales avec les priorités des gouvernements PT.
- Le soutien continu à la compétitivité, aux marchés et au commerce, à la science et à l’innovation, à la valeur ajoutée et à d’autres priorités clés sont des domaines dans lesquels on s’attend à une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
- Des progrès ont déjà été réalisés dans le recensement des domaines prioritaires pour le PCS, bien qu’il reste du travail à faire pour mettre au point les détails de l’approche et obtenir un consensus à ce sujet.
- Plus précisément, le 15 juillet, les ministres FPT de l’Agriculture se sont réunis pour discuter de plusieurs domaines d’intérêt clés pour le secteur agricole du Canada, notamment le PCS.
- Les discussions avec les gouvernements PT se poursuivront à l’automne et à l’hiver 2021, alors que nous travaillerons en collaboration pour mettre au point un énoncé de politique proposé et entamer des négociations en vue de l’élaboration de l’ACM.
Domaines possibles d’intervention du gouvernement fédéral
Les priorités du PCS devront être établies à la fois en fonction des défis et des occasions qui se présentent actuellement et en fonction de ceux qui devraient être importants pour le secteur au cours des cinq à dix prochaines années.
- Les négociations avec les gouvernements PT en vue de mettre au point l’énoncé de politique et les discussions en vue de l’élaboration de l’ACM présentent une occasion pour le gouvernement du Canada de chercher à obtenir des engagements dans des domaines prioritaires fédéraux.
- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Prochaines étapes et domaines d’intérêt immédiat pour l’automne et l’hiver 2021
Votre contribution et vos orientations seront essentielles pour clarifier les domaines de priorité fédérale, établir les positions de négociation et reprendre les discussions avec les gouvernements PT.
Voici les domaines en particulier qui nécessiteront votre attention à l’automne et à l’hiver 2021 :
- 1. Proposition d’énoncé de politique : Déterminer la voie à suivre pour un énoncé de politique du PCS qui établira les principes, les priorités et les résultats à atteindre.
- ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Le Partenariat canadien pour l’agriculture : contexte
Aperçu du Partenariat canadien pour l’agriculture 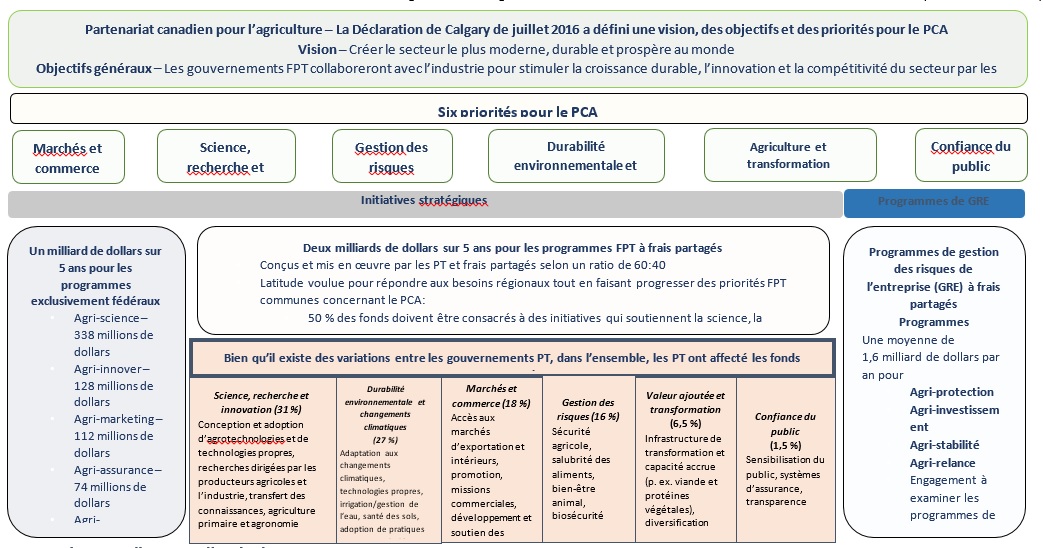
La description de l'image ci-dessus.
Partenariat canadien pour l’agriculture: La Déclaration de Calgary de juillet 2016 a défini une vision, des objectifs et des priorités pour le PCA :
Vision : Créer le secteur le plus moderne, durable et prospère au monde
Objectifs généraux : Les gouvernements fédérale/provinciale/territoriale collaboreront avec l’industrie pour stimuler la croissance durable, l’innovation et la compétitivité du secteur par les six priorités pour le Partenariat canadien pour l’agriculture :
- Marchés et commerce
- Science recherche et innovation
- Gestion des risques
- Durabilité environnemental et changements climatiques
- Agriculture et transformation
- Confiance du public
Initiatives stratégiques
Un milliard de dollars sur 5 ans pour les programmes exclusivement fédéraux :
- Agri-science, 338 millions de dollars
- Agr-iInnover, 128 millions de dollars
- Agri-marketing, 112 millions de dollars
- Agri-assurance, 74 millions de dollars
- Agri- compétitivité, 20.5 millions de dollars
- AgriDiversity, 5 millions de dollars
Deux milliards de dollars sur 5 ans pour les programmes fédérales/provinciales/territoriales à frais partagés
Conçues et mis en œuvre par les gouvernements provinciales/territoriales et frais partagés selon un ratio de 60 :40
Latitude voulue pour répondre aux besoins régionaux tout en faisant progresser des priorités fédérales/provinciales/territoriales communes concernant le Partenariat canadien pour l’agriculture
- 50 % des fonds doivent être consacrés à des initiatives qui soutiennent la science, la recherche et innovation, la durabilité environnementale et aux marchés et commerce
- Les 50 % restants peuvent être affectés comme les gouvernements PT le souhaitent
Bien qu’il existe des variations entre les gouvernements PT, dans l’ensemble, les PT ont affecté les fonds comme suit :
- Science, recherche et innovation, 31 % : Conception et adoption d’agrotechnologies et de technologies propres, recherches dirigées par les producteurs agricoles et l’industrie, transfert des connaissances, agriculture primaire et agronomie
- Durabilité environnementale et changements climatiques, 27 % : Adaptation aux changements climatiques, technologies propres, irrigation/gestion de l’eau, santé des sols, adoption de pratiques de gestion bénéfiques
- Marchés et commerce, 18 % : Accès aux marchés d’exportation et intérieurs, promotion, missions commerciales, développement et soutien des entreprises
- Gestion des risques, 16 % : Sécurité agricole, salubrité des aliments, bien‑être animal, biosécurité
- Valeur ajoutée et transformation, 6,5 % : Infrastructure de transformation et capacité accrue (par exemple, viande et protéines végétales), diversification
- Confiance du public, 1,5 % : Sensibilisation du public, systèmes d’assurance, transparence
Programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) à frais partagés
- Une moyenne de 1,6 milliard de dollars par an pour Agri‑protection, Agri‑investissement, Agri‑stabilité, Agri‑relance
- Engagement à examiner les programmes de GRE
-
Peste porcine africaine : un aperçu
Secteur canadien du porc
- Le secteur canadien du porc contribue à l’économie à hauteur de 28 milliards de dollars; il compte 2 300 exploitations agricoles et 28 installations de transformation inspectées par le gouvernement fédéral, ce qui représente environ 100 000 emplois.
- Chaque année, 29,5 millions de porcs sont produits, principalement au Québec (24 %), en Ontario (26 %) et au Manitoba (30 %).
- Aussi, la capacité d’abattage se trouve principalement au Québec (39 %), en Ontario (20 %) et au Manitoba (26 %).
- Actuellement, 14 millions de porcs sont en cours de production.
- Le secteur porcin canadien est fortement intégré au secteur américain.
- En 2020, plus de 1,49 million de tonnes de porc, d’une valeur de 5,1 milliards de dollars, ont été exportées vers 94 pays.
Les trois principaux marchés pour le porc canadien
- États-Unis
- Japon
- Chine
Peste porcine africaine (PPA)
- La peste porcine africaine est une maladie contagieuse et mortelle pour les porcs qui s’est propagée en Afrique, en Asie, dans certaines régions d’Europe et, plus récemment, en République dominicaine et à Haïti.
- Bien que la maladie ne puisse pas être transmise à l’homme, elle présente un taux de mortalité élevé chez les porcs infectés et peut survivre pendant des périodes prolongées dans les produits d’origine animale.
Un seul cas positif de peste porcine africaine au Canada exigerait l’arrêt immédiat de toutes les exportations de porc et de porcs vivants (70 % de la production nationale). Les conséquences financières seraient importantes pour les producteurs et les transformateurs, qui seraient aux prises avec des pertes de marchés et des baisses de prix causées par une offre excédentaire de viande de porc par rapport à la demande intérieure.
Premières conséquences
- Gestion de la maladie et éradication : L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée de contenir et d’éradiquer la maladie le plus rapidement possible.
- Commerce : Perte immédiate de tous les marchés d’exportation (70 % de la production nationale).
- Porcs excédentaires : En cas de fermeture de la frontière, des millions d’animaux excédentaires devraient être abattus, ce qui entraînerait des coûts extraordinaires pour l’industrie et susciterait des inquiétudes quant au bien-être des animaux, à la santé mentale des agriculteurs et à l’environnement.
- Producteurs de porcs : Les porcs sans marché retarderaient le cycle de production du porc, et les décisions de dépeuplement devraient être prises rapidement. Il serait urgent d’euthanasier les porcs vivants destinés aux États-Unis.
- On estime qu’il faudrait réformer au moins 50 % du cheptel porcin (7 millions de porcs).
- Transformateurs de porcs : Les transformateurs perdraient du jour au lendemain la majorité de leur marché. Les transformateurs orientés vers l’exportation ou les établissements de plus petite taille pourraient éventuellement cesser leurs activités.
- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Carte du monde sur la progression de la PPA, 2018, 2019, 2020
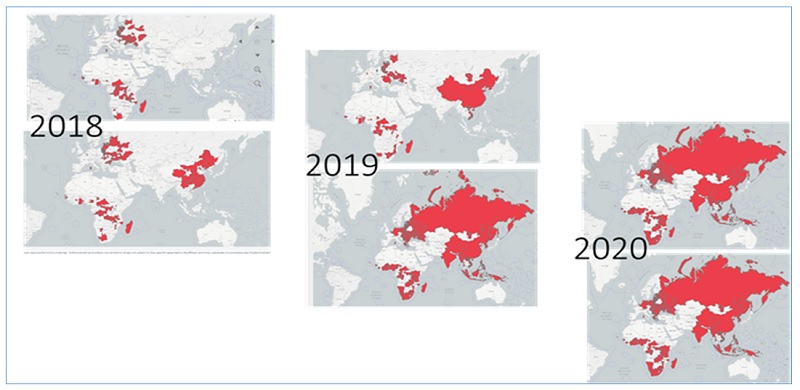
Description de l’image au-dessous
Carte montrant qu’en 2018, il y avait de petites zones de PPA en Asie, en Afrique et en Europe. À côté se trouve une deuxième carte qui montre qu’en 2019, la PPA s’étendait à la majeure partie de l’Europe et de l’Asie et que la zone était légèrement plus grande en Afrique. Enfin, une carte de 2020 montre un nombre légèrement plus grand par rapport à 2019, toujours en Asie, en Afrique et en Europe.
La rouge représente les pays infectés par la peste porcine afriaine
Le blanc représente les pays exempts de peste porcine africaineSource : WAHIS de l'OIE
- Été 2021 — La peste porcine africaine a atteint les Amériques, avec une confirmation de la présence de la maladie en République dominicaine et à Haïti, ce qui augmente encore le risque d’entrée au Canada.
- On pense que les voies à risque le plus élevé sont les voyageurs internationaux (vêtements, équipement ou produits de porc illégaux) ou les expéditions commerciales illégales d'aliments pour animaux.
Efforts actuels de prévention et de préparation
- L'ACIA et Agriculture et Agroalimentaire Canada ont joué un rôle actif dans l'élaboration et l'exécution d'un plan d'action pancanadien contre la PPA, un effort FPT-Industrie visant à coordonner et à prioriser les travaux de prévention et de préparation liés à la PPA dans tout le pays.
- Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a investi 828 928 $ au cours du dernier exercice pour améliorer l’état de préparation de l’industrie, notamment la biosécurité à la ferme, les plans de communication et la traçabilité.
- Depuis l’exercice 2019-2020, l’ACIA consacre des ressources internes sans précédent à la prévention et aux préparatifs de lutte contre la peste porcine africaine (3,5 millions de dollars en 2020-2021) :
- Investissement dans le développement de la surveillance et dans les tests de diagnostic.
- Négociation proactive d’accords de zonage avec les partenaires commerciaux.
- Activation du Centre national des opérations d’urgence en mode de préparation à la peste porcine africaine.
- Le Budget de 2019 a annoncé un financement pouvant atteindre 31 M$, réparti sur les cinq prochaines années, pour l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin d’acquérir, de former et de déployer 24 nouvelles équipes de détecteurs de produits alimentaires, végétaux et animaux.
- 15 équipes de chiens détecteurs ont été formées et déployées. Neuf autres suivront une formation au cours de l’exercice 2022-2023.
- À la suite de la découverte de la peste porcine africaine en République dominicaine, l’ACIA a reçu 300 000 $ supplémentaires pour les campagnes de sensibilisation des voyageurs (soit un total de 500 000 $). L’ACIA a intensifié ses efforts de sensibilisation et augmenté le financement des campagnes de communication visant à faire connaître les risques de la peste porcine africaine.
Plan d’action pancanadien pour lutter contre la PPA
Jusqu’à présent, il y a eu une coordination importante avec les provinces et les groupes industriels pour faire avancer le Plan d’action pancanadien pour lutter contre la peste porcine africaine.
Volets du plan d’action
- Volet 1 : Prévention et renforcement de la biosécurité
- Volet 2 : Planification de la préparation
- Volet 3 : Assurer la continuité des activités
- Volet 4 : Communication coordonnée des risques
Volet 1 : Prévention et renforcement de la biosécurité
Première ligne de défense pour protéger la population porcine canadienne de la PPA en limitant les sources potentielles d'introduction de virus
Autorités pour les cochons sauvages guidé par plusieurs ministères (AAC, Environnement et Changement climatique Canada, etc.), associations de l’industrie et homologues des États-Unis (département de l’Agriculture [USDA] et Service d’inspection de la santé animale et végétale [APHIS])
- Contrôles des importations guidé par : ASFC et ACIA
- Biosécurité guidé par ACIA et industrie
- Engagement international guidé par ACIA
- Prévenir l’entrée au Canada et limiter la propagation en cas d’entrée
Volet 2 : Planification de la préparation
Une intervention précoce et rapide contre la maladie sera essentielle pour arrêter la propagation du virus et atténuer les conséquences d’une éclosion.
- Diagnostic et surveillance, guidé par ACIA
- Plans et procédures d'intervention, guidé par ACIA, gouvernements provinciaux et industrie
- Formation et exercices guidé par ACIA, gouvernements provinciaux et industrie
Volet 3 : Assurer la continuité des activités
Les impacts d'une épidémie de PPA peuvent être atténués grâce à un engagement proactif avec les partenaires commerciaux et en fournissant un soutien pour aider le secteur à s'adapter aux changements du marché.
Zonage - Guidé par ACIA et industrie
- Le zonage est une approche internationalement reconnue du contrôle des maladies qui gère également les risques commerciaux. Une zone peut être établie autour d'une zone définie, sur une base géographique.
- Le Canada a confirmé les accords de zonage avec certains partenaires commerciaux et travaille à la mise en place de nouveaux accords.
Cloisonnement - Guidé par ACIA et industrie
- Les cloisonnement sont un contrôle de population volontaire et séparé établi avant l'introduction de la PPA en fonction des pratiques de gestion et de biosécurité plutôt que de la géographie.
- L'acceptation du cloisonnement devra être négociée avec les partenaires commerciaux.
Intervention en cas d’interruption du marché - Guidé par AAC, gouvernements provinciaux et industrie
- Interventions immédiates : Élaboration d'une approche coordonnée et collaborative à l'échelle nationale pour la gestion des porcs excédentaires, avec une certaine marge de manœuvre pour les besoins régionaux. Il s'agit notamment d'évaluer la capacité des infrastructures à assurer le dépeuplement et d'investir dans ce sens. AAC a également mis en place un système de gestion des incidents.
- Interventions à plus long terme : Adaptation de l'industrie et planification de la transition sectorielle.
Volet 4 : communication coordonnée des risques
Prévention
Des travaux sont en cours pour élaborer des plans de communication sur les risques afin d’aborder les mesures de prévention, de préparation, d’intervention et de relance dans le contexte de la peste porcine africaine.
Guidé par industrie, ACIA, AAC, gouvernements provinciaux
- Prévention
- Campagnes de sensibilisation
- Voyageurs et population canadienne
- Préparation
- Messages prévus (confiance du public)
- Coordonner les communications entre tous les acteurs
Prochaines étapes
Renforcement des efforts de prévention et de biosécurité
- Soutenir l’industrie dans la finalisation des normes nationales de biosécurité des porcs à la ferme (automne 2021).
- Plans de gestion des cochons sauvages (printemps 2022).
- Surveillance accrue de la situation en République dominicaine et renforcement des contrôles à l’importation (en cours).
Planification de la préparation
- Déterminer les besoins opérationnels pendant les premiers jours d’une éclosion.
- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████ ███████████████
Assurer la continuité des activités
- ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- Engagement avec l’industrie pour savoir quels porcs seront destinés au marché intérieur ou à l’abattage par compassion.
- ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- L’ACIA continuera de négocier des accords de zonage avec les principaux partenaires commerciaux (en cours jusqu’en 2021-2022).
Communication coordonnée des risques
- Les partenaires FPT et l’industrie continuent de collaborer sur une variété de plans de communication des risques coordonnés pour aborder les mesures de prévention, de préparation, d’intervention et de relance dans le contexte de la peste porcine africaine (en cours).
Annexe : rôles et responsabilités
ASFC
- Appliquer des contrôles à l'importation pour empêcher l'entrée de PPA au Canada.
ACIA
- Diriger les activités de contrôle et d’éradication des maladies.
- S’occuper de l’indemnisation des animaux éliminés, le cas échéant.
- Obtenir l’acceptation internationale des approches de zonage et de cloisonnement.
- Diriger la stratégie pour retrouver le statut de zone indemne et l’acceptation internationale.
AAC
- █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ████████████████████
- Coordonner les discussions dans les domaines relevant de plusieurs compétences, comme les abattages par compassion dans les usines de transformation, afin de faciliter une approche cohérente et nationale.
- Élaborer et offrir des programmes de soutien fédéraux, le cas échéant, qui répondent aux besoins nationaux.
Industrie
- Gérer de manière proactive les risques de l’entreprise en tirant parti des programmes existants ainsi que des outils privés de gestion des risques, et prendre des décisions commerciales en fonction des conditions du marché.
- Mettre en œuvre des normes de biosécurité à la ferme pour aider à atténuer l’introduction de maladies.
- Diriger les activités de dépeuplement et d’élimination des porcs excédentaires sur le terrain, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de biosécurité, avec le soutien des gouvernements FPT, si nécessaire.
Gouvernements provinciaux et territoriaux
- █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- Faciliter la mise en œuvre des options d’élimination de masse des carcasses, et travailler avec les municipalités pour mettre en place les capacités nécessaires.
- Élaborer et offrir des programmes de soutien qui répondent aux besoins de la région et du secteur, en collaboration avec les municipalités et l’industrie.
-
Secteurs sous gestion de l’offre et programmes qui leur sont destinés
Qu’est-ce que la gestion de l’offre?
La gestion de l’offre est le système de production et de commercialisation en vertu duquel les produits laitiers, les œufs, le poulet et le dindon sont produits au Canada.
La gestion de l’offre vise à assurer aux producteurs un rendement raisonnable de leur travail et de leur investissement, tandis que les consommateurs bénéficient d’un approvisionnement prévisible en produits.
Le système de gestion de l’offre repose sur trois piliers :
- La réglementation des prix
- La production limitée
- Les importations contrôlées
Gestion de l’offre : Comment cela fonctionne-t-il?
Production : conçue pour répondre à la demande intérieure
Les niveaux de production sont fixés à l’échelle nationale, puis transférés aux offices de commercialisation provinciaux, qui attribuent ensuite des niveaux de production maximum aux producteurs au moyen de quotas.
Prix : visant à s’assurer que les producteurs bénéficient d’un rendement équitable de leur travail
Les offices de commercialisation provinciaux établissent les prix que les producteurs reçoivent, en tenant compte de facteurs comme le coût de production et l’inflation. Les prix de détail ne sont pas réglementés.
Importations : gérées et administrées par l’intermédiaire du gouvernement fédéral.
Les importations de produits visés par la gestion de l’offre sont contrôlées au moyen de contingents tarifaires.
- Des limites sont fixées quant au volume des importations autorisées à entrer au Canada à des taux tarifaires bas ou nuls, avec des taux beaucoup plus élevés et en sus du contingent pour les importations supplémentaires.
Rôle du gouvernement fédéral dans la gestion de l’offre
Le gouvernement fédéral est l’un des acteurs d’un système fondé sur l’intersection des pouvoirs fédéraux et provinciaux de même que sur une étroite collaboration de l’industrie. Cependant, le gouvernement fédéral joue un certain nombre de rôles pour aider à assurer la viabilité à long terme des secteurs concernés par la gestion de l’offre, notamment :
- Soutenir la capacité concurrentielle du secteur au moyen de programmes et de recherches dans le domaine de l’agriculture;
- Maintenir des contrôles frontaliers efficaces et la prévisibilité des importations pour la gestion de l’offre de marchandises grâce à l’administration de contingents tarifaires et à de solides vérifications de la conformité;
- Appuyer le système de gestion de l’offre, conformément aux responsabilités prévues par la loi, par l’intermédiaire de la Commission canadienne du lait et du Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC). Les deux institutions fédérales jouent des rôles clés, mais distincts, en ce qui concerne les politiques d’attribution et de tarification.
Accords commerciaux récents
- AECG – 2017, Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, produits laitiers (fromage) seulement
- PTPGP – 2019, Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, tous les secteurs concernés par la gestion de l’offre
- ACEUM – 2020, Accord Canada-États-Unis-Mexique, tous les secteurs concernés par la gestion de l’offre
Les accords commerciaux récents offrent aux principaux partenaires commerciaux du Canada un accès supplémentaire au marché intérieur des produits laitiers, de la volaille et des œufs, tout en maintenant le système de gestion de l’offre et ses piliers intacts.
Cet accès supplémentaire a été fourni sous la forme de contingents tarifaires, qui permettent d’importer une quantité fixe de produits particuliers à un taux de droit faible ou nul.
L’augmentation des importations en vertu de ces accords se traduit par le remplacement de produits qui auraient autrement été fournis par des producteurs canadiens.
Jusqu’à présent, les importations en vertu de l’AECG et de l’ACEUM ont été utilisées à 100 % ou près de 100 % pour la plupart des marchandises. Cependant, dans le cas du PTPGP, certains taux d’utilisation des contingents tarifaires ont été légèrement inférieurs aux prévisions en raisons diverses.
Réponse du gouvernement du Canada : indemnisation dans le contexte de l’AECG et PTPGP
- Août 2017 – Un financement de 350 millions de dollars est annoncé pour deux nouveaux programmes visant à aider les producteurs et les transformateurs laitiers à faire face aux répercussions de l’AECG.
- Mars 2019 – Dans le cadre du budget de 2019, on a annoncé un soutien pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars à l’intention des producteurs laitiers et des producteurs de volaille et d’œufs afin qu’ils puissent faire face aux répercussions de l’AECG et du PTPGP.
- Août 2019 – Le Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers est annoncé, fournissant jusqu’à 1,75 milliard de dollars aux producteurs laitiers, et l’année 1 du programme est lancée.
- Novembre 2020 – Un financement de 691 milliards de dollars pour deux nouveaux programmes est annoncé pour soutenir les producteurs de volaille et d’œufs.
- Avril 2021 – Dans le cadre du budget de 2021, on a annoncé un investissement de 292,5 millions de dollars par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement à l’intention des transformateurs pour la gestion de l’offre, et on a réitéré l’engagement à fournir une indemnisation dans le contexte de l’ACEUM.
Situation actuelle : AECG/PTPGP
Depuis avril 2021, tous les programmes d’indemnisation à l’intention des producteurs mis en place dans le contexte de l’AECG et du PTPGP ont été lancés, à l’exception du fonds d’investissement à l’intention des transformateurs.
Un engagement préliminaire auprès de l’industrie concernant le fonds d’investissement à l’intention des transformateurs a été pris à l’été 2021 et pourrait se conclure cet automne.
L’industrie s’attend à ce que le programme soit lancé au début de 2022.
Situation actuelle : ACEUM
Dans le budget 2021, le gouvernement s'est engagé à verser une indemnisation complète et équitable à l'égard de l'ACEUM et à travailler avec les représentants des secteurs sous gestion de l'offre pour déterminer cette indemnisation.
Pendant la campagne électorale de 2021, le gouvernement s'est engagé à déterminer cette indemnisation au cours de la première année de son mandat.
L’engagement continu auprès du secteur concernant les mesures d’indemnisation prises dans le contexte de l’ACEUM pourrait servir à étayer les approches du programme.
La clarté concernant l’indemnisation dans le contexte de l’ACEUM est une priorité pour les intervenants qui sont concernés par la gestion de l’offre
Autres considérations relatives à l’ACEUM
Les États-Unis ont contesté l’allocation, par le Canada, de contingents tarifaires pour les produits laitiers en vertu de l’ACEUM, alléguant que l’attribution, par le Canada, d’une proportion importante des contingents tarifaires aux transformateurs viole nos engagements pris dans le cadre de l’ACEUM.
- Le Canada est convaincu que nous sommes pleinement en conformité avec nos obligations.
- Le processus de règlement du différend devrait se conclure en décembre 2021.
Affaires mondiales Canada (AMC) entreprend un examen complet de l’administration des contingents tarifaires pour toutes les marchandises du Canada qui font l’objet de la gestion de l’offre.
L’ACEUM est unique, car il impose également des droits de douane sur les exportations canadiennes de concentrés de protéines de lait et de lait écrémé en poudre au-delà des seuils spécifiés.
Cela pourrait avoir une incidence sur un problème de longue date au sein de l’industrie concernant les excédents structurels de lait écrémé en poudre.
Prochaines étapes
- Confirmer la voie à suivre pour le fonds d’investissement à l’intention des transformateurs dans le contexte de l’AECG et du PTPGP et l’indemnisation dans le contexte de l’ACEUM.
- Poursuivre l’engagement auprès du secteur sur les répercussions des accords commerciaux et les approches adoptées pour l’élaboration de programmes.
Annex A: Aperçu du secteur
Produits laitiers
- Le Canada compte 10 095 fermes laitières, la majorité d’entre elles (80 %) se trouvant en Ontario et au Québec.
- Recettes monétaires agricoles en 2020 = 7,13 milliards de dollars
- Revenu net moyen d’exploitation en 2019 = 164 892 dollars
Volaille et œufs
- Le Canada compte 2 837 producteurs de poulet, 515 producteurs de dindons, 236 producteurs d’œufs d’incubation de poussins de chair et 1 205 producteurs d’œufs au Canada, la majorité d’entre eux (62 %) se trouvant en Ontario et au Québec.
- Recettes monétaires agricoles en 2020 = 4,89 milliards de dollars
- Revenu net moyen d’exploitation en 2019 = 203 156 dollars
Secteur de la transformation
- Le Canada compte environ 514 transformateurs laitiers et 460 usines de transformation de la volaille et des œufs au Canada, dont la majorité est située en Ontario et au Québec.
- Livraisons manufacturières = 25,4 milliards de dollars (17,3 milliards de dollars pour les produits laitiers et 8,1 milliards de dollars pour la volaille et les œufs).
- Emploi dans l’industrie de la transformation laitière = 24 500 personnes (chiffres déclarés par l’industrie).
- Emploi dans l’industrie de la transformation de la volaille et des œufs = Plus de 28 000 personnes (chiffres déclarés par l’industrie).
Annexe B
Programmes d’indemnisation à l’intention des producteurs laitiers
Programme d’investissement pour fermes laitières (PIFL), 2017–2018 à 2022–2023
Le programme d’indemnisation dans le contexte de l’AECG est conçu pour soutenir les investissements à la ferme afin d’améliorer l’efficacité.
Ce programme, d’une durée de six ans et doté de 250 millions de dollars, a été lancé en août 2017.
En date de juillet 2021, 3 428 demandes de producteurs avaient été approuvées, pour un montant total de près de 230 millions de dollars.
Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers (PPDPL), 2019–2020 à 2022–2023
Le programme d’indemnisation dans le contexte de l’AECG et du PTPGP offre un financement directement aux producteurs laitiers d’après les quotas qu’ils détiennent (c.-à-d. la taille de la ferme).
Par exemple, au cours de la première année, les fermes comptant 80 vaches laitières ont reçu environ 28 000 $, et les fermes comptant 100 vaches ont reçu environ 35 000 $.
Ce programme, d’une durée de quatre ans et doté de 1,75 milliard de dollars, a été lancé en août 2019.
- 345 millions de dollars en 2019-2020 – Versés
- 468 millions de dollars en 2020-2021 – Versés
- 469 millions de dollars en 2021-2022 – À verser
- 468 millions de dollars en 2022-2023 – À verser
Les programmes reposent sur les recommandations de l’industrie en matière d’indemnisation.
Programmes d’indemnisation à l’intention des producteurs de volaille et d’œufs
Programme d’investissement à la ferme pour la volaille et les œufs, 2021–2022 à 2030–2031
Programme d’indemnisation dans le contexte du PTPGP, qui soutient les investissements à la ferme.
Ce programme, d’une durée de 10 ans et doté de 647 millions de dollars, a été lancé en mai 2021.
Le financement sera attribué comme suit :
- 347,3 millions de dollars pour les producteurs de poulet.
- 76,9 millions de dollars pour les producteurs de dindon.
- 134 millions de dollars pour les producteurs d’œufs.
- 88,6 millions de dollars pour les producteurs d’œufs d’incubation de poussins de chair.
Le programme et l’attribution des fonds sont fondés sur des recommandations formulées par l’industrie.
Programme de développement des marchés, 2021–2022 à 2030–2031
Le programme d’indemnisation dans le contexte du PTPGP aidera à faire augmenter la demande intérieure de produits de volaille grâce à des activités promotionnelles.
Ce programme, d’une durée de 10 ans et doté de 44,2 millions de dollars, a été lancé en avril 2021.
- 19,2 millions de dollars sont destinés aux Éleveurs de dindon du Canada.
- 25 millions de dollars sont destinés aux Producteurs de poulets du Canada.
Le programme et l’attribution des fonds sont fondés sur des recommandations formulées par l’industrie.
Programmes d’indemnisation à l’intention des transformateurs dans le cadre de la gestion de l’offre
Fonds d’investissement dans la transformation des produits laitiers, 2017–2018 à 2020–2021
Les programmes d’indemnisation à l’intention des transformateurs laitiers permettront d’améliorer la productivité et la capacité concurrentielle et contribuera à leur préparation à l’évolution du marché résultant de la signature de l’AECG.
Ce programme, d’une durée de quatre ans et doté de 100 millions de dollars, a été lancé en août 2017. Le programme a récemment été prolongé jusqu’en mars 2022*, afin d’aider les demandeurs qui sont confrontés à des retards en raison de la COVID-19.
Jusqu’à présent, plus de 105 projets ont été approuvés, pour un engagement total de 87,35 millions de dollars.
Fonds d’investissement à l’intention des transformateurs, 2021-2022 – 2026-2027, à confirmer
Le programme d’indemnisation dans les contextes de l’AECG et du PTPGP est destiné à soutenir les investissements privés dans les usines de transformation dans le cadre de la gestion de l’offre.
Ce programme, d’une durée de sept ans et doté de 292,5 millions de dollars, a été annoncé dans le budget de 2021 et devrait être lancé au début de 2022.
Agriculture et Agroalimentaire Canada sollicite actuellement la contribution de l’industrie à la conception du programme.
Les programmes reposent sur les recommandations de l’industrie en matière de compensation.
-
Programmes de gestion des risques de l’entreprise
L’approche du Canada pour soutenir le secteur est axée sur des objectifs de croissance économique et l’octroi d’une aide aux producteurs pour la gestion des risques importants
Risques liés à la production
- La géographie du Canada entraîne des risques météorologiques.
- Courte saison de croissance.
- Changements climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes* (p. ex. sécheresses, inondations).
Les maladies et les ravageurs peuvent également entraîner des pertes importantes.
Risques liés au marché
Puisqu’ils appartiennent à un secteur dépendant des exportations, les producteurs canadiens sont vulnérables à la volatilité des marchés mondiaux.
- Perturbations de l’approvisionnement et de la demande à l’échelle mondiale (p. ex. sécheresse aux É.-U.).
- Fluctuations du taux de change.
- Politiques gouvernementales étrangères et barrières commerciales (p. ex. importation de canola en Chine).
- Forte dépendance à l’égard des intrants énergétiques (p. ex. pétrole, engrais).
Capacité des producteurs
Afin d’atténuer les risques cernés, les producteurs peuvent adopter des stratégies d’atténuation des risques (p. ex. variétés de cultures, assurance).
- L’accessibilité des outils de gestion des risques du secteur privé peut être limitée en raison des risques aigus auxquels fait face le secteur.
Gestion efficace des risques
Les risques sectoriels peuvent entraîner de lourdes pertes et menacer la viabilité des producteurs. Au fil du temps, les partenaires fédéraux-provinciaux-territoriaux (FPT) ont appuyé les producteurs en :
- Continuant d’offrir aux producteurs une série de programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) dont la portée est exhaustive et qui aident à gérer efficacement les répercussions des pertes de production, des cas graves d’instabilité des marchés, des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes;
- Favorisant la mise au point d’outils de gestion des risques dans le secteur privé;
- Appuyant les activités d’atténuation proactives qui améliorent la résilience du secteur (p. ex., Systèmes d’assurance, traçabilité, promotion de solutions par la science et l’innovation);
- Reconnaissant que, pour certains produits, la gestion de l’offre est un important outil de GRE.
Toutes ces approches de gestion des risques favorisent la croissance et la stabilité du secteur, stimulent les investissements et renforcent la confiance à l’égard de l’agriculture canadienne.
Les producteurs ont accès à un ensemble complémentaire d’outils de gestion des risques de l’entreprise
La série actuelle comprend les programmes FPT partagés suivants :
- Agri-protection offre une assurance à frais partagés contre les catastrophes naturelles pour certains produits afin de réduire les répercussions financières des pertes de production ou d’actifs (moyenne supérieure à 1 milliard de dollars de soutien par année).
- Agri-stabilité offre un soutien lorsque les producteurs subissent une forte baisse de leur marge (moyenne d’environ 320 millions de dollars de soutien par année).
- Agri-investissement offre des liquidités pour aider les producteurs à gérer les baisses de revenu (environ 270 millions de dollars de soutien par année).
- Le cadre Agri-relance aide les producteurs à reprendre leurs activités à la suite d’une catastrophe naturelle.
Dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA), les programmes de GRE ont fourni jusqu’à 1,6 milliard de dollars par année en moyenne pour appuyer les producteurs.
Voir l’annexe 2 pour plus de détails sur les programmes.
Autres programmes de gestion des risques de l’entreprise
Les programmes de gestion des risques relevant exclusivement du gouvernement fédéral comprennent ce qui suit :
- Agri-risques appuie l’élaboration de nouveaux outils de gestion des risques dirigés par le secteur privé (financement total du programme de 55 millions de dollars sur cinq ans).
- Le Programme de paiements anticipés est un programme de garantie de prêt qui donne aux producteurs un accès facile à des avances de fonds à faible taux d’intérêt pour appuyer la souplesse de la mise en marché (une moyenne de 2 milliards de dollars de soutien par année).
- Le Programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles constitue une garantie de prêt conçue pour accroître l’accessibilité des prêts aux agriculteurs afin de les aider à créer, à améliorer et à développer leurs exploitations agricoles (en moyenne 100 millions de dollars de soutien par année).
Programme propre au bétail (Ouest canadien) :
- L’assurance des prix du bétail (APB) permet aux producteurs de bovins et de porcs de contracter une assurance contre les baisses de prix imprévues, offrant une protection contre la volatilité du marché. Les producteurs paient 100 % des primes, tandis que les gouvernements FPT paient les coûts d’administration et le financement du déficit d’assurance couvert par le Canada (primes de l’APB de 2020 : 24,1 millions de dollars).
Les programmes de GRE aident les producteurs à gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation et qu’ils ne peuvent affronter seuls.
Soutien financier de la série de programmes de GRE — Exemple 1
Cultures endommagées par les inondations printanières dans une exploitation du Manitoba
Le défi: Bob et Marcie dirigent une exploitation de 2 500 acres de céréales et d’oléagineux dans le sud du Manitoba. Cette année, la région où se situent leurs activités agricoles a subi de graves inondations printanières, laissant 1 500 acres sous l’eau et non ensemencés. Bob et Marcie ont épandu de l’engrais à l’automne et ont déjà prépayé la plupart de leurs herbicides et pesticides.
En raison de ces événements, l’exploitation subira une baisse de revenus de 330 000 dollars, ce qui laissera une marge de production négative de 30 400 dollars.
Bob et Marcie utilisent toute la gamme d’outils de GRE à leur disposition :
- Ils contribuent régulièrement à Agri-investissement,
- Ils ont une assurance-récolte, qui comprend une assurance contre l’humidité excessive d’Agri-protection,
- Ils sont inscrits au programme Agri-stabilité.
Situation financière de l’exploitation Année moyenne ($) Année catastrophique ($) Vente de céréales 550 000 220 000 Total de dépenses 290 000 250 400 Marges Marge de référence 260 000 Marge de production (30 400) Un producteur est admissible à un paiement d’Agri-stabilité si la marge de production de l’année en cours est inférieure de plus de 30 % à sa marge de référence historique.
Bob et Marcie ont reçu 105 000 dollars en indemnités pour les acres non ensemencés au titre de l’assurance contre l’humidité excessive d’Agri-protection. Cette indemnité sera comptabilisée comme un revenu dans l’établissement d’un paiement d’Agri-stabilité.
Ils ont également reçu un soutien de 75 180 dollars d’Agri-stabilité.
Ils ont accès à un total de 25 200 dollars dans le cadre d’Agri-investissement :
- Ils ont actuellement un solde de compte de 22 000 dollars qu’ils peuvent retirer.
- Ils sont également admissibles à une contribution gouvernementale de contrepartie de 3 200 dollars.
($) Indemnités d’Agri-protection 105,000 Paiement d’Agri-stabilité 75,180 Paiement d’Agri-investissement 25,200 Soutien total des programmes de GRE 205,380 Marge de production de l’année catastrophique (30,400) Marge de production de l’année catastrophique, y compris les paiements de programme 174,980 Soutien financier de la série de programmes de GRE — Exemple 2
Le défi: Lindsey a une exploitation de pommes de terre de 240 acres. Cette année, les chaînes de restauration rapide ont réduit la taille des portions dans leurs restaurants en réponse à la demande des consommateurs. Lindsey a remarqué une baisse de la demande de pommes de terre et une baisse importante du prix de sa nouvelle récolte de pommes de terre.
- En raison de ces événements, l’exploitation subira une baisse de revenus de 300 960 dollars ce qui lui laissera une marge de production négative de 45 040 dollars.
- Lindsey a contribué régulièrement à Agri-investissement et est inscrite à Agri-stabilité.
- La perte de revenus découle d’une baisse des prix, et non d’une perte de production. Par conséquent, Agri-protection ne s’applique pas.
Farm financials Année moyenne ($) Année catastrophique ($) Ventes de pommes de terre 792 000 491 000 Total de dépenses 446 000 446 000 Marges Marge de référence 346 000 Marge de production (45 040) Un producteur est admissible à un paiement d’Agri-stabilité si la marge de production de l’année en cours est inférieure de plus de 30 % à sa marge de référence historique.
- Lindsey a reçu un paiement de 138 012 dollars au titre d’Agri-stabilité.
Lindsey a accès à 33 300 dollars au titre d’Agri-investissement :
- Elle a actuellement un solde de compte de 29 000 dollars qui peut être retiré.
- Elle est également admissible à une contribution de contrepartie du gouvernement équivalente à 4 300 dollars cette année.
($) Paiement d’Agri-stabilité 138 012 Paiement d’Agri-investissement 33 300 Soutien total des programmes de GRE 171 312 Marge de production de l’année catastrophique 45 040 Marge de production de l’année catastrophique, y compris les paiements de programme 216 352 Évaluations des programmes de GRE
Les programmes de GRE ont été évalués par rapport aux objectifs des programmes à plusieurs reprises, notamment au moyen d’examens internes et externes.
Voici ce que les examens ont mis en évidence :
- La série de programmes de GRE répond à bon nombre de ses objectifs, mais des améliorations aux programmes individuels sont nécessaires pour améliorer la synergie et la réponse globale.
- Il y a des problèmes d’inscription et un manque de confiance à l’égard d’Agri-stabilité en raison de sa complexité et de son manque de rapidité et de prévisibilité. ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ Les récents changements ont permis de relever certains de ces défis, en particulier l’équité et la complexité.
- Agri-protection est simple, prévisible et offre une réponse rapide, ce qui explique sa popularité auprès des producteurs. Cependant, comme il est propre à certains produits, il offre un soutien pour des pertes normales par rapport au revenu de l’ensemble de l’exploitation et est surtout accessible aux producteurs agricoles seulement.
- Agri-investissement fournit un soutien prévisible chaque année, ce qui explique sa popularité auprès des producteurs. Cependant la conception du programme permet l’utilisation du soutien à des fins autres que la gestion des risques.
D’autres analyses externes sont en cours pour déterminer comment améliorer les programmes, en particulier Agri-stabilité.
Améliorations apportées au programme Agri-stabilité dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture
Les gouvernements FPT continuent de travailler à l’amélioration des programmes de GRE et ont convenu de ce qui suit :
- Simplification de l’inscription et établissement de mécanismes de participation tardive dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA);
- Modification des paramètres du programme en 2021, c.-à-d. élimination de la limite de la marge de référence (calcul compliqué qui limite les paiements); les changements ont rendu le programme plus adapté à tous les types d’exploitations agricoles.
D’autres améliorations sont toujours à l’étude aux fins suivantes :
- Améliorer davantage Agri-stabilité en faisant passer le taux d’indemnisation de 70 % à 80 %.
- À l’heure actuelle, le soutien des provinces est insuffisant, bien qu’un certain nombre d’entre elles aient procédé au changement sur le plan provincial.
- Les gouvernements FPT évaluent actuellement d’autres approches possibles pour les futurs programmes de GRE :
- Modifications importantes apportées au programme Agri-stabilité.
- Transition vers un programme d’assurance des revenus ou des marges pour l’ensemble de l’exploitation agricole.
Points de vue des intervenants
Bien que la série de programmes de GRE permette de répondre aux besoins et aux crises du secteur, comme la sécheresse actuelle (Agri-relance), les pressions exercées pour que les programmes s’adaptent aux risques changeants auxquels fait face le secteur demeurent (p. ex., changements climatiques, incertitude du commerce international, main-d’œuvre, pandémies).
Les intervenants sont surtout critiques à l’égard d’Agri-stabilité, mais ils demeurent fortement en faveur d’Agri-protection et d’Agri-investissement parce que ces programmes sont simples, faciles à comprendre et offrent une réponse rapide.
Les principaux objectifs de GRE mis en évidence par les intervenants comprennent l’abordabilité, l’efficacité, la souplesse, la prévisibilité et l’importance de règles du jeu équitables avec les concurrents de l’étranger.
- Les intervenants insistent également sur le rôle que jouent les programmes de GRE en fournissant aux producteurs des liquidités qui leur permettent de s’adapter aux conditions changeantes du marché et à tirer profit des possibilités.
Les intervenants souhaitent participer directement à la conception des politiques et des programmes de GRE, en partie par l’entremise du Comité consultatif national sur les programmes.
Regard sur l’avenir
Compte tenu des niveaux de financement et du lien direct avec les producteurs, la GRE est une grande priorité pour les provinces et les territoires, et constitue un sujet de discussion à la plupart des réunions FPT.
Les améliorations apportées à la série dans son ensemble et à chaque programme sont en cours d’évaluation.
Des options d’amélioration des programmes seront fournies pour faire progresser les discussions avec les provinces et les territoires; elles seront probablement fortement prises en compte dans les conversations sur le prochain cadre stratégique.
Annexe 1 – Principes de GRE
Treize principes guident l’ensemble des programmes de GRE, y compris ceux qui favorisent la simplicité, la prévisibilité et l’équité.
Voici quelques-uns des principes les plus fréquemment cités :
- Les programmes doivent être compatibles avec les obligations internationales du Canada en matière de commerce et réduire au minimum le risque de mesures compensatoires.
- Les programmes doivent avoir un objectif clair et être détaillés, prévisibles ainsi que faciles à comprendre et à administrer.
- Les programmes doivent contribuer à la stabilité de l’ensemble de l’exploitation agricole.
- Les ressources financières du Canada doivent servir à fournir, au fil du temps, la même protection aux agriculteurs dans des circonstances similaires.
Annexe 2 – Aperçu des programmes de GRE
Agri-protection
Protection contre les risques naturels (c.-à-d. sécheresse, inondation, vent, gel, pluies ou chaleur excessives, neige, pertes causées par des maladies incontrôlables, infestation d’insectes et animaux sauvages).
- Offre une protection contre les baisses de production attribuables à des risques naturels (p. ex. vent, gel, pluies ou chaleur excessives, neige, maladies et ravageurs)
- Les régimes d’assurance sont conçus par les administrations provinciales pour répondre aux besoins régionaux :
- Les provinces surveillent l’industrie (p. ex., nouvelles cultures, nouvelles techniques de production) et répondent aux besoins des producteurs en élaborant ou en adaptant des régimes d’assurance qui comblent les lacunes dans la couverture.
- Les producteurs choisissent les produits à assurer, le type de programme et le niveau de couverture, et les gouvernements paient une partie du coût des primes.
- En général, 60 % des primes sont payées par les gouvernements, et ceux-ci couvrent la totalité des coûts d’administration du programme.
- Des indemnités sont versées lorsque le volume ou la qualité de la production tombe en deçà du niveau de production assuré.
Partage des coûts du programme
- Producteur, 40 %
- Fédéral, 36 %
- Provincial, 24 %
Exécution du programme
- Provincial : Colombie Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île du Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador
Paiements FPT à 3 août 2021 ($) Cultivons l’avenir 2 (2013-2017) 5 171 822 278 Partenariat canadien pour l’agriculture (depuis 2018) 2 966 069 638 Domaines de couverture ciblés - Aide d’agri-protection Aide d’agri-protection Fluctuations des prix du marché Non Flux de trésorerie des exploitations Non Augmentation des dépenses Non Pertes de production ou de qualité Oui Investissements dans les outils de gestion des risques Non Investissements dans les exploitations agricoles Non Agri-stabilité
Programme individuel fondé sur la marge qui aide à faire face aux baisses importantes de la marge causées par la forte volatilité du marché et les catastrophes.
- Offre un soutien aux producteurs dont la marge diminue considérablement (plus de 30 %) au cours d’une année donnée par rapport à leurs marges historiques.
- Le paiement représente 70 % des pertes au-delà d’une marge de référence.
- Couvre tous les principaux risques liés au revenu d’une exploitation agricole dans le cadre d’un programme (c.-à-d. perte de revenu attribuable à des problèmes de production, baisse des prix des produits de base ou augmentation des coûts des intrants).
- La couverture est offerte pour la plupart des produits agricoles et est adaptée aux circonstances individuelles.
- Agri-stabilité a versé plus de 2,4 milliards de dollars aux producteurs depuis 2013.
Partage des coûts de programme
- Fédéral, 60%
- Provincial, 40%
Exécution du programme
- Fédéral : Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador
- Provincial : Colombie Britannique, Alberta, Saskatchewan, Île du Prince-Édouard, Ontario, Québec
Paiements FPT à 3 août 2021 ($) Cultivons l’avenir 2 (2013-2017) 1 607 553 449 Partenariat canadien pour l’agriculture (depuis 2018) 846 957 745 Domaines de couverture ciblés Aide d’Agri-stabilité Aide d’Agri-stabilité Fluctuations des prix du marché Oui Flux de trésorerie des exploitations Non Augmentation des dépenses Oui Pertes de production ou de qualité Oui Investissements dans les outils de gestion des risques Non Investissements dans les exploitations agricoles Non Agri-investissement
Compte d’épargne avec contribution de contrepartie du gouvernement pour faire face aux baisses de revenu ou faire des investissements permettant de gérer les risques à la ferme.
- Un compte d’épargne des producteurs, auquel les gouvernements contribuent :
- Les contributions sont fondées sur les ventes nettes admissibles (VNA) d’un producteur – ventes moins les achats de produits admissibles (p. ex., ventes de fleurs ou d’arbres moins les achats de semences ou de semis).
- Les producteurs peuvent déposer jusqu’à 100 % de leurs VNA chaque année, dont le premier 1 % est égalé dollar par dollar par les gouvernements (jusqu’à 10 000 $).
- Il faut d’abord retirer les contributions gouvernementales, qui sont imposables au moment du retrait.
- Il n’y a pas de déclencheur de retrait — les producteurs gèrent leurs comptes comme bon leur semble.
Il y a plus de 2,4 milliards de dollars dans les comptes Agri-investissement, le solde moyen par compte étant d’environ 26 000 $ (en juin 2021).
Partage des coûts de programme
- Fédéral, 60%
- Provincial, 40%
Exécution du programme
- Fédéral, tous les provinces sauf Québec
- Provincial, Québec
Paiments FPT à 3 août, 2021 ($) Cultivons l’avenir 2 (2013-2017) 1 391 273 064 Partenariat canadien pour l’agriculture (depuis 2018) 573 770 937 Domaines de couverture ciblés Aide d’Agri-investissement Aide d’Agri-investissement Fluctuations des prix du marché Oui Flux de trésorerie des exploitations Oui Augmentation des dépenses Oui Pertes de production ou de qualité Oui Investissements dans les outils de gestion des risques Oui Investissements dans les exploitations agricoles Oui Agri-relance
Cadre FPT qui facilite la mise en œuvre des mesures d’intervention élaborées par les gouvernements fédéral et provinciaux en cas de catastrophes naturelles, d’infestations de ravageurs ou d’éclosions.
Mécanisme permettant aux gouvernements FPT d’élaborer des initiatives individuelles pour faire face à des catastrophes particulières selon des critères prédéfinis.
Le cadre prévoit :
- un protocole pour l’interaction FPT;
- une définition de la catastrophe pour pouvoir déterminer lorsqu’une intervention est justifiée;
- des lignes directrices sur le type d’aide à fournir.
Vise à aider à assumer les coûts exceptionnels nécessaires pour la relance après une catastrophe, et non à remplacer la protection offerte par les programmes Agri-protection, Agri-stabilité et Agri-investissement.
Ne vise pas à fournir un aide en cas de catastrophes récurrentes, car une catastrophe récurrente pourrait indiquer qu’il faut chercher des options à plus long terme.
Le gouvernement fédéral s’est récemment engagé à fournir jusqu’à 525 millions de dollars dans le cadre d’initiatives d’Agri-relance pour aider les producteurs aux prises avec des coûts supplémentaires en raison de la sécheresse et de la pandémie de COVID-19 (y compris les programmes de retrait temporaire pour les producteurs de bovins et de porcs).
Partage des coûts de programme
- Fédéral, 60%
- Provincial, 40%
Exécution du programme
- Fédéral : au cas par cas
- Provincial : Colombie Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île du Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador
Paiments FPT à 3 août, 2021 ($) Cultivons l’avenir 2 (2013-2017) 36 963 863 Partenariat canadien pour l’agriculture (depuis 2018) 61 479 960 Domaines de couverture ciblés - Aide d’Agri-relance Aide d’Agri-relance Fluctuations des prix du marché Non Flux de trésorerie des exploitations Non Augmentation des dépenses Oui Pertes de production ou de qualité Non Investissements dans les outils de gestion des risques Non Investissements dans les exploitations agricoles Non Initiatives Agri-risques
Financement de la recherche, du développement et de la mise en œuvre de produits d’assurance nouveaux et adaptés et d’autres outils de gestion des risques du secteur privé.
Les initiatives Agri-risques constituent un programme quinquennal de 55 millions de dollars.
Deux volets de financement de projets :
- Volet 1 — Recherche et développement : appuie les projets liés à l’élaboration d’outils ou de stratégies de gestion des risques agricoles.
- Microsubventions : fournissent du financement pour des propositions de recherche universitaire qui explorent d’autres outils de gestion des risques ou proposent différentes façons de régler les problèmes liés aux programmes de GRE existants.
- Volet 2 — Renforcement des capacités administratives : appuie la mise en œuvre d’outils ou de stratégies de gestion des risques agricoles qui ont déjà été élaborés en fournissant une aide financière pour les frais et les activités de démarrage.
Domaines de couverture ciblés - Aide d’Agri-risques Aide d’Agri-risques Fluctuations des prix du marché Non Flux de trésorerie des exploitations Non Augmentation des dépenses Non Pertes de production ou de qualité Non Investissements dans les outils de gestion des risques Oui Investissements dans les exploitations agricoles Non -
Environnement et changement climatique
Contexte agroenvironnemental
Le succès du secteur agricole est tributaire des ressources naturelles.
- Il existe de fortes interdépendances entre la productivité et l’écosystème agricole, qui comprend le climat et les conditions météorologiques, l’utilisation des terres et la santé des sols, la qualité et l’utilisation de l’eau, les avantages de la biodiversité et les menaces a son encontre.
Les productions agricoles peuvent avoir des conséquences environnementales importantes.
- Même si les producteurs ont accompli des progrès dans certains domaines (santé des sols, qualité de l’air), il faut mettre plus d’efforts pour renverser des tendances indésirables et réduire les émissions globales de gaz à effet de serre (GES).
Dans la lutte contre le changement climatique, les producteurs rencontrent des défis et des possibilités qui diffèrent de ceux vus dans d’autres secteurs.
- Il existe des obstacles à l'adoption généralisée de pratiques bénéfiques, notamment la gestion des risques pour la production et la garantie que l'adoption de telles pratiques est économiquement viable
Un certain nombre d’initiatives, dont les mesures annoncées dans le cadre du plan climatique renforcé, sont en cours pour mieux soutenir le secteur.
L’importance de la durabilité environnementale
Renforcer la résilience à long terme face au changement climatique et aux risques environnementaux.
- L’amélioration de la résilience des fermes face aux risques environnementaux peut réduire les conséquences et leur permettre de récupérer plus vite après un événement météorologique extrême (comme une sécheresse ou une inondation).
- La conservation des ressources (p. ex. le sol, l’eau) assurera la pérennité du secteur agricole au profit des générations futures.
Soutenir la croissance durable des productions pour répondre à la demande mondiale.
- La demande croissante de produits durables signifie qu'une approche durable sera nécessaire pour tirer parti des opportunités émergentes.
Répondre aux demandes du marché et des consommateurs.
- Les entreprises de transformation alimentaire et de vente au détail prennent des engagements en matière de durabilité qui ont des incidences sur leur chaîne d’approvisionnement.
- Les fournisseurs d’intrants, le secteur et l’industrie prennent des mesures visant à promouvoir l’intendance des ressources et la reddition de compte en matière de durabilité.
Contribution à l’atteinte de résultats plus généraux comme les cibles de réduction des émissions de GES et les objectifs de développement durable du Canada pour 2030 et 2050.
Changement climatique et agriculture canadienne
Le changement climatique posera de plus grands défis au cours des prochaines années et décennies :
- Les changements des régimes de précipitations et l’accroissement des événements météorologiques extrêmes peuvent augmenter les risques d’érosion du sol.
- L’augmentation des vagues de chaleur peut influencer les rendements des cultures, stresser les animaux d’élevage et intensifier les émissions de gaz à effet de serre.
- Il y aura une augmentation de la fréquence des flambées de ravageurs et de maladies.
Les températures hivernales et printanières plus chaudes pourraient être bénéfiques pour la productivité des productions végétales et animales dans certaines régions
Changements prévus des régimes de précipitations (2040-2070) 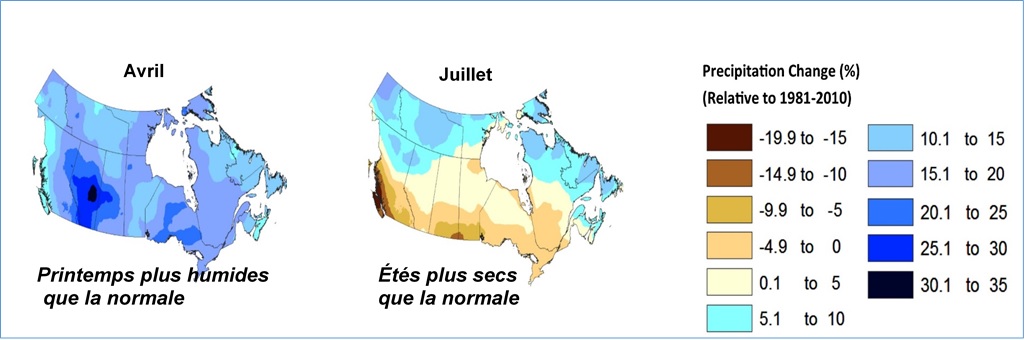
La description de l'image ci-dessus.
Deux cartes météorologiques comparatives du Canada : la première carte montre que le Canada connaîtra des printemps plus humides que la normale (entre 5 % à 10 % et 30 % à 35 % de précipitations en plus par rapport à 1981 à 2010); la deuxième carte montre que le Canada connaîtra des étés plus secs que la normale (entre 5 % et 10 % de précipitations en plus et 15 % à 20 de précipitations en moins par rapport à 1981 à 2010).
Profil des émissions agricoles au Canada
Les émissions agricoles – 10 % des émissions canadiennes globales – sont stables depuis les années 1990.
Malgré l’accroissement de la production, les efforts de l’industrie ont pu réduire les émissions par unité de production au fil du temps, mais sans autres interventions, les émissions globales augmenteront et la séquestration de carbone diminuera.
Les émissions agricoles sont en majorité d’origines biologiques, attribuables aux productions végétales et animales.
Les technologies actuelles limitent les possibilités de réduction absolue des émissions.
Émissions et absorptions : observées et projetées 
Sources : RIN 2020 et RB4 du Canada
La description de l'image ci-dessus.
Émissions et absorptions : observées et projetées Graphique à barres qui compare les émissions provenant du bétail de 2005 à 2030 (qui étaient de 44 mégatonnes en 2005 et devraient se situer à 37 mégatonnes en 2030), ensuite celles des récoltes (qui s’établissaient à 16 mégatonnes en 2005 et devraient atteindre 26 mégatonnes en 2030), puis celles de la consommation de carburant (qui se situaient à 12 mégatonnes en 2005 et devraient se chiffrer à 13 mégatonnes en 2030) et enfin l’absorption du carbone par le sol (qui était de moins 11 mégatonnes en 2005 et devrait être ramenée à moins 1,5 mégatonne en 2030).
Risques environnementaux — santé des sols
- L’érosion et la compaction des sols ainsi que la perte de biodiversité ont des incidences négatives sur la production.
- L’adoption à la ferme de pratiques bénéfiques à la santé des sols et de solutions climatiques naturelles peut améliorer la santé des sols au Canada, la séquestration du carbone et la résilience face aux événements climatiques comme les sécheresses.
- Les terres agricoles dans les provinces des Prairies sont passées d’émettrices nettes de carbone à des terres qui séquestrent du carbone entre 1996 et 2011, mais elles ont maintenant atteint un plateau.
- Des améliorations importantes ont été obtenues par l’adoption de pratiques bénéfiques pour la santé des sols, comme le travail réduit du sol.
- Le potentiel de séquestration de carbone est plus faible dans l’est du Manitoba, où les pratiques de travail du sol sont différentes en raison des conditions plus humides.
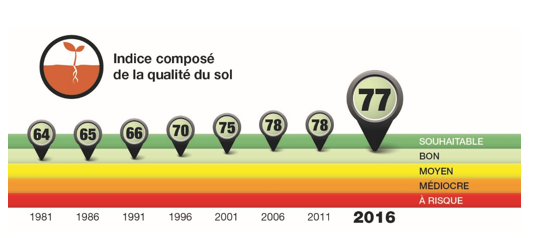
La description de l'image ci-dessus.
Indice composé de la qualité du sol Année Valeur de l'indice Cote* 1981 64 Bon 1986 65 Bon 1991 66 Bon 1996 70 Bon 2001 75 Bon 2006 78 Bon 2011 78 Bon 2016 77 Bon *Cote :
- 0 à 20, À risque;
- 20 à 40, Médiocre;
- 40 à 60, Moyen;
- 60 à 80, Bon;
- 80 à 100, Souhaitable.
Risques environnementaux — eau
L’eau est une ressource essentielle en agriculture.
- Les activités agricoles ont des conséquences sur la qualité de l’eau (p. ex. les éléments nutritifs, les pesticides) et la qualité de l’eau peut avoir des conséquences sur les productions végétales (p. ex. la salinisation des sols) et les productions animales (p. ex. la productivité, les maladies).
Le secteur agricole est le plus grand « utilisateur-consommateur » d’eau – un fait qui interpelle le public.
- De 2012 à 2018, les conditions d’assèchement se sont traduite par une augmentation de 74% de la quantité d’eau utilisée pour l’irrigation des champs au Canada et de 17% de la superficie globale irriguée.
- À mesure que les provinces voudront augmenter les superficies irriguées, en particulier dans les Prairies, il y aura une concurrence accrue avec les autres utilisateurs pour les ressources limité en eau douce.
Le changement climatique aura des conséquences sur les productions agricoles et les ressources en eau
- L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements météorologiques extrêmes (p. ex. inondations et sécheresses) aggravera l’érosion et le ruissellement, et fera augmenter la demande de drainage, d’irrigation et de meilleur aménagement de stockage de l’eau sur place.
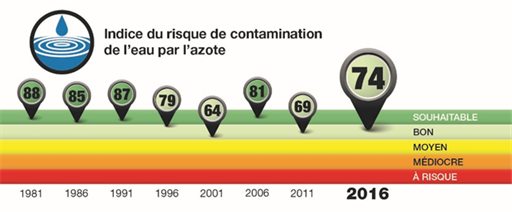
La description de l'image ci-dessus.
Indice du risque de contamination de l’eau par l’azote Année Valeur de l'indice Cote* 1981 88 Souhaitable 1986 85 Souhaitable 1991 87 Souhaitable 1996 79 Bon 2001 64 Bon 2006 81 Souhaitable 2011 69 Bon 2016 74 Bon Indice :
- 0 à 20, À risque;
- 20 à 40, Médiocre;
- 40 à 60, Moyen;
- 60 à 80, Bon;
- 80 à 100, Souhaitable.
Risques environnementaux — biodiversité
L’engagement du Canada de protéger 25 % de ses terres d’ici 2025 et de 30 % d’ici 2030 pourrait aider à faire valoir les efforts de conservation dans les paysages agricoles.
En agriculture, la biodiversité se rapporte aux espèces végétales et animales exploitées, à leur diversité génétique ainsi qu’aux organismes vivants (comme les oiseaux, les insectes, les microorganismes, etc.) avec lesquels ils interagissent.
- La biodiversité dans les paysages agricoles améliore la résilience face aux événements météorologiques extrêmes et offre un habitat à des espèces et à des pollinisateurs menacés.
Il est important de lutter contre la perte de biodiversité, car les terres agricoles offrent des habitats à de nombreuses espèces, dont des espèces en péril.
- La perte de biodiversité est attribuable à la diminution des superficies fourragères et pâturées, à l’augmentation des superficies exploitées en cultures annuelles et à l’extension urbaine dans le centre du Canada – malgré des efforts de programmes.
- Le déploiement d’efforts pour promouvoir l’adoption de solutions climatiques axées sur la nature (p. ex. les prairies, l’agroforesterie) pourrait contribuer à améliorer la conservation des habitats en régions rurales.
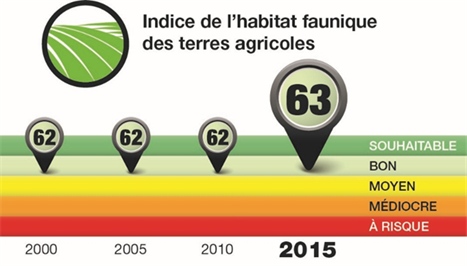
La description de l'image ci-dessus.
Indice de l’habitat faunique des terres agricoles Année Valeur de l'indice Cote* 2000 62 Bon 2005 62 Bon 2010 62 Bon 2015 63 Bon Cote :
- 0 à 20, À risque;
- 20 à 40, Médiocre;
- 40 à 60, Moyen;
- 60 à 80, Bon;
- 80 à 100, Souhaitable.
Science d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) soutenant la durabilité environnementale
AAC collabore à des travaux scientifiques avec les acteurs d’autres ministèresfédéraux, des provinces et des territoires et d’autres organismes pour soutenir le secteur.
- Recherche sur les productions végétales et animales pour les adapter aux changements climatiques et à en atténuer les effets.
- Obtention de cultures céréalières plus tolérantes à la sécheresse et fixatrices d’azote, développement de la génomique et mise au point d’additifs alimentaires pour le bétail qui génèrent moins d’émissions.
- Mise au point de pratiques de gestion bénéfiques à l’amélioration de la durabilité des productions végétales et animales.
- Évaluation et adoption de technologies et de pratiques pour protéger et conserver les ressources et améliorer l’efficacité d’utilisation des intrants
- Irrigation à dose variable, fertilisation de précision.
- Activités de transfert de connaissances pour accélérer l’adoption et l’innovation.
- Mise au point de technologies de surveillance, d’évaluation et de prévisions et d’outils d’aide à la décision.
- Outil de surveillance de la sécheresse; prévisions du rendement des cultures; service d’information sur les sols du Canada.
Mesures clés d’AAC soutenant la durabilité environnementale
Le programme de Solutions agricoles pour le climat soutiendra le secteur de l’agriculture en atténuant le changement climatique par des solutions climatiques axées sur la nature :
- 185 millions de dollars sur dix ans pour soutenir la mise en œuvre de « Laboratoires vivants » au Canada;
- 200 millions de dollars sur trois ans pour encourager l’adoption immédiate de mesures climatiques à la ferme dans les domaines des cultures de couverture, de la gestion de l’azote et des pâturages en rotation.
Le Programme des technologies propres en agriculture offrira 167,5 millions de dollars sur sept ans pour soutenir le développement et l’adoption de technologies propres :
- Il comprend des investissements ciblés pour encourager l’acquisition de séchoirs à grains plus efficaces et l’alimentation en énergie propre des fermes.
La cible nationale vise à réduire les émissions absolues associées aux apports d'azote de synthèse de 30 % sous les niveaux de 2020 d’ici 2030 :
- Elle comprend un engagement de mobilisation du secteur pour la mise au point de mesures qui contribueront à atteindre la cible.
La nouvelle Stratégie agroenvironnementale canadienne fournira une orientation à plus long terme sur les thèmes agroenvironnementaux prioritaires, dont la réduction des émissions de GES.
Mesures fédérales-provinciales-territoriales (FPT) soutenant la durabilité environnementale
Collaboration avec les provinces et les territoires par le biais de programmes et d’activités de financement à frais partagés pour soutenir l’éducation et réaliser des activités qui encouragent l’adoption de mesures à la ferme.
- Les programmes à la ferme offerts dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture sont exécutés par les provinces et les territoires (438 millions de dollars sur cinq ans consacrés à des programmes environnementaux FPT).
- Sensibiliser les producteurs aux risques environnementaux (p. ex. les plans agroenvironnementaux), accélérer l’adoption de technologies et de pratiques pour réduire ces risques et faciliter l’adaptation au changement climatique.
Le prochain cadre stratégique (2023-2028) est l’occasion de traiter d’enjeux agroenvironnementaux importants comme :
- l’atténuation du changement climatique et les émissions de GES
- l’adaptation et la résilience
- la santé des sols
- la disponibilité de l’eau
Défis et occasions
La pression monte dans tous les secteurs, y compris en agriculture, pour contribuer aux cibles du Canada en matière de réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre de 40-45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 et de carboneutralité d’ici 2050.
Le principal défi est de conserver une productivité pour répondre à la demande mondiale d’aliments et de bioproduits tout en réduisant considérablement les impacts environnementaux.
Les producteurs cherchent les occasions de contribuer aux mesures d’intendance qui poursuivent les priorités environnementales et d’obtenir une reconnaissance pour les efforts qu’ils y mettent.
- Ils souhaitent participer au marché des crédits de carbone compensatoires et à la production de matières premières à faible consommation d’intrants pour contribuer à la production durable de biocarburants à faible teneur en carbone.
Le soutien du gouvernement à l'adoption de solutions par le secteur est d'une importance cruciale pour réaliser des réductions des émissions de gaz à effet de serre et intensifier les pratiques bénéfique.
Les solutions potentielles doivent être faciles à adopter dans les systèmes de production existants et réduire au minimum le fardeau et les risques pour les producteurs (pertes de rendement et d’extrants, coûts, temps).
Il faut de meilleurs systèmes, notamment en matière de certification et de collecte de données, pour mesurer et démontrer des pratiques durables au pays et à l’étranger.
Événements à venir
Occasions de mobilisation et de collaboration pilotées par AAC :
- Négociation du prochain cadre stratégique (2021-2022)
- Élaboration d’une stratégie agroenvironnementale canadienne (2021-2022)
- Travail avec le secteur pour déterminer une approche qui contribuera à atteindre la nouvelle cible de réduction des émissions associées à l’utilisation d’engrais (2021-2022)
- Prochaines étapes des programmes de développement de nouvelles technologies propres et de soutien à la ferme
Autres engagements pertinents pour le secteur :
- Lancement du Système fédéral de crédits compensatoires pour les émissions de GES ( automne 2021)
- Lancement du Règlement sur les combustibles propres (décembre 2022)
- Initiative « Zéro déchet plastique au Canada » (2021-2022)
- Création d’une Agence canadienne de l’eau (automne 2021 et hiver 2022)
- Retour direct d’une partie des recettes de la tarification de la pollution aux agriculteurs situés dans les territoires administratifs où ce filet de sécurité est appliqué
Engagements et activités de mobilisation internationales à venir :
- Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques – COP26 (novembre 2021)
- Convention sur la diversité biologique – Préparation du cadre de l’après-2020 et élaboration d’un plan d’action pour les espèces en péril dans le secteur agricole (2021-2022)
-
Main-d'œuvre et travailleurs étrangers temporaires
Enjeu
Les pénuries de main-d’œuvre constituent un problème de longue date dans le secteur de l’agriculture et de la production alimentaire et un obstacle à la croissance du secteur.
Malgré les efforts constants de recrutement, certains sous-secteurs (p. ex., horticulture et transformation de la viande) dépendent fortement des travailleurs étrangers temporaires (TET).
La santé et la sécurité des travailleurs et la perception du public du programme des TET ont été exacerbés par la pandémie.
Comme il s’agit d’un enjeu relevant de plusieurs administrations, la résolution des problèmes de main-d’œuvre exigera du leadership de la part d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) ainsi que des partenariats avec d’autres ministères, les gouvernements provinciaux, l’industrie, les groupes syndicaux et d’autres intervenants.
Les types de compétences requises par les employeurs continueront d’évoluer au fur et à mesure que le secteur augmente son adoption de la technologie et met au point ses pratiques de production.
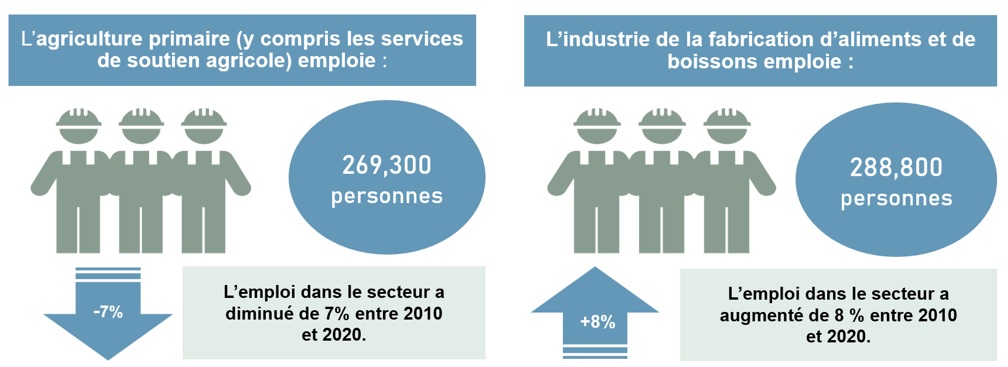
Description de l’image au-dessous
La population active dans les secteurs de la fabrication d’aliments et de l’agriculture primaire
La rubrique Agriculture primaire mentionne qu’il y a 279 400 travailleurs, mais que ce secteur a connu une diminution de l’emploi de 7 % entre 2010 et 2020.
Ensuite, on voit un clipart de travailleurs sous la rubrique Fabrication d’aliments et de boissons, qui signale qu’il y a 288 800 travailleurs, mais que ce secteur a connu une croissance de l’emploi de 8 % entre 2010 et 2020.
L’agriculture primaire a connu une baisse de l’emploi au cours de la dernière décennie, tandis que les recettes monétaires agricoles ont augmenté de façon constante; cette baisse devrait se poursuivre avec l’augmentation de la mécanisation, les progrès technologiques et la consolidation des exploitations agricoles.
L’emploi dans le secteur des aliments et des boissons est demeuré relativement stable au cours de la dernière décennie, tandis que le PIB et les ventes ont augmenté de 13,8 % et de 33 % respectivement; le secteur continue d’affirmer que les pénuries de main-d’œuvre constituent un obstacle à la croissance.
Les postes sont pour la plupart peu et semi-spécialisés, peu rémunérés et ruraux
Les emplois peu et semi-spécialisés représentent la majorité des emplois liés aux cultures (87 %), à la production animale (84 %) et à la transformation des aliments et des boissons (66 %).
En moyenne, les travailleurs agricoles rémunérés gagnent un salaire inférieur à celui d’autres industries, et les salaires dans le secteur de la transformation des aliments sont inférieurs aux salaires moyens dans d’autres secteurs manufacturiers.
La part de l’emploi rural dans les industries de l’agriculture primaire et de la transformation des aliments était de 72 % et de 19 % respectivement, tandis que la part de l’emploi rural était de 17 % et de 15 % dans la fabrication et toutes les autres industries.
Pourcentage des postes hautement spécialisés, 2020 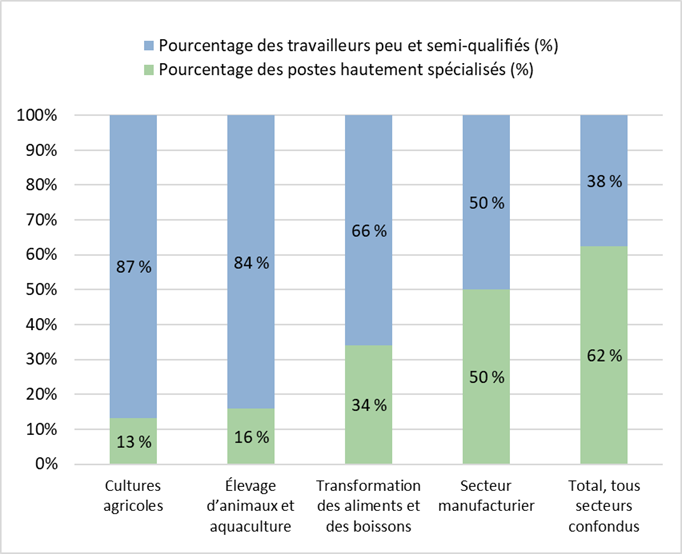
Source : Statistique Canada et calculs d'AAC
La description de l'image ci-dessus.
Pourcentage des postes hautement spécialisés, 2020 Travailleurs peu et semi-qualifiés (%) Postes hautement spécialisés (%) Cultures agricoles 87 13 Élevage d’animaux et aquaculture 84 16 Transformation des aliments et des boissons 66 34 Secteur manufacturier 50 50 Total, tous secteurs confondus 38 62 Les postes sont pour la plupart peu et semi-spécialisés, peu rémunérés et ruraux
Les taux de postes vacants dans le secteur demeurent plus élevés que dans l’ensemble de l’économie, les pénuries chroniques de main-d’œuvre et de compétences ayant une incidence sur de nombreux segments du secteur.
Les taux de postes vacants sont les plus élevés en production végétale; le nombre absolu de postes vacants demeure habituellement stable tout au long de l’année, mais le nombre d’employés salariés augmente du T1 au T4, ce qui entraîne une baisse du taux de postes vacants.
Une forte proportion des postes vacants dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire sont considérés comme du « recrutement constant », en particulier pour les bouchers industriels et les découpeurs de viande, les travailleurs d’usines de transformation du poisson et des fruits de mer et les manœuvres à la récolte.
Taux de postes vacants, trimestriel, 2019 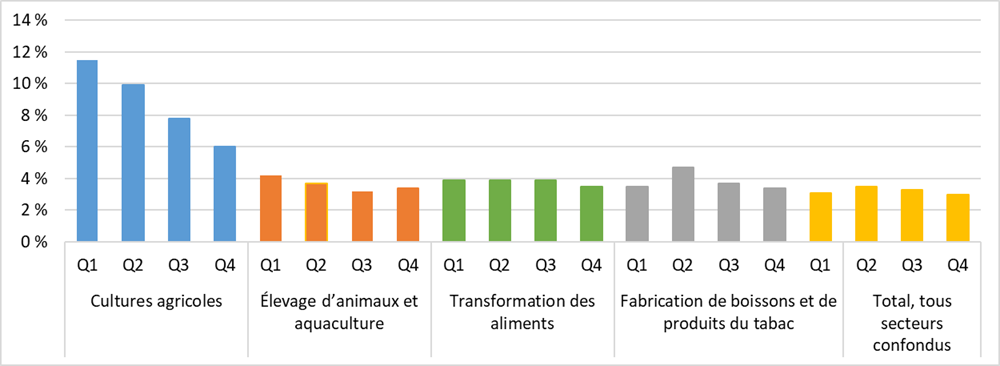
La description de l'image ci-dessus.
Taux trimestriel de postes vacants, 2019
Diagramme à barres comportant un code de couleur pour chaque trimestre de 2019 dans diverses industries. Pour la production végétale, les postes vacants ont diminué de plus de 11 % pendant le T1 pour s’établir à 6 % pendant le T4.
Pour la production animale et l’aquaculture, les postes vacants ont commencé à un peu plus de 4 % au T1 pour subir une baisse au cours du T2, diminuer encore pendant le T3 et enfin remonter à plus de 3 % au T4.
Pour la fabrication d’aliments, le taux de postes vacants est demeuré stable à 4 % du T1 au T3, puis il a diminué légèrement au cours du T4.
Pour la fabrication de boissons et de tabac, les postes vacants affichaient moins de 4 % pendant le T1 et ils ont augmenté pour atteindre un peu moins de 5 % au T2, et finalement diminuer légèrement sous les chiffres du T1 lors du T4.
Pour toutes les industries, les postes vacants ont suivi une tendance semblable à la fabrication de boissons et de tabac, mais les taux étaient constamment un peu moins élevés pendant tous les trimestres.
Taux de postes vacants : Le nombre de postes vacants exprimé en pourcentage de la demande de main-d’œuvre (postes vacants/(employés salariés + postes vacants)).
Sources : Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS)
Les pénuries de main-d’œuvre varient au sein du secteur
Les pénuries chroniques de main-d’œuvre se font surtout sentir dans les secteurs de la transformation et de l’horticulture.
Le type de main-d’œuvre nécessaire varie selon le sous-secteur :
- Emplois peu spécialisés à l’année (p. ex., travailleurs dans la transformation de la viande, les serres, les exploitations de culture des champignons)
Pertes de ventes estimées à 1,15 milliard de dollars pour les transformateurs de viande et les producteurs de la chaîne de valeur (Conseil des viandes du Canada).
- Emplois saisonniers peu spécialisés (p. ex., travailleurs de la production primaire à la ferme, de la transformation des fruits de mer, de la transformation des fruits et légumes)
Perte de revenus estimée à 2,9 milliards de dollars pour le secteur agricole primaire en 2017 (Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture).
- Postes hautement spécialisés à l’année (p. ex., vétérinaires, ingénieurs, scientifiques des données)
Demande estimative de 49 000 travailleurs supplémentaires dans le secteur agroalimentaire et des technologies alimentaires d’ici 2025 (Conseil des technologies de l’information et des communications).
Il existe plusieurs moyens d’améliorer la capacité de main-d’œuvre au pays
La réussite du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire en tant que moteur économique exige une action intergouvernementale continue à l’égard des défis systémiques en matière de main-d’œuvre, notamment :
- Facilitation de l’adoption de technologies et de l’automatisation pour réduire les pénuries de main-d’œuvre et améliorer la productivité,
- Éducation et formation de la main-d’œuvre de demain et perfectionnement des travailleurs actuels,
- Amélioration du recrutement et du maintien en poste, et sensibilisation accrue aux possibilités de carrière en agriculture.
AAC collabore avec les partenaires fédéraux et les provinces et les territoires pour influencer les politiques, partager l’information sur le marché du travail et financer et exécuter des programmes de perfectionnement de la main-d’œuvre et des compétences. Parmi les mesures prises en ce sens, citons :
- Le Programme d’emploi et de compétences pour les jeunes aide les employeurs agricoles à embaucher des jeunes qui pourront acquérir une expérience et des compétences propres à l’agriculture (on s’attend à ce que 2 000 jeunes Canadiens reçoivent un soutien en 2021-2022),
- Table sur le perfectionnement des compétences – lancée en août 2021 et présidée conjointement par AAC et l’industrie – devrait inclure des travaux sur le recrutement et le maintien en poste des travailleurs ainsi que des options de formation et de perfectionnement des compétences à venir,
- Le Partenariat canadien pour l’agriculture comprend des programmes axés sur l’éducation, le perfectionnement des compétences et les investissements dans les technologies (p. ex., l’Ontario offre un financement à frais partagés qui permet aux producteurs et aux transformateurs d’investir dans le développement, la commercialisation et l’adoption de technologies et d’équipement pour améliorer la productivité de la main-d’œuvre).
Les TET continuent d’être une source essentielle de main-d’œuvre
Plus de 70 000 TET ont travaillé dans le secteur agricole et agroalimentaire chaque année de 2017 à 2020.
L’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique comptent le plus grand nombre de TET.
La plupart des TET embauchés dans le secteur occupent des postes peu spécialisés ou à faible salaire, comme les ouvriers agricoles, les ouvriers de pépinières et de serres et les travailleurs des usines de transformation du poisson.
Les données préliminaires de 2020 indiquent :
- Les TET représentaient environ 18 % de la main-d’œuvre du secteur de l’agriculture primaire et 8 % du secteur de la fabrication des produits alimentaires et des boissons,
- Les principaux secteurs d’emploi des TET comprenaient l’horticulture et la transformation de la viande.
Nombre de travailleurs étrangers temporaires, secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 2017-2020 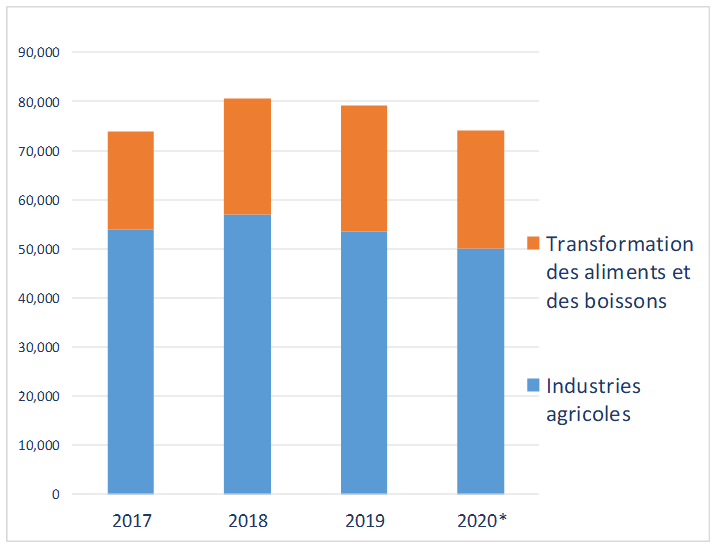
Sources : Statistique Canada et calculs d'AAC.
Remarques : Les données de 2020 sont préliminaires
La description de l'image ci-dessus.
Nombre de travailleurs étrangers temporaires, secteur agricole et agroalimentaire, 2017 à 2020
Graphique à barres montrant que les industries agricoles embauchaient plus de travailleurs étrangers temporaires que le secteur de la transformation des aliments et des boissons, les industries agricoles comptaient en général plus de 50 000 travailleurs de 2017 à 2019 et ensuite presque exactement 50 000 en 2020.
Le secteur de la transformation des aliments et des boissons emploie constamment environ 20 000 travailleurs étrangers temporaires.
L’agriculture est le principal utilisateur du programme des TET, qui est une responsabilité partagée par EDSC, IRCC et L’ASFC
Éléments clés requis pour l’embauche dans le cadre du Programme des TET :
- Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) favorable accordée aux employeurs par Emploi et Développement social Canada (EDSC).
- Admissibilité aux permis de travail déterminés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et permis délivrés aux ressortissants étrangers par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
- Éléments clés requis pour l’embauche dans le cadre du Programme des TET :
- Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) favorable accordée aux employeurs par Emploi et Développement social Canada (EDSC).
- Admissibilité aux permis de travail déterminés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et permis délivrés aux ressortissants étrangers par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Volet Pertinence pour le secteur agricole et agroalimentaire Agriculture primaire Comprend le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS), le volet agricole et les volets pour les postes à salaire peu élevé et à salaire élevé Postes à salaire peu élevé Couramment utilisé dans la transformation du poisson et des fruits de mer et la transformation de la viande Postes à salaire élevé Moins couramment utilisé en agriculture et en agroalimentaire Volet des talents mondiaux Moins couramment utilisé en agriculture et en agroalimentaire La responsabilité du recrutement ou de la sélection des travailleurs étrangers pour les emplois au Canada incombe aux employeurs ou aux pays partenaires pour les postes approuvés dans le cadre du PTAS.
Les responsabilités de l’employeur varient selon le volet : Le PTAS et le volet agricole obligent l’employeur à fournir un logement et à assumer les frais de transport aller-retour; frais supplémentaires et plafonds en dehors de l’agriculture primaire
Efforts continus pour réformer le Programme des TET
La pandémie a fait ressortir à la fois la nature essentielle des travailleurs agricoles et agroalimentaires et les défis que pose le Programme des TET.
L’industrie préconise depuis plusieurs années des réformes au Programme des TET, notamment (1) la simplification des volets du programme, (2) la réduction des délais de traitement des EIMT et des permis de travail, et (3) une augmentation du plafond de la proportion de TET à salaire peu élevé par lieu de travail dans la transformation des aliments.
- Des consultations dirigées par EDSC auprès des intervenants ont eu lieu entre 2017 et 2020 sur divers éléments du Programme des TET (p. ex., examen de l’agriculture primaire de 2017 à 2019).
- EDSC et IRCC ont mis en œuvre des changements qui ont répondu à certaines préoccupations de l’industrie (annexe C), mais on croit que des solutions toutes faites pourraient être mises en œuvre rapidement pour améliorer le Programme des TET (p. ex., employeur de confiance).
EDSC propose des réformes importantes du programme au cours des prochaines années, y compris des modifications réglementaires et des exigences en matière de logement, qui pourraient améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, le logement, l’administration et l’intégrité du programme (c.-à-d. le régime d’inspection).
AAC et les intervenants de l’industrie, ainsi que les provinces et les territoires, les municipalités, les gouvernements des pays sources et les groupes de travailleurs migrants demeurent fortement engagés.
Des changements à l’immigration pourraient aider à atténuer les pénuries de main-d’œuvre
Des projets pilotes en matière d’immigration dirigés par IRCC ont été mis en place pour aider à pourvoir les postes à l’année peu spécialisés qui demeurent vacants de façon persistante (p. ex., la découpe et la transformation de la viande), mais il est trop tôt pour en déterminer les répercussions
- Lancement du projet pilote sur l’immigration agroalimentaire,
- Lancement du projet pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord,
- Prolongation du projet pilote d’immigration au Canada atlantique.
Lancement d’une nouvelle voie d’accès à la résidence permanente pour 30 000 travailleurs temporaires essentiels, y compris dans le secteur agricole et agroalimentaire (avril 2021).
- Plafond de demandes atteint en juin 2021, les données sur les demandes reçues devraient être accessibles à l’automne 2021.
Les provinces et les territoires peuvent utiliser les postes du Programme des candidats des provinces (PCP) pour cibler les secteurs où les besoins sont marqués, mais la plupart consacrent peu de postes à l’agriculture
- 2 000 nouveaux postes du PCP sont pour des travailleurs semi-qualifiés, un secteur où il y a une pénurie importante.
Domaines privilégiés par AAC pour relever les défis en matière de main-d’œuvre et de compétences
En coordination avec les partenaires clés, envisager des solutions propres à un sous-secteur aux fins de l’établissement d’une nouvelle Stratégie de main-d’œuvre agricole qui témoignent des besoins variés dans les différents secteurs de l’industrie agricole et agroalimentaire du Canada.
Surveiller les restrictions de voyage à l’étranger et travailler avec les partenaires clés pour assurer l’arrivée en temps opportun des TET pour la prochaine saison de plantation de 2022.
Collaborer avec EDSC, IRCC et Service Canada à la réforme du Programme des TET (y compris les exigences proposées en matière de logement), aux projets pilotes et aux politiques d’immigration, et à la protection des travailleurs.
Mobilisation de l’industrie et des groupes d’intervenants, y compris dans le cadre de la Table ronde sur le développement des compétences fédérales-sectorielles lancée récemment.
Annexe A – Réponse des gouvernements FPT à la COVID-19
Initiatives fédérales Initiatives provinciales/territoriales Initiatives à l’échelle de l’économie : Subvention canadienne pour les salaires d’urgence, Prestation canadienne d’urgence, Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, 3 milliards de dollars en suppléments salariaux pour les travailleurs essentiels, etc. Interventions pour aider à améliorer la santé et la sécurité à la ferme et dans les installations de transformation, y compris l'achat d'ÉPI (C.-B., Alb., Man., Ont., Qc, Î.-P.-É., N.-B., T.-N.-L., N.-É.) et combler les pénuries de main-d'œuvre (Ont. Qc, Yn, Î.P.-É.). Soutien de programme d'AAC pour les coûts des employeurs liés à la période d’isolement des travailleurs, ainsi qu’à la santé et à la sécurité des travailleurs à la ferme et dans les installations de transformation. Portails de coordination d'emploi en C.-B., en Alb., en Ont., au Qc, en N.-É. et au N.-B. Guide de l’Agence de la santé publique du Canada sur la santé et la sécurité à l’intention des employeurs. Liens avec les programmes de gestion des risques de l'entreprise – Ontario : intégration de la main-d'œuvre comme un risque assurable dans le cadre d'Agri-protection. EDSC et IRCC ont accordé une certaine souplesse temporaire au titre du Programme des TET et examinent d’autres options pour la réforme du Programme et la protection des travailleurs, y compris les normes de logement. Programme d’isolement centralisé géré par le gouvernement pour les travailleurs à leur arrivée - comprend l’hébergement, les repas et les services complets (C.-B.). Groupe de travail fédéral chargé de surveiller les arrivées de TET agricoles tout au long de la saison et règlement des problèmes émergents pour faciliter l’entrée sécuritaire au Canada. Inspections provinciales des mesures de santé et de sécurité à la ferme avant l’arrivée des travailleurs dans les fermes respectives (Québec et autres). Annexe B – Souplesse du Programme des TET pour 2020 en raison de la COVID-19
Levée temporaire de la période de recrutement de deux semaines pour les employeurs du secteur agricole et agroalimentaire.
Traitement prioritaire des études d’impact sur le marché du travail et des permis de travail dans le secteur agricole et agroalimentaire.
Augmentation de la durée maximale de l’emploi d’un à deux ans en vertu des EIMT dans le cadre du projet pilote agroalimentaire.
Permis aux TET au Canada titulaires d’un permis de travail propre à un employeur qui leur permet de commencer un nouvel emploi de façon temporaire pendant le traitement de leur demande.
Prolongation de la période accordée pour présenter une demande de rétablissement du statut juridique des TET au-delà du délai de 90 jours.
Permis aux visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada avec une offre d’emploi valide de présenter une demande de permis de travail pour un employeur donné sans avoir à quitter le Canada.
Permis à certains travailleurs du PTAS leur permettant de continuer à travailler au-delà de la date de fin fixée et à certains travailleurs du PTAS leur permettant de prolonger leur période de travail au-delà de huit mois.
Simplification de la délivrance des visas et de la saisie des données biométriques au point d’entrée au Canada pour faciliter l’entrée.
Annexe C: Exemples de changements apportés par le gouvernement fédéral au Programme des TET, 2016 à 2021
Améliorer l’accès aux TET
- Création d’un groupe de travail mixte dirigé par l’industrie et le gouvernement pour aider à éliminer les irritants administratifs (EDSC, 2018).
- Gel du plafond à 20 % et mise en œuvre d’une exemption saisonnière temporaire du plafond pour les postes d’une durée maximale de 180 jours (EDSC, 2016); mise en œuvre d’un changement au calcul du plafond (EDSC, 2019).
- Lancement d’un projet pilote d’EIMT en ligne (EDSC, 2019).
- Élargissement de la Liste nationale des produits en ajoutant les céréales, les oléagineux et le sirop d’érable (EDSC, 2020).
- Annonce d’une augmentation temporaire de 10 % à 20 % du nombre maximal de TET occupant des postes à salaire peu élevé au Québec (EDSC, 2021).
Améliorer la protection des travailleurs
- Mise à l’essai du Réseau de soutien des travailleurs migrants en Colombie-Britannique afin d’offrir un meilleur soutien aux travailleurs migrants et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux obligations et aux droits (EDSC, 2018).
- Le budget de 2021 a confirmé le financement des organisations de travailleurs migrants (EDSC).
- Renforcement du régime de conformité du programme, y compris des inspections non annoncées et axées sur les risques (EDSC, 2018).
- Introduction de permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables, qui permettent aux travailleurs ayant un permis de travail propre à un employeur dans des situations d’abus de quitter leur employeur et de travailler pour un autre (IRCC, 2019).
- Investissement de 35 millions de dollars pour améliorer la santé et la sécurité sur les exploitations agricoles et dans les lieux de vie des employés afin de prévenir la propagation de la COVID-19 et d’y réagir (AAFC, 2020).
- Mise en place d’une plateforme de jumelage d’emplois pour aider à jumeler les TET avec les employeurs qui ont déjà obtenu ou demandé une EIMT (EDSC, 2021).
- Le budget de 2021 a annoncé l’octroi de 54,9 millions de dollars sur trois ans à EDSC et à IRCC pour accroître le nombre d’inspections des employeurs et veiller à ce que les TET bénéficient de conditions de travail et de salaires appropriés.
Améliorer les voies d’accès à la résidence permanente
- Ajout de 2 000 places supplémentaires à la Classification nationale des professions (CNP) dans le cadre du Programme des candidats des provinces (IRCC, 2019).
- Lancement du projet pilote agroalimentaire (IRCC, 2020).
- Augmentation de la durée maximale d’emploi en vertu des EIMT d’un à deux ans pour les postes dans la transformation des viandes, dans le cadre du projet pilote agroalimentaire d’IRCC (EDSC, 2020).
- Lancement d’une politique temporaire visant à accorder la RP à un maximum de 90 000 diplômés et travailleurs essentiels (y compris les travailleurs agricoles saisonniers) (IRCC, 2021).
- Emplois peu spécialisés à l’année (p. ex., travailleurs dans la transformation de la viande, les serres, les exploitations de culture des champignons)
-
Frais imposés par les détaillants au Canada
Les frais imposés par les détaillants sont des paiements effectués par les fournisseurs aux détaillants en échange du stockage/de l'inscription des produits sur les rayons/en ligne (annexe 1).
L'annonce des détaillants de nouveaux frais à l'été 2020, combinée aux défis liés à la COVID-19, a accru l’intérêt à l’égard de l’incidence de ces frais sur les fournisseurs.
Certains frais imposés par les détaillants sont considérés comme mutuellement bénéfiques car ils augmentent les ventes des fournisseurs (par exemple, frais promotionnels ou de marketing).
Cependant, l’importance et la portée des frais imposés par les détaillants ont augmenté et ces frais sont de plus en plus appliqués d'une manière considérée comme étant litigieuse par les fournisseurs (rétroactive, unilatérale, imprévisible).
- Les fournisseurs soutiennent également que ces frais ne peuvent avoir aucune incidence directe sur leurs ventes et qu'elles sont principalement destinées à compenser les coûts des détaillants (par exemple, frais imposés pour financer les investissements dans les infrastructures des détaillants).
Appels à l’action
À la suite de l'annonce des nouveaux frais imposés par les détaillants à l'été 2020, l'industrie a demandé aux gouvernements fédéral et provinciaux de prendre des mesures pour garantir des pratiques commerciales équitables, transparentes et prévisibles pour l'industrie agroalimentaire.
- La plupart des intervenants réclament un code de pratique/conduite pour le secteur de la vente au détail des produits alimentaires, largement inspiré du Royaume-Uni et de l'Australie (annexe 2).
Par conséquent, en novembre 2020, les ministres de l'Agriculture fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) ont créé un groupe de travail sur les frais imposés par les détaillants présidé par les ministres de l'Agriculture du Canada et du Québec afin de préciser l’incidence des frais imposés par les détaillants et de trouver des solutions.
À la suite de recherches et de consultations approfondies (plus de 60 réunions), le groupe de travail FPT a publié ses principales constatations en juillet 2021 (annexe 3).
Propositions du secteur
Tout au long de l'année 2021, l'industrie a pris l'initiative d'élaborer des solutions au problème des frais imposés par les détaillants.
Malgré d’importants progrès au sein de l'industrie, les approches proposées étaient clairement différentes; des codes obligatoires (réglementés) et volontaires ont été proposés :
- Food, Health and Consumer Products of Canada (FHCP) et Empire Company Ltd (Sobeys) ont proposé un code obligatoire (réglementaire) fondé sur l'expérience du Royaume-Uni; l'Association des transformateurs laitiers du Canada et le Conseil des industriels laitiers du Québec se sont ralliés à cette approche.
- La nouvelle Alliance de collaboration de l'industrie alimentaire canadienne (qui comprend le Conseil canadien du commerce de détail, la Fédération canadienne des épiciers indépendants, Food and Beverage Canada et l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes) a proposé un processus dirigé par l'industrie pour élaborer un code de pratiques obligatoire mais non réglementaire, applicable à tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Le modèle de mise en œuvre restait à définir.
- Les principales associations de producteurs (par exemple, la Fédération canadienne de l'agriculture, l'Union des producteurs agricoles, les Producteurs laitiers du Canada, le Conseil canadien de l'horticulture) sont favorables à un code obligatoire.
Prochaines étapes : gamme d'options possibles
Situation actuelle
En juillet 2021, les ministres FPT de l'Agriculture ont demandé à l'industrie de parvenir à un consensus quand la proposition visant à améliorer la prévisibilité, la transparence et l'équité dans les relations entre fournisseurs et détaillants.
- Le mandat du groupe de travail FPT sur les frais imposés par les détaillants a été élargi pour soutenir l'industrie.
Grâce à un facilitateur tiers indépendant, les principaux intervenants réalisent actuellement les initiatives suivantes :
- Établissement d’une structure de gouvernance et d’un plan de travail;
- Discussion sur la portée des pratiques des fournisseurs/détaillants qui devraient être visées par les solutions.
Prochaines étapes : gamme d'options possibles
En examinant les expériences d'autres pays, les solutions possibles comprennent des codes de pratique/déontologie volontaires et obligatoires, avec une variété de modèles de contrôle, y compris la réso lution formelle ou informelle des conflits.
Volontaire Obligatoire* Cela pourrait inclure :
- Principes/directives : des objectifs ambitieux pour les interactions commerciales (par exemple, la prévisibilité, la transparence, l’utilisation équitable et l'accès aux recours pour le règlement des litiges)
- Code volontaire de conduite/pratique : articles codifiés sur les pratiques commerciales acceptables entre fournisseurs et détaillants (par exemple, procédures spécifiques pour les paiements et les déductions)
- Nécessite une mise en œuvre dans diverses administrations - Les provinces ont le pouvoir d'adopter des lois sur la propriété et les droits civils (alors que le gouvernement fédéral a le pouvoir d'adopter des lois sur le commerce interprovincial et la concurrence).
- Les PT peuvent déléguer le pouvoir de mise en œuvre à une entité gouvernementale fédérale, à une entité non gouvernementale ou à une personne individuelle.
*Remarque : Il est possible de disposer d'un code obligatoire avec ou sans réglementation.
La surveillance pourrait inclure l’accroissement de la sensibilisation, la production de rapports annuels, la notation de la conformité, la médiation/résolution des litiges, l’arbitrage contraignant ou non contraignant, les pouvoirs d’enquête et les sanctions financières.
Considérations
Un consensus est nécessaire à l’égard d’une série d’éléments clés :
- Intervenants visés par le cadre (par exemple, tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement ou accent sur les détaillants et les transformateurs);
- Types d'activités visées (par exemple, les pratiques en matière de frais ou d'autres interactions dans la chaîne d'approvisionnement);
- Caractère obligatoire ou volontaire.
L’expérience internationale a démontré que l’application de la loi contribue à garantir le respect des règles.
- Alors que le Royaume-Uni a commencé par une surveillance souple, il a reconnu au fil du temps (10 ans) que des mécanismes de règlement des différends renforcés étaient nécessaires, y compris de donner le pouvoir à un adjudicateur d’imposer des amendes.
Les frais imposés par les détaillants sont liés aux transactions commerciales entre deux entreprises et relèvent principalement de la compétence provinciale.
- Une approche réglementaire exigerait un effort coordonné des PT pour éviter une mosaïque d’approches.
- Mobilisation accrue des PT, le Québec jouant un rôle de premier plan.
Prochaines étapes
Poursuite de la collaboration entre l’industrie et le facilitateur aux fins de l’établissement d’une vision commune
Rapport d’étape aux ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) à l'automne/hiver 2021 comprenant les résultats des délibérations actuelles de l'industrie
Possibilité d'une réunion des coprésidents (ministres de l'Agriculture d'AAC et du Québec) pour déterminer les prochaines étapes
Annexe 1 : frais imposés par les détaillants
Nom Description Frais de rupture de stock des annonces Pénalités imposées aux fournisseurs s'ils manquent de produits pendant la promotion. Accords fondamentaux/nationaux En général, les accords fondamentaux conclus entre les détaillants et les fournisseurs fixent des objectifs de vente nationaux et prévoient une prime pour le détaillant qui atteint l’objectif fixé. Ces accords peuvent donner lieu à un « traitement préférentiel », puisque les détaillants sont incités à accorder plus de place dans les rayons aux fournisseurs ayant conclu de tels accords, afin d’atteindre ses objectifs de vente. Ces accords peuvent rendre la concurrence difficile pour les nouveaux fournisseurs. Frais de développement du commerce électronique Une redevance basée sur un pourcentage que les vendeurs doivent payer sur tous les produits vendus par le détaillant via sa plateforme de commerce électronique. L'objectif de cette redevance est de compenser les investissements visant à accélérer l'expansion de la distribution de produits d'épicerie en ligne et des capacités de commerce électronique. Frais d'exclusivité Ceux-ci n'existent généralement pas en tant que tels, mais constituent un argument de négociation qui peut être échangé contre des frais de créneau. Période de coupure ou de gel des prix prolongée Les détaillants alimentaires imposeront unilatéralement un gel des prix (c’est-à-dire, des périodes de coupure obligatoires) pendant lesquelles il sera interdit aux fournisseurs de demander des augmentations de prix. Elles coïncident généralement avec les périodes de vacances (par exemple, de septembre à janvier). Si les fournisseurs doivent faire face à une augmentation du prix des ingrédients pendant cette période, ils doivent reporter l’augmentation de leur prix et, dans certains cas, ils doivent donner au détaillant un préavis de douze semaines. Si le détaillant accepte le nouveau prix, l’augmentation est valable à partir de la date d’acceptation et n’est pas antidatée à la date de la notification initiale. Conditions supplémentaires Une déduction de 1 à 2 %, appliquée par certains grands détaillants aux prix de leurs fournisseurs, pour financer des rénovations de magasins ou des acquisitions récentes. Redevance de développement des infrastructures/ allocation d'accélération stratégique Ces frais, généralement exprimés en pourcentage du coût des marchandises achetées par le détaillant, sont facturés aux fournisseurs pour compenser les coûts d’infrastructure des détaillants, qui peuvent inclure la rénovation des magasins et des réseaux logistiques, la construction de nouveaux centres de distribution ou la mise en œuvre de systèmes nouveaux et mis à niveau pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Frais de retard de livraison Frais qui sont déduits hors facture par le détaillant comme pénalité pour les livraisons effectuées plus tard que ce qui est indiqué sur le bon de commande. Ces frais varient généralement entre 500 et 1 000 dollars par commande, ou entre 200 et 500 dollars si le détaillant est prévenu du retard. Frais supplémentaires Ces frais correspondent à un pourcentage des ventes des fournisseurs, généralement compris entre 1 et 15 %, qui est déduit par le détaillant pour soutenir le travail de marketing (par exemple, la production des prospectus promotionnels) et sa distribution. Les frais supplémentaires sont une pratique courante dans l’industrie, mais ils varient d’une entreprise à l’autre. Ils s’appliquent à tous les fournisseurs, tant les acteurs établis que les nouveaux venus. Conditions de paiement En général, les fournisseurs de l’industrie offrent une réduction de 2 % sur les paiements effectués dans les 10 jours, ou ne facturent aucun intérêt pour les paiements effectués dans les 30 jours. Toutefois, certains grands détaillants imposent d’autres conditions de paiement standard (par exemple, aucun intérêt pour les paiements effectués dans les 90 jours). En outre, certains détaillants appliquent une déduction de 2 % sur la facture de vente en gros, même si le paiement a lieu en dehors de la fenêtre de 10 jours. Si cette pratique ne constitue pas nécessairement un obstacle à l’entrée sur le marché des fournisseurs, elle représente une contrainte majeure en matière de coûts, car il n’y a aucune garantie quant à la date et au montant du paiement qui sera reçu. Frais d’inscription au catalogue / Frais de présentation / Frais de listage Le détaillant facture des frais de présentation pour attribuer un espace à chaque produit alimentaire. Il s’agit de paiements forfaitaires dus dès l’approbation, sans garantie de durée minimale des ventes. S’il est généralement entendu que l’espace est réservé pour 12 mois, le détaillant n’est pas obligé de respecter ce délai.
De nombreux fournisseurs considèrent que l’évaluation des frais de présentation et de listage est la pratique la plus controversée des détaillants, car il n’existe pas de tableau de frais fixes. En effet, ces frais sont établis par des négociations entre le détaillant et le fournisseur.
Frais de déchargement Il est interdit aux chauffeurs de participer au déchargement de leurs camions dans presque tous les centres de distribution des détaillants. Par conséquent, chaque centre fait appel à une entreprise tierce sur place (connue sous le nom de « déchargeurs » ou « dockers ») pour assurer ce service. Ces frais coûtent de 50 à 500 dollars en fonction du nombre de palettes et du temps nécessaire au déchargement. Frais sur les marchandises invendables Au cours de la dernière décennie, la responsabilité des produits endommagés en transit ou en magasin a été transférée du détaillant au fabricant. Ces frais sont facturés au fournisseur sous la forme d’un pourcentage des ventes annuelles (par exemple, 1 % à 1,5 % pour les produits de longue conservation) et sont généralement pris en compte dans la tarification de la plupart des produits par les fournisseurs. Source : Liste élaborée à partir d'informations provenant de diverses sources, dont Simon Dessureault (Université de Guelph) et Sean Lippay (Strategic Food Solutions)
Annexe 2 : exemples d'autres approches
Code de conduite pour l’approvisionnement en produits alimentaires au Royaume-Uni
- Légiféré par la Commission de la concurrence.
- Accent sur l’efficacité et la prévisibilité.
- Supervisé par un adjudicateur du Code de conduite pour les épiceries pour dialoguer avec les fournisseurs et les détaillants, enquêter et arbitrer (avec un pouvoir d'exécution).
- Responsables du respect du code désignés par chaque détaillant comme premier point de contact pour les fournisseurs.
- Aborde les pratiques des détaillants « désignés », définis comme ceux dont les ventes de produits alimentaires dépassent un milliard de livres sterling (13 détaillants en 2021).
Code de conduite de l’industrie de l’alimentation et de l’épicerie de l’Australie
- Légiféré; s'applique si les détaillants adhèrent volontairement, mais une fois signé, la conformité est obligatoire.
- Prescrites en vertu de la Loi sur la concurrence et la consommation (2010) et réglementé par la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC).
- L’examinateur indépendant nommé par le gouvernement exerce une surveillance non contraignante; les signataires nomment des arbitres du Code pour enquêter et proposer une solution aux éventuelles infractions notifiées par un fournisseur.
- Le code s’applique aux détaillants et aux grossistes; les quatre principaux détaillants y ont adhéré.11
Annexe 3 : principales constatations du groupe de travail fpt sur les frais imposés par les détaillants
Principales constatations
- La concentration dans le secteur de la vente au détail permet aux détaillants d'utiliser leur pouvoir de négociation pour imposer une série de frais aux fournisseurs afin de fournir et de commercialiser leurs produits en magasin. Récemment, la forme et l'ampleur des frais imposés par les détaillants ont augmenté et la manière dont ils sont imposés a changé.
- L'imprévisibilité et le manque de transparence dans la façon dont certains frais sont perçus, ainsi que les recours limités et souvent complexes pour la résolution des litiges, ont conduit à une tension générale des relations au sein de la chaîne d'approvisionnement, des détaillants aux producteurs primaires. Cette situation fait également en sorte que l'environnement d'investissement du Canada semble moins attrayant pour certaines entreprises de fabrication de produits alimentaires.
- Cette dynamique a d'autres répercussions secondaires; elle empêche les petits transformateurs et producteurs d'accéder au marché, elle entrave l'innovation et elle crée des problèmes particuliers d'approvisionnement et de prix pour les détaillants indépendants et les producteurs locaux auprès desquels ils s'approvisionnent.
- Confrontés à des problèmes similaires, certains autres pays, comme le Royaume-Uni, ont réglé la question des frais imposés par les détaillants au moyen de codes de conduite légiférés. Ces processus exigent généralement plusieurs étapes, dont la première est l’établissement d’approches volontaires dirigé par l'industrie.
- Certains principes et certaines pratiques exemplaires ont été reconnus par divers intervenants et sont à la base d'une relation saine entre fournisseurs et détaillants, notamment le traitement équitable dans les relations entre fournisseurs et détaillants, la prévisibilité, la transparence et l'accès à des recours pour la résolution des litiges.
-
Examen de la Loi sur les grains du Canada
Question - Examen de la loi sur les grains du Canada
- Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a entrepris un examen de la Loi sur les grains du Canada (LGC), le cadre législatif de la réglementation de la qualité et de la manutention des grains au Canada, comme cela a été prévu dans le budget de 2019.
- Cet examen est appuyé par les intervenants selon lesquels la LGC est caduque et doit être modernisée en profondeur.
Loi sur les grains du Canada
La LGC a été adoptée en 1912 et n’a pas connu de changements importants depuis.
- La LGC fournit le cadre législatif pour l’assurance de la qualité des grains au Canada (par exemple, les grades et les normes). La LGC établit également les mesures de protection des producteurs (par exemple, la garantie de paiement), reconnaissant les déséquilibres de pouvoir sur le marché avec les acheteurs.
- La LGC réglemente principalement la manutention des grains dans l’Ouest canadien, où se fait 85 % de la production de grains du pays. La surveillance de la LGC est limitée dans l’Est du Canada.
- En 2020, le Canada a produit 99,7 millions de tonnes métriques de grains, dont environ 57 % ont été exportées vers les marchés internationaux.
- En 1971, le Canada a produit 42,1 millions de tonnes métriques de grains et a exporté 55 % des principaux grains.
Commission canadienne des grains (CCG)
- Conformément à la LGC, la Commission canadienne des grains (CCG) :
- Établit et maintient des normes scientifiques pour les grains canadiens;
- Réglemente la manutention des grains au Canada;
- Offre des garanties aux producteurs pour s’assurer qu’ils sont rémunérés de manière équitable pour leurs grains.
- La CCG effectue des recherches sur les grains afin d’établir des normes et de favoriser l’accès au marché international des grains. La CCG s’occupe aussi de l’inspection obligatoire des grains exportés par navire.
Rôles de la CCG dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
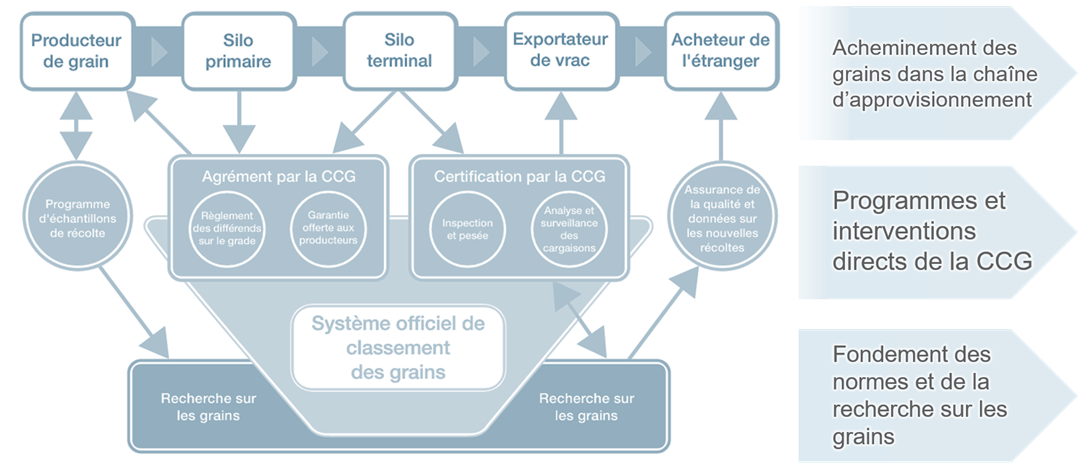
Description de l’image au-dessous
Le rôle de la CCG dans les effets de la chaîne de valeur
Diverses flèches pointent vers les nombreuses composantes de la chaîne de valeur. L’octroi de licences par la CCG touche les producteurs de céréales, les silos terminaux et les silos primaires.
La certification par la CCG touche les silos terminaux et les exportateurs de marchandises en vrac.
Tous ces intervenants expédient leurs produits aux acheteurs.
L’octroi de licences et la certification par la CCG font partie du plus grand système officiel de classement, qui comprend également la recherche sur les grains. Le Programme d’échantillons de récolte oriente la recherche sur les grains, qui oriente ensuite l’assurance de la qualité.
Appui à la modernisation de la LGC
AAC dirige un examen, avec l'appui de la CCG, afin de déterminer les changements qui pourraient être nécessaires au cadre législatif et réglementaire du Canada pour répondre aux besoins d’un secteur céréalier moderne.
De vastes consultations auprès des intervenants ont eu lieu au début de 2021 et ont fait ressortir la nécessité de mettre à jour la LGC afin de refléter 50 ans d’évolution du secteur.
Les intervenants s’attendent à une modernisation et à des réformes substantielles pour répondre aux questions soulevées lors des consultations.
Il y a consensus sur le fait que la CCG doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans l'établissement et le maintien d’un système d’assurance de la qualité des grains de classe mondiale.
La protection des producteurs reste une priorité absolue
Appui général des producteurs pour que la CCG demeure « dans l’intérêt des producteurs ».
Les producteurs ont indiqué que les programmes actuels de protection des producteurs offerts par la CCG (par exemple, garantie de paiements, arbitrage en matière de classement des grains) sont précieux et doivent être maintenus pour protéger les producteurs.
- Voici d’autres suggestions pour protéger davantage les producteurs : Assurer un traitement réglementaire uniforme dans tous les établissements qui achètent ou manipulent du grain.
- Élargir l’admissibilité des producteurs à demander les grades finaux de la CCG.
- Améliorer le programme de garantie des paiements aux producteurs de la CCG afin d'accroître la couverture et la capacité d’intervention.
Rôle de la CCG dans l’inspection des grains exportés
Les manutentionnaires de grains, les transformateurs et un nombre croissant de groupes de producteurs souhaitent que la CCG passe de l’inspection directe à la surveillance réglementaire de l’inspection des grains exportés.
- À l’heure actuelle, la CCG effectue directement les inspections obligatoires à l’exportation.
- De nombreux organismes ont indiqué qu’un pourcentage élevé (> 70 %) du grain exporté est inspecté deux fois avant de quitter le Canada pour satisfaire aux exigences contractuelles ainsi qu’aux exigences de la LGC.
- De nombreux répondants croient que le fait de modifier le modèle de service de la CCG pourrait réduire les coûts qui, au bout du compte, sont transmis aux producteurs.
D’autres organismes ont exprimé des préoccupations quant au fait que la CCG ne fournisse plus de services d’inspection et à l'impact que cela pourrait avoir sur « l’image de marque du Canada ».
Autres points abordés
Les intervenants ont largement soutenu l’examen de la structure de financement de la CCG, y compris les appels à l’augmentation des crédits.
- Des changements à la prestation des services d’inspection des exportations de la CCG nécessiteraient des changements au modèle de financement, car en 2020 près de 90 % des recettes de la CCG provenaient des frais de services obligatoires.
- Les organismes de producteurs ont demandé une surveillance accrue des acheteurs et des manutentionnaires de grains par la CCG.
- Les organismes de producteurs ont aussi demandé une augmentation des rapports statistiques de la CCG, y compris la mise en œuvre de rapports sur les ventes à l’exportation semblables à ceux qui sont disponibles aux États-Unis.
Prochaines étapes
Les fonctionnaires proposeront les prochaines étapes du processus de modernisation, y compris l’engagement de l’industrie à l’égard des propositions de réforme et des changements potentiels dans le cadre des pouvoirs actuels de la CCG.
Les représentants chercheront également à obtenir des directives sur les options qui pourraient être envisagées en ce qui concerne des changements législatifs et réglementaires précis.
Le calendrier de modernisation sera établi selon l’approche choisie, mais les amendements législatifs et réglementaires peuvent prendre de 2 à 3 ans.
-
Une politique alimentaire pour le Canada
Objet
Donner un aperçu de ce qui suit :
- La Politique alimentaire pour le Canada
- La présentation du document sur la démarche nationale du Canada à l’ONU, à la suite du Sommet sur les systèmes alimentaires de l’ONU
Vision et résultats de la politique alimentaire
Vision
Toutes les personnes vivant au Canada ont accès à une quantité suffisante d’aliments salubres, nutritifs et culturellement diversifiés. Le système alimentaire du Canada est résilient et innovateur, protège notre environnement et soutient notre économie.
Résultats à long terme
- Résultats améliorés pour la santé liés aux aliments.
- Croissance économique inclusive.
- Communautés vivantes.
- Liens accrus au sein des systèmes alimentaires.
- Pratiques alimentaires durables.
- Systèmes alimentaires autochtones solides.
- Domaines d’action à court terme
- Aider les collectivités canadiennes à avoir accès à des aliments sains.
- Faire des aliments canadiens le premier choix au pays et à l’étranger.
- Assurer la sécurité alimentaire dans les collectivités nordiques et autochtones.
- Réduire le gaspillage alimentaire.
- La Politique alimentaire pour le Canada a été inaugurée en 2019, après des consultations auprès de plus de 45 000 Canadiens, tenues lors d’événements organisés dans l’ensemble du pays.
État actuel des initiatives liées à la politique alimentaire pour le Canada
Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL)
- 60 millions de dollars sur 5 ans
- Inauguré en août 2019 (AAC). Soutenir l’achat de petites infrastructures et d’équipement par des organismes communautaires de sécurité alimentaire.
Défi de réduction du gaspillage alimentaire
- 20 millions de dollars sur 5 ans
- Inauguré en novembre 2020 (AAC) : Quatre volets d’innovation pour aider les innovateurs grâce au processus d’élaboration et de déploiement de solutions.
Lutte contre la fraude alimentaire
- 24,4 millions de dollars sur 5 ans
- Inaugurée en novembre 2020 (ACIA) : Effectuer des inspections, recueillir et tester des aliments à des fins d’authenticité, et recueillir des renseignements afin de mieux cibler les activités de supervision.
Faire participer les provinces et territoires au programme d’alimentation dans les écoles
- EDSC a effectué une analyse de l’environnement en 2019 sur les programmes actuels d’alimentation dans les écoles, en consultation avec des homologues des PT et des intervenants clés.
Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées
- 15 millions de dollars sur 5 ans
- Inauguré en décembre 2020 (CanNor) : Appuyer les projets communautaires de systèmes alimentaires locaux et autochtones afin d’améliorer la sécurité alimentaire dans le Nord.
Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs
- 40 millions de dollars sur 5 ans
- Inaugurée en avril 2020 (RCANC) : Améliorer l’accès aux aliments traditionnels en réduisant les coûts élevés associés à la chasse et à la cueillette traditionnelles.
Campagne de promotion de l’achat de produits canadiens
- 25 millions de dollars sur 5 ans
- En attente (AAC) : Est devenue l’Initiative canadienne de sensibilisation à l’agriculture, pour accroître l’appréciation et la confiance du public dans le secteur agricole et alimentaire.
Leadership fédéral en matière de réduction du gaspillage alimentaire
- 6,3 millions de dollars réaffectés sur 5 ans
- Permanent (AAC) : Des efforts sont consentis tout spécialement pour susciter une action collective et l’élaboration de programmes d’urgence dans le cadre de la réaction à la COVID-19 (p. ex., Programme de récupération d’aliments excédentaires).
Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada
Inauguré en février 2021, le rôle du Conseil consiste à donner au ministre des conseils opportuns et indépendants sur les problèmes actuels et nouveaux, propres aux systèmes alimentaires, ainsi qu’à faire avancer les priorités de la Politique alimentaire.
Organisme indépendant nommé par le ministre et composé de 22 experts et dirigeants des systèmes alimentaires.
- Comprend des points de vue diversifiés de l’ensemble des systèmes alimentaires, représentant des professionnels de la santé, des membres de la société civile, du milieu universitaire et du secteur agricole et alimentaire.
Les membres du Conseil ont créé des groupes de travail sur quatre domaines principaux :
- Nutrition en milieu scolaire
- Réduction de l’insécurité alimentaire
- Réduction des pertes et du gaspillage alimentaire
- Soutien de l’agriculture durable
La politique alimentaire pendant la COVID-19
L’incertitude entourant la résilience de l’approvisionnement alimentaire aux premiers stades de la pandémie a attiré l’attention du public sur les systèmes alimentaires, de la production à l’élimination, notamment :
- Les taux d’insécurité alimentaire, tout particulièrement dans les collectivités autochtones et nordiques.
- Les problèmes de main-d’œuvre dans les systèmes alimentaires : les travailleurs de première ligne, les usines de transformation de la viande et la main-d’œuvre à la ferme.
- La souveraineté alimentaire : la dépendance à l’égard du commerce pour la transformation des aliments, l’importation des aliments de base (p. ex. fruits et légumes).
- La résilience des chaînes d’approvisionnement centralisées « juste à temps » en raison des changements rapides de la demande.
- La perte et le gaspillage causés par l’incidence du confinement sur les secteurs de la restauration, des services alimentaires et de l’hébergement.
Les principes de la Politique alimentaire ont aidé à orienter les programmes d’intervention fédéraux pendant la pandémie :
- Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire
- Programme de récupération d’aliments excédentaires
- Fonds d’urgence pour la transformation
- Autres investissements dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales
Le sommet sur les systèmes alimentaires de l’ONU et la politique alimentaire
En octobre 2019, le Secrétaire général de l’ONU a annoncé un Sommet sur les systèmes alimentaires (SSA) pour se concentrer sur la transformation des systèmes alimentaires afin d’accélérer les progrès qui permettent d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030.
Pendant l’année qui a mené au Sommet, l’ONU a mis en œuvre un processus complet impliquant un engagement multipartite et employant une approche basée sur les systèmes alimentaires pour des systèmes alimentaires plus durables, équitables et résilients.
Les États membres ont été invités à engager des dialogues pour soutenir l'élaboration d'un document sur les démarche nationale décrivant les engagements et les actions prévus.
Comme ce processus s'alignait sur l'approche adoptée pour élaborer la Politique alimentaire pour le Canada, AAC était bien placé pour diriger des dialogues multipartites et il offrait l'occasion d'identifier de nouveaux engagements et mesures pour progresser vers la vision de la Politique alimentaire et les ODD ( voir annexe).
Le suivi et le bilan de l’ONU devraient avoir lieu après le Sommet, le 23 septembre 2021.
Thèmes émergents communs
Engagements dans la plateforme ou le mandat Engagements dans la Politique alimentaire Recommandations des dialogues sur les systèmes alimentaires Objectifs de développement durable de l’ONU Perte et gaspillage d’aliments Fonds anti-gaspillage alimentaire - Défi de la réduction du gaspillage alimentaire
- Leadership fédéral en matière de réduction du gaspillage alimentaire
Élaborer une stratégie nationale sur la réduction de la perte et du gaspillage d’aliments Appuyer les progrès réalisés par le Canada en vue de parvenir aux ODD de l’ONU, notamment :
- Faim zéro
- Bonne santé et bien-être
- Industrie, innovation et infrastructure
- Réduction des inégalités
- Consommation et production responsables
- Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
Programme d'alimentation dans les écoles - Politique nationale d’alimentation dans les écoles
- Programme national d’alimentation nutritive dans les écoles
Consultation avec les PT au sujet des programmes d'alimentation dans les écoles Appuyer le programme national d'alimentation dans les écoles Sécurité alimentaire Collaboration avec les partenaires inuits, des Premières Nations et des nations métisses afin d’améliorer la sécurité alimentaire.* - Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées
- Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs
Appuyer la collecte de données sur la sécurité alimentaire dirigée par les Autochtones et la feuille de route Aliments locaux durables Renforcer les chaînes d’approvisionnement alimentaire locales, durables et à valeur ajoutée au Canada* Fonds des infrastructures alimentaires locales Appuyer les systèmes alimentaires locaux durables Prochaines étapes
Une politique alimentaire pour le Canada
- Faire avancer le processus du Défi de réduction du gaspillage alimentaire.
- Les volets A et B, qui se concentrent sur des modèles opérationnels novateurs, ont été inaugurés en novembre 2020; on devrait annoncer le nom des gagnants des deux grands prix (jusqu’à 1,5 millions de dollars chacun) d’ici l’été 2023.
- Les volets C et D, qui portent sur les technologies novatrices, ont été inaugurés en mars 2021; on devrait annoncer le nom des gagnants des deux grands prix (jusqu’à 1 million de dollars chacun) d’ici le printemps 2024.
- Finaliser l’approche pour les deux dernières années du Fonds des infrastructures alimentaires locales, dont la campagne d’inscription devrait commencer au début de 2022 et obtenir l’approbation requise. Poursuivre les évaluations de la dernière période d’inscription afin de verser le financement avant la fin de l’exercice.
- Mettre en œuvre la stratégie de l’Initiative canadienne de sensibilisation à l’agriculture à l’automne-hiver 2021.
- Mobiliser à nouveau les ministères et organismes clés afin de réduire le gaspillage alimentaire dans les installations fédérales et envisager d’élaborer une stratégie nationale sur la réduction de la perte et du gaspillage d’aliments dans le cadre du leadership fédéral en matière de réduction du gaspillage alimentaire.
- Continuer de collaborer aux grands thèmes avec le Conseil consultatif de la Politique alimentaire.
Document sur la démarche nationale pour le Sommet sur les systèmes alimentaires de l’ONU.
- Présenter des recommandations sur la démarche nationale du Canada, en coordination avec d’autres ministères fédéraux.
- Continuer de participer activement avec les intervenants clés et les partenaires autochtones.
- Procéder au lancement ministériel de la démarche nationale du Canada et la présenter à l’ONU.
- Chercher à obtenir les pouvoirs stratégiques applicables aux nouveaux engagements.
Annexe
Adopter une approche pangouvernementale
Étant donné qu’une meilleure coordination et une
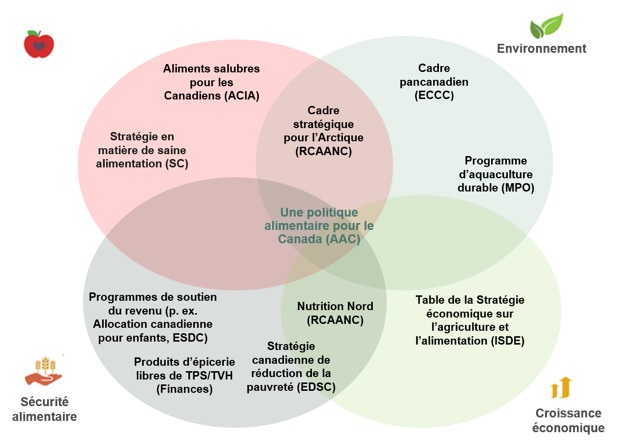
plus grande cohésion sont essentielles pour réaliser des progrès significatifs à l’égard des problèmes alimentaires complexes et systémiques, la Politique alimentaire a été conçue comme une initiative pangouvernementale, qui mise sur une approche coordonnée et de collaboration afin d’atteindre des résultats sociaux, environnementaux, économiques et pour la santé positifs dans le système alimentaire du Canada.
Dialogues des états membres du Canada (2021)
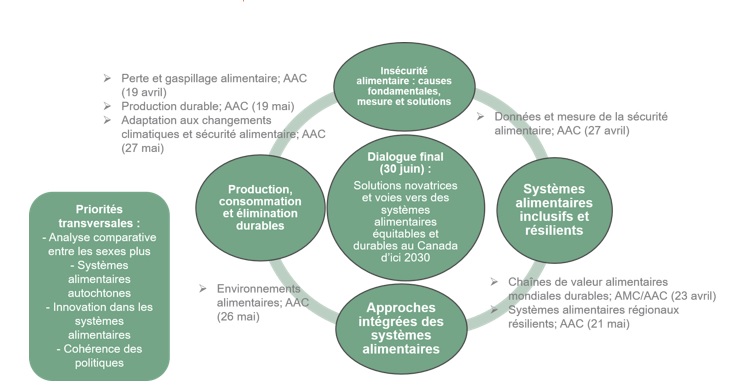
La description de l'image ci-dessus.
Canada's Member State Dialogues
This graphic describes the themes of the various member state dialogues that occurred in 2021. The previous text boxes describe dates the dialogues occurred.
The themes include: food insecurity root causes, measurement, and solutions; inclusive and resilient food systems; integrated approaches to food systems; and sustainable production, consumption and disposal. The final dialogue held on June 30th discussed game-changing solutions and pathways to equitable and sustainable food systems in Canada by 2030.