Table des matières
-
Établir un programme à long terme : les 90 premiers jours
Objectifs
- Présenter un aperçu des priorités possibles en vue de l’établissement d’un programme.
- Cerner les décisions et les réunions clés des 90 premiers jours.
Établissement d’un programme
Le gouvernement a établi un programme ambitieux pour faire progresser le Canada, qui s’appuie sur une vision de croissance inclusive et d’avenir propre et écologique.
Le gouvernement a réalisé d’importants progrès relativement aux engagements dans le secteur agricole et agroalimentaire :
- Le 1er avril 2023, il a lancé le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable), un nouveau cadre quinquennal fédéral-provincial-territorial constituant un investissement de 3,5 milliards de dollars dans le secteur;
- Le gouvernement a versé une indemnisation pleine et entière aux industries agricoles sous gestion de l’offre pour les répercussions des récents accords commerciaux. La mise en œuvre du Fonds d’innovation et d’investissement dans l’industrie laitière, prévue cet automne, est la dernière étape pour remplir cet engagement;
- Le gouvernement a collaboré avec les provinces et les territoires pour mettre à jour les programmes de gestion des risques de l’entreprise, notamment pour y intégrer la gestion des risques climatiques, les pratiques environnementales et la préparation aux changements climatiques.
À l’avenir, les progrès relatifs aux engagements en cours dépendront des actions suivantes :
- Établir un plan ambitieux pour faire progresser les initiatives, en tenant compte des réalités du secteur agricole et en collaborant étroitement avec les collègues du Cabinet;
- Établir de solides relations avec les intervenants sectoriels, y compris les groupes sous‑représentés et les champions de l’agroclimat, et tenir des consultations avec eux;
- Trouver un terrain d’entente avec nos homologues provinciaux et territoriaux (PT) en vue de parvenir à une entente dans les domaines de compétence partagée;
- Tirer parti de nos forces, dont notre capacité scientifique et la souplesse de nos programmes, afin de positionner stratégiquement Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) pour qu’il réponde rapidement aux problèmes urgents au fur et à mesure qu’ils surviennent et pour qu’il appuie la croissance durable à long terme dans le secteur.
Principaux engagements dans le secteur agricole et agroalimentaire
Les éléments prioritaires pour cet automne, dont les engagements en cours énoncés dans la lettre de mandat :
- Élaborer un plan agricole écologique pour le Canada (Stratégie pour une agriculture durable);
- Prévenir l’introduction de la peste porcine africaine (PPA) au Canada et s’y préparer;
- Créer un fonds de lutte contre le gaspillage alimentaire;
- Soutenir les producteurs d’aliments qui choisissent des méthodes de rechange en matière de lutte antiparasitaire;
- Explorer les prochaines étapes de la modernisation de la Loi sur les grains du Canada;
- Élaborer une stratégie sur la main-d’œuvre agricole;
- Interdire l’exportation de chevaux vivants destinés à l’abattage.
Une bonne capacité d’adaptation est nécessaire à une mise en œuvre réussie
L’envergure des initiatives dépend des programmes ainsi que des décisions budgétaires et du Cabinet.
Des appels d’intervention stratégique immédiate pourraient être nécessaires en cas de problèmes ou d’événements urgents tels que :
- la détection de maladies végétales et animales, telles que la PPA, au Canada et/ou dans la zone continentale des États-Unis;
- les effets de l’inflation, qui entraînent une hausse du coût des intrants et du prix des aliments;
- les risques climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes comme les feux de forêt, les sécheresses et les inondations;
- des avancées concernant des questions persistantes liées au commerce international, dont les décisions des groupes spéciaux de règlements des différends;
- des crises ou d’autres événements menant à l’aggravation de problèmes existants dans les chaînes d’approvisionnement, tels que la guerre de la Russie contre l'-Ukraine et les mesures liées à la main‑d’œuvre au Canada.
La technologie et les mégadonnées transforment l’agriculture et les façons dont les gouvernements fournissent des services partout dans le monde. Pour que le Canada demeure au premier plan de cette transformation, le Ministère devra favoriser les partenariats et la collaboration et augmenter l’investissement dans ces domaines.
La désinformation continue d’influencer certains enjeux importants dans le contexte public. Il est important de réfuter les idées fausses de manière proactive, à l’aide d’une approche reposant sur les faits et sur la transparence.
Priorités pour les 30 premiers jours
Réunions d’introduction
- Homologues provinciaux et territoriaux
- Intervenants clés de l’industrie
- Homologues internationaux
- Chefs des organismes du portefeuille de l’agriculture
- Autres ministères fédéraux avec lesquels vous partagez des dossiers clés
Premières décisions
- Demandes urgentes de financement hors cycle
- Demandes de financement pour l’Énoncé économique de l’automne
- Affaires courantes du gouvernement et du Ministère (par exemple, nominations, approbations de financement, prochaines étapes de l’élaboration des politiques et des programmes)
Séances d’information
- Le Ministère et nos travaux
- La situation dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire
- Responsabilités ministérielles
- Dossiers et priorités clés, notamment :
- dossiers chauds;
- PCA durable et relations FPT;
- gestion des risques de l’entreprise;
- environnement;
- main‑d’œuvre;
- peste porcine africaine;
- modernisation de la Loi sur les grains du Canada;
- commerce international et l’Indo-Pacifique;
- réduction des dépenses du budget de 2023.
Événements / voyages
- Visites régionales (par exemple, provinces où il y a des feux de forêt ou des sécheresses)
- 3 août : Réunion ministérielle sur la sécurité alimentaire de la Coopération économique Asie‑Pacifique, à Seattle (Washington); présidée par le secrétaire américain Vilsack, qui a invité la ministre pour une réunion bilatérale.
Priorités du 31e au 60e jour
Réunions d’introduction
- Intervenants clés de l’industrie
Premières décisions
- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- Affaires courantes du gouvernement et du Ministère (par exemple, nominations, approbations de financement, prochaines étapes de l’élaboration des politiques et des programmes)
- Approbation de l’approche d’AAC en ce qui concerne la réduction des dépenses gouvernementales annoncée dans le budget fédéral de 2023 █████████████████████████████████
- Budget supplémentaire des dépenses B
Séances d’information
- Dossiers et priorités clés, notamment :
- la cybersécurité;
- numérisation de la traçabilité dans le secteur agroalimentaire;
- programmes divers.
- Nouveaux défis et débouchés
Événements / voyages
- 12 au 14 septembre : Conférence sur l’agriculture Amérique du Nord-Union européenne, à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
- 19 et 20 septembre : Forum de Santé animale Canada, à Ottawa (Ontario)
- 26 au 28 septembre : Congrès sur les légumineuses et les cultures spéciales, à Banff (Alberta)
Priorités du 61e au 90e jour et au-delà
Réunions d’introduction
- Intervenants clés de l’industrie
Premières décisions
- █████████████████████████████████████████████████████████
- █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- Affaires courantes du gouvernement et du Ministère (par exemple, nominations, approbations de financement, prochaines étapes de l’élaboration des politiques et des programmes)
Séances d’information
- Dossiers et priorités clés
- Possibles propositions pour le budget de 2024
- Nouveaux défis et débouchés
Événements / voyages
- 4 octobre : Mot d’ouverture à la Conférence Adaptation Futures et au Forum international sur les laboratoires vivants d’agroécosystèmes, au Palais des congrès de Montréal (Québec), du 2 au 6 octobre; animation conjointe d’AAC et de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) de la France.
- 9 au 13 octobre (à confirmer) : Mission commerciale d’Équipe Canada en Inde, dirigée par la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique
- 17 au 19 octobre : Forum mondial pour le conseil rural organisé par le NAAAN (North American Agriculture Advisory Network), à Denver (Colorado)
- 14 novembre : Sommet de l’alimentation Arrell 2023, à Toronto (Ontario)
Semaine 1
Réunions de présentation – au sein du Ministère
- Réunion bilatérale : ministre et les sous-ministres
- Séances d’information pour donner un aperçu du secteur et du Ministère
Séances d’information potentielles – sur des sujets précis (ordre et priorité à confirmer avec le ministre)
- 90 premiers jours et dossiers chauds (par exemple, incendies, sécheresse, grève dans les ports, inflation/prix des produits d’épicerie, etc.)
- Peste porcine africaine
- PCA durable et relations FPT
- Gestion des risques de l'entreprise
- Environnement/Stratégie pour une agriculture durable
- Défis liés à la chaîne d’approvisionnement
- Modernisation de la Loi sur les grains du Canada
- Immigration, Stratégie sur la main-d'œuvre agricole, travailleurs étrangers temporaires
- Pesticides et Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
- Exportations de chevaux
- Commerce international, accès aux marchés et diversification
Réunions externes / appels de présentation potentiels
- Coprésident PT – ministre de l'Agriculture du Yukon, suivi par d’autres PT (on pourrait vouloir donner la priorité à la Colombie-Britannique, à l’Alberta et à la Saskatchewan, qui sont aux prises avec des incendies ou des sécheresses, et au Québec, qui reçoit des précipitations abondantes)
- Fédération canadienne de l'agriculture et intervenants régionaux, le cas échéant, comme l’Union des producteurs agricoles (UPA)
- Autres intervenants importants, comme le Conseil des grains du Canada, le Conseil canadien du canola, les Producteurs laitiers du Canada, les associations nationales des industries de la volaille et des œufs et le Conseil canadien du porc
- Homologues d’autres pays, comme le secrétaire américain Vilsack
Événements / voyages
- 3 août : Réunion ministérielle sur la sécurité alimentaire de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Présidée par le secrétaire américain Vilsack, qui a invité le ministre pour une réunion bilatérale
-
Messages clés
- Je suis honoré que le premier ministre m’ait demandé de servir l’industrie agricole et agroalimentaire du Canada, qui est très dynamique.
- Nos producteurs et transformateurs, qui travaillent sans relâche, jouent un rôle clé dans la croissance de notre économie, la protection de l'environnement et la production d'aliments de qualité pour les Canadiens et une population mondiale croissante.
- Ils sont aux premières lignes des changements climatiques, aux prises avec les sécheresses, les inondations et les feux de forêt qui ont lieu à travers le pays.
- J’ai hâte de rencontrer des intervenants de l’industrie, ainsi que mes homologues provinciaux et territoriaux pour discuter des défis et des possibilités auxquels fait face le secteur.
- J'ai hâte d’être informé par l'équipe d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et de travailler avec eux et tous nos partenaires pour soutenir cette industrie importante.
Dossiers chauds – messages clés (en date du 25 juillet 2023)
Arrêt de travail dans les ports de la Colombie-Britannique
- Le gouvernement du Canada respecte le processus de négociation collective et continuera de surveiller la situation de près et de communiquer avec ses partenaires afin d’évaluer les répercussions.
Conditions météorologiques extrêmes
- Je sais que les agriculteurs canadiens sont aux premières lignes des changements climatiques et que les conditions météorologiques extrêmes comme les sécheresses et les inondations ont un effet direct sur leurs résultats financiers.
- J’ai hâte de travailler avec mes homologues provinciaux et territoriaux pour veiller à ce que les producteurs aient accès à l’ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE).
Soutien des producteurs agricoles
- Je suis heureux d’apprendre que les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture ont récemment discuté du lancement du Partenariat canadien pour une agriculture durable, qui a eu lieu le 1er avril.
- Cet accord quinquennal permettra de renforcer la concurrence, l'innovation et la résilience du secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels.
- L'accord prévoit un milliard de dollars en activités et en programmes fédéraux et 2,5 milliards de dollars en activités et en programmes à coûts partagés par les gouvernements FPT.
Réduction des émissions provenant des engrais
- J’ai hâte de travailler avec les producteurs agricoles, y compris le nouveau groupe de travail sur la réduction des émissions provenant des engrais, en vue de cerner les possibilités de réduire les émissions provenant des engrais sans compromettre le rendement.
Stratégie pour une agriculture durable
- J’ai hâte de travailler avec le secteur pour élaborer une Stratégie pour une agriculture durable. Cette stratégie permettra d’instaurer une orientation visant à améliorer la performance environnementale du secteur à long terme, tout en soutenant les moyens de subsistance des agriculteurs et la vitalité commerciale à long terme du secteur.
Règlement sur les combustibles propres
- Le Règlement sur les combustibles propres, dirigé par Environnement et Changement climatique Canada, permettra de stimuler la demande de céréales, d’oléagineux et de sous-produits animaux canadiens pouvant être transformés en carburant à faible teneur en carbone pour alimenter l’économie canadienne. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour nos producteurs agricoles dévoués.
Protection des cultures et l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
- Le gouvernement du Canada soutient les agriculteurs et reconnaît que les pesticides et un système de réglementation fondé sur la science contribuent à faire en sorte qu’il y ait suffisamment de nourriture pour tous en protégeant les cultures contre les organismes nuisibles comme les insectes, les mauvaises herbes et les maladies fongiques.
Cible 7 du Cadre mondial pour la biodiversité
- Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal appuiera l’excellent travail que les producteurs agricoles canadiens accomplissent déjà pour protéger la nature et la biodiversité.
- L’engagement (cible 7) visant à réduire les risques de pollution liés à l'excès de nutriments, aux pesticides, aux produits chimiques très dangereux et aux plastiques ne correspond pas à une réduction obligatoire de l’utilisation des pesticides.
Peste porcine africaine
- Nous comprenons les conséquences qu’aurait la détection d’un cas de peste porcine africaine sur les familles de producteurs agricoles. Nous continuerons de collaborer avec l’industrie et les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la propagation et soutenir l’avenir de l’industrie porcine du Canada.
Stratégie nationale sur la main-d’œuvre agricole
- Nous savons que de nombreux intervenants du secteur ont eu du mal à trouver des travailleurs. Nous travaillons à l’élaboration d’une Stratégie nationale sur la main-d'œuvre agricole afin que l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement ait accès à une main-d’œuvre qualifiée et fiable pour que nous puissions continuer de nourrir le Canada et le monde entier.
Code de conduite des épiceries
- Nous reconnaissons que les dirigeants de l’industrie ont réalisé des progrès importants pour ce qui est de l’élaboration du tout premier code de conduite des épiceries au Canada. Il contribuera au renforcement de la chaîne d’approvisionnement, et j’attends sa mise en œuvre avec impatience.
Commerce, accès aux marchés et développement des marchés
- Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires du Canada continuent de croître, atteignant une valeur de près de 93 milliards de dollars en 2022, contre 82 milliards de dollars en 2021.
- Je me réjouis de continuer à travailler avec mes collègues et avec le secteur pour tirer parti de nos 14 accords de libre-échange afin de maximiser les débouchés pour les produits agricoles et agroalimentaires canadiens.
- Nous collaborons également avec les provinces et les territoires pour continuer d’explorer des solutions novatrices visant à améliorer le commerce intérieur dans le secteur alimentaire.
Fièvre aphteuse/traçabilité des animaux d’élevage/maladies animales
- Le Canada est reconnu comme un chef de file international lorsqu’il s’agit de prévenir et de contrôler la propagation de maladies animales exotiques au pays.
- L’Agence canadienne d’inspection des aliments se consacre à la protection de la santé animale et à la prévention de l’introduction et de la propagation de maladies animales. J’attends avec impatience les renseignements que me fournira l'Agence sur ces questions.
Durabilité de l’industrie apicole
- La durabilité de l’industrie apicole est importante pour le gouvernement fédéral et nous collaborons avec les provinces et des intervenants au sujet de la santé des abeilles domestiques.
- Pour contribuer à l’atteinte de nos objectifs en matière de durabilité, AAC a mis sur pied un groupe de travail industrie-gouvernement sur la viabilité des abeilles qui se réunit depuis mai 2022.
Gestion de l’offre
- Le gouvernement est entièrement solidaire de notre secteur sous gestion de l'offre, qui soutient nos exploitations familiales et favorise la vitalité de nos zones rurales.
-
Peste porcine africaine
Aperçu et réponse d'Agriculture et Agroalimentaire Canada
Secteur canadien du porc
La contribution du secteur canadien du porc à l’économie est évaluée à 28 milliards de dollars et soutient environ 100 000 emplois. (Source : Conseil canadien du porc).
Il y a 7330 exploitations porcines et 26 installations de transformation. En 2022, 28 millions de porcs ont été produits. Les stocks se concentrent au Québec (31 %), en Ontario (26 %) et au Manitoba (23 %).
La capacité d’abattage aussi se trouve principalement au Québec (38 %), en Ontario (19 %) et au Manitoba (28 %).
Actuellement, 13 millions de porcs sont en cours de production.
Le secteur porcin canadien est fortement intégré au secteur américain.
En 2022, plus de 1,39 million de tonnes de porc, d’une valeur de 4,8 milliards de dollars, ont été exportées vers 77 pays.
Les trois principaux marchés pour le porc canadien sont les États-Unis, le Japon et la Chine.
Peste porcine africaine
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie contagieuse et mortelle pour les porcs qui s’est propagée en Afrique, en Asie, dans certaines régions d’Europe et, plus récemment, en République dominicaine et à Haïti.
Bien que la maladie ne puisse pas être transmise à l’homme, elle présente un taux de mortalité élevé chez les porcs infectés et peut survivre pendant des périodes prolongées dans les produits d’origine animale.
Un seul cas positif de la PPA au Canada exigerait l’arrêt immédiat de toutes les exportations de porc et de porcs vivants (70 % de la production nationale). Les conséquences financières seraient importantes pour les producteurs et les transformateurs, qui seraient aux prises avec des pertes de marchés et des baisses de prix causées par une offre excédentaire de viande de porc par rapport à la demande intérieure.
Premières conséquences
Gestion de la maladie et éradication : L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée de contenir et d’éradiquer la maladie le plus rapidement possible.
Commerce : Perte immédiate de tous les marchés d’exportation (70 % de la production nationale).
Porcs excédentaires : En cas de fermeture de la frontière, des millions d’animaux excédentaires devraient être abattus, ce qui entraînerait des coûts extraordinaires pour l’industrie et susciterait des inquiétudes quant au bien-être des animaux, à la santé mentale des agriculteurs et à l’environnement.
Producteurs de porcs : Les porcs sans marché retarderaient le cycle de production du porc, et les décisions de dépeuplement devraient être prises rapidement. Il serait urgent d’euthanasier les porcs vivants destinés aux États-Unis.
- On estime qu’il faudrait réformer au moins 50 % du cheptel porcin (7 millions de porcs).
Transformateurs de porcs : Les transformateurs perdraient du jour au lendemain la majorité de leur marché. Les transformateurs orientés vers l’exportation ou les établissements de plus petite taille pourraient éventuellement cesser leurs activités.
- Les transformateurs ne seraient pas en mesure d’assumer le travail supplémentaire de dépeuplement et d’élimination des porcs excédentaires des producteurs sans aide pour couvrir les coûts extraordinaires.
Efforts actuels de prévention et de préparation
L’ACIA et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) ont joué un rôle actif dans l'élaboration et l'exécution d'un plan d’action pancanadien contre la PPA, un effort fédéral-provincial-territorial (FPT) – industrie visant à coordonner et à prioriser les travaux de prévention et de préparation liés à la PPA dans tout le pays.
En décembre 2021, la ministre a reçu le mandat de : « prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l’entrée de la peste porcine africaine au pays et continuer de collaborer avec les provinces et territoires et avec les intervenants de l’industrie à l’établissement de mesures de prévention et de préparation, notamment un plan d’intervention à coûts partagés ».
Les travaux avec les partenaires des provinces et de l’industrie sont en cours
En août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement maximal de 45,3 millions de dollars pour accroître les efforts visant à prévenir l’entrée de la PPA au Canada et à se préparer à une éventuelle éclosion. Cet investissement est réparti comme suit :
- 23,4 millions de dollars à AAC pour soutenir les efforts de prévention et d’atténuation de l’industrie. Le programme a été lancé le 16 novembre 2022;
- 19,8 millions de dollars à l’ACIA pour financer la surveillance et les activités internationales;
- 2,1 millions de dollars pour renforcer les activités de contrôle frontalier de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Plan d’action pancanadien pour lutter contre la PPA
Jusqu’à présent, il y a eu une coordination importante avec les provinces et les groupes industriels pour faire avancer le Plan d’action pancanadien pour lutter contre la PPA.
Volets du plan d’action
- Volet 1 : Prévention et renforcement de la biosécurité
- Volet 2 : Planification de la préparation
- Volet 3 : Assurer la continuité des activités
- Volet 4 : Communication coordonnée des risques
Volet 1 : Prévention et renforcement de la biosécurité
Première ligne de défense pour protéger la population porcine canadienne de la PPA en limitant les sources potentielles d'introduction de virus.
Prévenir l’entrée de la PPA au Canada et réduire la propagation en cas d’entrée :
- Contrôles des importations. Guidé par : ASFC et ACIA
- Biosécurité. Guidé par : ACIA et industrie
- Mobilisation internationale. Guidé par : ACIA
- Autorités pour les cochons sauvages. Guidé par : Plusieurs ministères (AAC, Environnement et Changement climatique Canada, etc.), associations de l’industrie et homologues des États-Unis (département de l’Agriculture [USDA] et Service d’inspection de la santé animale et végétale [APHIS])
Volet 2 : Planification de la préparation
Une intervention précoce et rapide contre la maladie sera essentielle pour arrêter la propagation du virus et atténuer les conséquences d’une éclosion.
- Diagnostic et surveillance. Guidé par : ACIA
- Plans et procédures d'intervention. Guidé par : gouvernements provinciaux, ACIA et industrie
- Formation et exercices. Guidé par : ACIA, gouvernements provinciaux et industrie
Volet 3 : Assurer la continuité des activités
Les conséquences d'une épidémie de PPA peuvent être atténuées en collaborant de façon proactive avec les partenaires commerciaux et en fournissant un soutien pour aider le secteur à s’adapter aux changements du marché.
Zonage - Guidé par ACIA et industrie
Le zonage est une méthode de contrôle des maladies reconnue à l’échelle internationale qui permet également de gérer les risques commerciaux. Une zone peut être établie autour d’une région définie, en fonction de la géographie.
Le Canada a confirmé les accords de zonage avec certains partenaires commerciaux et travaille à la mise en place de nouveaux accords.
Cloisonnement - Guidé par ACIA et industrie
Le cloisonnement est une méthode de contrôle des populations volontaire et distincte qui doit être utilisée avant l’entrée de la PPA. Elle est basée sur les pratiques de gestion et de biosécurité plutôt que sur la géographie.
L’acceptation du cloisonnement devra être négociée avec les partenaires commerciaux.
Intervention en cas d’interruption du marché - Guidé par AAC, gouvernements provinciaux et industrie
Interventions immédiates : Élaboration d'une approche coordonnée et collaborative à l'échelle nationale pour la gestion des porcs excédentaires, avec une certaine marge de manœuvre pour les besoins régionaux. Il s'agit notamment d'évaluer la capacité des infrastructures à assurer le dépeuplement et d'investir dans ce sens. AAC a également mis en place un système de gestion des incidents.
Interventions à plus long terme : Adaptation de l'industrie et planification de la transition sectorielle.
La peste porcine africaine (PPA) pourrait s’introduire au Canada à tout moment
Accords de zonage actuels relatifs à la PPA : États-Unis, Union européenne, Singapour, Viet Nam, Hong Kong.
Peste porcine africaine

Source : L'Organisation mondiale de la santé animale (WOAH).
[Description de l’image ci-dessous]
Carte du monde indiquant les zones touchées par la PPA à l’été 2023, notamment la République dominicaine et Haïti dans les Amériques, ainsi que des parties de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe. La PPA continue de se propager à l’échelle mondiale, ce qui accroît le risque qu’elle entre au Canada.
Volet 4 : Communication coordonnée des risques
Des travaux sont en cours pour élaborer des plans de communication sur les risques afin d’aborder les mesures de prévention, de préparation, d’intervention et de relance dans le contexte de la PPA.
Industrie, ACIA, AAC, gouvernements provinciaux
Prévention
- Campagnes de sensibilisation
- Voyageurs et population canadienne
Préparation
- Messages prévus
- Confiance du public
- Coordonner les communications entre tous les acteurs
Approche par phases en matière d’intervention d’urgence
Les gouvernements FPT adoptent une approche par phases en matière de planification.
Phase 0 : Prévention et préparation
Des travaux sont en cours pour mettre en place des programmes et des ressources avant une introduction de PPA, afin de réduire le risque d’entrée de la PPA au Canada et d’aider l’industrie et les gouvernements à se préparer à intervenir.
- Programme de préparation de l’industrie à la peste porcine africaine (PPIPPA) du gouvernement du Canada (23,4 millions de dollars sur 3 ans).
- Travaux de l’ACIA sur le zonage et l’intervention en cas de maladie.
Phase 1 : Intervention immédiate
Cette phase est déclenchée dès qu’un cas de PPA est détecté au Canada ou aux États-Unis. Il s’agit d’une phase d’intervention d’urgence axée sur la gestion des porcs excédentaires sains.
Phase 2 : Crise du secteur et soutien à la transition
Un soutien supplémentaire à l’adaptation des troupeaux et à la restructuration du secteur pourrait être requis pour aider l’industrie porcine à répondre aux nouvelles conditions du marché créées par la PPA.
Phase 3 : Soutien à la relance du secteur
À la toute fin d’une éclosion, alors que les frontières commencent à rouvrir, le secteur devra reprendre ses activités et s’adapter au développement des marchés.
Progrès récents
- Au printemps 2023, à la demande des ministres FPT, des activités de mobilisation de l’industrie ciblant les besoins en matière d’intervention immédiate ont été réalisées, principalement sous la forme :
- d’un exercice de simulation sous-ministres FPT-industrie;
- d’un sous-groupe sur l’intervention en cas de PPA du Groupe de travail sur l’approvisionnement en porcs.
- Des consultations continues sont tenues auprès des provinces et de l’industrie, par l’entremise des groupes de travail existants, pour discuter de l’intervention en cas de PPA et de la préparation à une éventuelle éclosion.
- Réunion des ministres FPT en mars / avril 2023.
- Discussion tenue à la réunion annuelle des ministres FPT, en juillet 2023.
Annexe : Rôles et responsabilités
ASFC
- Appliquer des contrôles à l'importation pour empêcher l'entrée de PPA au Canada.
ACIA
- Diriger les activités de contrôle et d’éradication des maladies.
- S’occuper de l’indemnisation des animaux éliminés, le cas échéant.
- Obtenir l’acceptation internationale des approches de zonage et de cloisonnement.
- Diriger la stratégie pour retrouver le statut de zone indemne et l’acceptation internationale.
AAC
- Aider les gouvernements provinciaux à développer des programmes à coûts partagés pour les efforts de dépeuplement et d’élimination (y compris le maintien des animaux en attente de dépeuplement par compassion).
- Coordonner les discussions dans les domaines relevant de plusieurs juridictions, comme les abattages par compassion dans les usines de transformation, afin de faciliter une approche cohérente et nationale.
- Élaborer et offrir des programmes de soutien fédéraux, le cas échéant, qui répondent aux besoins nationaux.
- Diriger les communications publiques en réponse à une perturbation des marchés et au problème des porcs excédentaires, en collaboration avec les partenaires des provinces, des territoires et de l’industrie.
Industrie
- Gérer de manière proactive les risques de l’entreprise en tirant parti des programmes existants ainsi que des outils privés de gestion des risques, et prendre des décisions commerciales en fonction des conditions du marché.
- Mettre en œuvre des normes de biosécurité à la ferme pour aider à atténuer l’introduction de maladies.
- Diriger les activités de dépeuplement et d’élimination des porcs excédentaires sur le terrain, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de biosécurité, avec le soutien des gouvernements FPT, si nécessaire.
Gouvernements provinciaux et territoriaux
- Coordonner les efforts de dépeuplement et d’élimination des porcs excédentaires sur le terrain, avec l’aide d’AAC (par exemple, transfert de fonds, coordination, surveillance, soutien en matière de bien-être et de santé mentale).
- Coordonner l’élaboration d’une stratégie de gestion des porcs excédentaires sains dans les provinces.
- Faciliter la mise en œuvre des options d’élimination de masse des carcasses, et travailler avec les municipalités pour mettre en place les capacités nécessaires.
- Élaborer et offrir des programmes de soutien qui répondent aux besoins de la région et du secteur, en collaboration avec les municipalités et l’industrie.
-
Partenariat canadien pour une agriculture durable
Contexte – Les accords-cadres en agriculture
Les accords-cadres quinquennaux sont la pierre angulaire du soutien fédéral, provincial et territorial (FPT) au secteur agricole et agroalimentaire.
Depuis 2003, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a travaillé en partenariat avec les provinces et les territoires sur les cinq cadres suivants :
- Cadre stratégique pour l’agriculture (2003-2008)
- Cultivons l’avenir (2008-2013)
- Cultivons l’avenir 2 (2013-2018)
- Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) (2018-2023)
- Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) (2023-2028)
Le PCA et les cadres précédents ont permis aux gouvernements FPT de collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes pour aider le secteur à relever les défis et à saisir les débouchés, en encourageant l’investissement, l’adaptation et la croissance durable.
Si chaque nouveau cadre est l’occasion de proposer une nouvelle approche pour soutenir le secteur, il se fonde également sur les enseignements tirés de l’ensemble des cadres précédents pour assurer la continuité et apporter des modifications afin de répondre à l’évolution des priorités et des besoins.
Aperçu du Partenariat canadien pour l’agriculture
Le Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) visait à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Ce partenariat FPT comprenait un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) dans des initiatives stratégiques et le financement de programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) (1,7 milliard de dollars par an en moyenne).
Initiatives stratégiques
- Plus de 1 milliard de dollars en programmes et activités fédéraux de portée nationale financés et exécutés par AAC.
- 2 milliards de dollars dans des programmes à frais partagés financés selon un ratio 60:40 (F:PT) et exécutés par les gouvernements provinciaux et territoriaux.
Programmes de gestion des risques de l’entreprise
Une moyenne de 1,7 milliard de dollars annuellement (soutien fédéral et provincial / territorial combiné) pour les programmes de GRE qui visent à aider les producteurs à gérer les risques importants menaçant la viabilité de leur exploitation et dépassant leur capacité de gestion.
Principaux changements apportés au PCA durable par rapport au PCA
Le PCA durable s’appuie sur les cinq domaines prioritaires du PCA, en mettant davantage l’accent sur l’atteinte des objectifs environnementaux, économiques et sociaux.
- Renforcer l’action en matière de changements climatiques et d’environnement à l’échelle du cadre.
- Mettre à jour la série de programmes de GRE pour qu’ils soient plus simples, plus opportuns et plus prévisibles, et étudier les possibilités d’intégrer le risque climatique et la préparation aux changements climatiques.
- Renforcer l’approche à l’égard de la mesure du rendement et des résultats avec des objectifs communs complétés par des exigences de dépenses proportionnelles.
- Accroître les efforts pour encourager la participation des groupes sous-représentés dans le secteur.
- Améliorer continuellement la science et l’innovation, le développement des marchés et le commerce, et mettre davantage l’accent sur d’autres domaines d’intérêt (par exemple, main‐d’œuvre, participation des Autochtones et santé mentale).
- Tenir compte de l’approche à l’égard du développement durable et de la concurrence dans l’ensemble du cadre.
Aperçu de la conférence annuelle des ministres – Juillet 2022
Le 22 juillet 2022, les ministres FPT de l’Agriculture ont annoncé le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable), qui trace une feuille de route ambitieuse pour faire avancer les cinq priorités convenues dans l’Énoncé de Guelph.
Ce nouvel accord quinquennal permet d'injecter 500 millions de dollars en fonds nouveaux, ce qui représente une augmentation de 25 % de la portion à coûts partagés du PCA durable par rapport à ce qui était fourni dans le cadre du PCA.
Les ministres ont également convenu de la nécessité de se doter d’une stratégie en matière de résultats plus solide pour le PCA durable, notamment en ce qui concerne l’amélioration de l'échange de données, la production de rapports sur les résultats et un engagement à contribuer à l’atteinte de résultats communs et mesurables pendant la durée de vie du cadre, en particulier :
- réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 3 à 5 Mt;
- générer 250 milliards de dollars en revenus et 95 milliards de dollars en revenus d’exportation pour le secteur d’ici 2028;
- accroître la proportion des bénéficiaires de financement qui sont des Autochtones, des femmes et des jeunes au cours des cinq années du Partenariat.
Les ministres se sont entendus au sujet d’un nouveau Programme de paysages agricoles résilients (PPAR), un investissement FPT de 250 millions de dollars qui appuie l’offre de produits et de services écologiques dans le secteur agricole.
Les ministres ont convenu que 12,5 % des dépenses à frais partagés (« dépenses proportionnelles ») seraient consacrées à des activités qui visent à réduire les émissions de GES ou à accroître la séquestration du carbone.
Des changements seront aussi apportés aux programmes de GRE, notamment :
- Le taux d’indemnisation d’Agri-stabilité passera de 70 % à 80 %, ce qui permettra de dégager jusqu’à 72 millions de dollars supplémentaires par année pour mieux soutenir les producteurs agricoles dans les moments difficiles.
- À compter de 2025, les participants d’Agri-investissement dont les ventes nettes admissibles (VNA) sont plus de 1 million de dollars devront avoir une évaluation des risques agroenvironnementaux (par exemple, un Plan environnemental de la ferme) pour être admissibles à la contribution gouvernementale de contrepartie.
- Les PT et AAC vont mener un examen d’un an sur la façon de tenir compte, dans les primes d’Agri-protection, des pratiques environnementales des producteurs qui ont pour effet de réduire le risque pour la production. Après cet examen, chaque PT lancera un projet pilote sur les primes d’Agri-protection.
- AAC, en consultation avec les PT, va entreprendre un examen exhaustif sur l’intégration des risques climatiques aux programmes de GRE.
Principaux jalons vers la mise en œuvre du PCA durable
Énoncé de Guelph
L’Énoncé de Guelph, annoncé par les ministres FPT le 17 novembre 2021, décrit la vision, les priorités et les principes directeurs du cadre qui fera suite au PCA.
Accord-cadre multilatéral
L’Accord-cadre multilatéral (ACM) décrit les rôles et les responsabilités des gouvernements FPT et un engagement à mettre en œuvre des politiques et des programmes qui respectent la vision et les priorités décrites dans l’Énoncé de Guelph.
Les négociations FPT concernant l’ACM ont commencé à l’automne 2021.
L’ACM a été achevé le 31 janvier 2023.
AAC a reçu l’autorisation par décret de signer l’ACM le 13 février 2023.
En mars 2023, les PT ont fourni suffisamment de signatures pour que l’ACM remplisse les conditions d’entrée en vigueur.
Accords bilatéraux
AAC participe à des négociations avec les PT concernant des accords bilatéraux décrivant les détails des programmes, les activités et les dépenses prévues pour les 2,5 milliards de dollars de l'enveloppe à coûts partagés du cadre.
Le PCA durable est entré en vigueur le 1er avril 2023.
Les négociations sont terminées pour presque tous les accords bilatéraux. AAC devrait signer la version définitive de l’accord bilatéral avec l’Île-du-Prince-Édouard au cours des prochaines semaines.
Leçons retenues
Comme pour les cadres précédents, AAC produira un rapport sur les leçons retenues de l'élaboration du PCA durable, qui documentera le processus et fournira des orientations pour les prochains cadres.
Le rapport comprendra ce qui suit :
- Un examen du processus d’élaboration de politiques, y compris la mobilisation interne liée aux priorités fédérales, l’évaluation du cadre actuel et la rédaction de documents stratégiques;
- La gestion du processus FPT – l’établissement d’un consensus avec les provinces et les territoires sur la vision, les priorités et les résultats, et les négociations sur le cadre multilatéral et les accords bilatéraux;
- La mobilisation des intervenants et les interactions au sein du ministère et avec les organismes centraux;
- La détermination des questions en suspens ou non résolues à prendre en compte dans les prochains cadres (par exemple, modification de la formule de répartition, inclusion de l’aquaculture ou de l’aquaponie, etc.)
Les commentaires des principaux contributeurs au cadre, tant à AAC (par exemple, responsables des politiques, experts en la matière, exécution des programmes et résultats) qu’à l’extérieur d'AAC (par exemple, membres du groupe de travail PT et organismes centraux), permettront d’orienter l’évaluation et l’analyse présentées dans le rapport.
Le rapport devrait être achevé au début de l’automne.
-
Programmes de gestion des risques de l’entreprise
Pourquoi la gestion des risques de l’entreprise?
Le secteur agricole canadien fait face à des risques qui peuvent avoir une grande incidence sur la viabilité des exploitations agricoles :
- Saison de croissance courte, phénomènes météorologiques extrêmes, maladie, organismes nuisibles
- Secteur petit, dépendant de l’exportation et vulnérable à la volatilité des marchés, aux fluctuations du taux de change et aux politiques commerciales des gouvernements étrangers
Les programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) sont en mesure d’aider les producteurs agricoles à gérer ces risques :
- Des programmes de GRE sont en place pour aider les producteurs à gérer les conséquences de risques tels que les sécheresses, les inondations, les prix bas et la hausse du coût des intrants;
- Puisque les producteurs ont tous des besoins différents, différentes combinaisons de programmes fonctionnent mieux pour chaque producteur.
Les programmes de GRE sont régis par la Loi sur la protection du revenu agricole et les accords-cadres multilatéraux fédéral-provinciaux-territoriaux (FPT).
- Ces instruments comprennent des principes généraux convenus, tels que : respecter les obligations commerciales du Canada; offrir des programmes équitables à l’échelle nationale; fausser le moins possible les décisions de production et de commercialisation.
Évolution des programmes de gestion des risques de l’entreprise
Au départ, les programmes de GRE étaient axés sur la protection du revenu, tandis qu’aujourd’hui, ils visent plutôt à stabiliser le revenu, afin d’aider les producteurs touchés par la forte volatilité des marchés, des pertes importantes ou des catastrophes.
Années 1980 et 1990
Programmes tripartites / Partenaires dans la croissance
- Les programmes tripartites visaient des produits particuliers, en fonction des besoins régionaux
- Les programmes de protection du revenu ont introduit le Régime d’assurance-revenu brut, un soutien fondé sur le revenu, et les économies subventionnées du Compte de stabilisation du revenu net
- Le Programme d’aide en cas de catastrophe liée au revenu agricole a été le premier programme à prévoir un « soutien au revenu en cas de catastrophe » en fonction des marges de la totalité de l’exploitation
2003 à 2008
Cadre stratégique pour l’agriculture
- Axé sur la GRE et la stabilisation du revenu; a introduit les programmes non liés à la GRE
- Les principaux programmes de GRE étaient le Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (couverture de la marge à 100 %) et le Programme d’assurance production
- Thèmes non liés à la GRE : environnement; salubrité et qualité des aliments; innovation; renouvellement; international
- Programmes à coûts partagés selon un ratio de 60:40 fédéral-provincial, applicables à l’échelle nationale
2008 à 2013
Cultivons l’avenir (CA)
- La création de deux nouveaux programmes – Agri-investissement et Agri-relance – répond aux préoccupations concernant les délais de réponse et la prévisibilité du Programme canadien de stabilisation du revenu agricole
- Les programmes de GRE étaient jugés trop exhaustifs, car ils couvraient les risques normaux qui devraient être gérés par les producteurs
- Une souplesse provinciale a été ajoutée aux programmes non liés à la GRE
- Thèmes non liés à la GRE : compétitivité, innovation, priorités de la société et gestion proactive des risques
2013 à 2018
Cultivons l’avenir 2 (CA2)
- Les programmes de GRE ont été modifiés pour encourager les producteurs à gérer les risques normaux, et les gouvernements à se concentrer sur la forte volatilité du marché et les catastrophes
- Investissements pour stimuler l’élaboration d’outils de gestion des risques par le secteur privé, notamment en ce qui concerne les assurances (Agri-risques)
- Une partie des économies découlant de la GRE a été réinvestie dans des initiatives stratégiques (non liées à la GRE)
- Les initiatives stratégiques sont axées sur l’innovation, la compétitivité et le développement des marchés
2018 à 2023
Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA)
- Le PCA (2018-2023) maintient l’orientation stratégique de CA2 et répond aux préoccupations du secteur en ce qui concerne la protection offerte par Agri-stabilité en offrant un niveau d’aide plus équitable à tous les producteurs.
2023 à 2028
Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable)
- Conformément aux priorités en matière de résilience et de durabilité du PCA durable, les programmes de GRE évoluent au moyen de l’intégration d’éléments de programme liés à la préparation aux changements climatiques et du lancement d’un examen qui vise à déterminer comment ces programmes peuvent contribuer à réduire l’empreinte climatique de l’agriculture et encourager les producteurs agricoles à s’adapter aux changements climatiques.
Programmes de gestion des risques de l’entreprise actuels
On s’attend à ce que les producteurs gèrent leurs risques de manière proactive et à ce que bon nombre d’entre eux aient recours à une combinaison de pratiques à la ferme (par exemple, diversification des cultures) ainsi qu’aux programmes de GRE pour se prémunir contre les pertes, graves et moins graves.
Programmes de GRE FPT à coûts partagés :
- Agri-investissement – offre du soutien en cas de faibles baisses de revenu;
- Agri-stabilité – offre du soutien en cas de baisses de marge importantes;
- Agri-protection – offre du soutien en cas de pertes de production;
- Agri-relance – aide à couvrir les coûts exceptionnels engagés pour se remettre d’une catastrophe naturelle;
Agri-investissement
Compte d’épargne avec contribution de contrepartie du gouvernement pour faire face aux baisses de revenu ou faire des investissements permettant de gérer les risques à la ferme.
- Un compte d’épargne des producteurs, auquel les gouvernements contribuent :
- Les contributions sont fondées sur les ventes nettes admissibles (VNA) d’un producteur – ventes moins les achats de produits admissibles (par exemple, ventes de fleurs ou d’arbres moins les achats de semences ou de semis).
- Les producteurs peuvent déposer jusqu’à 100 % de leurs VNA chaque année, dont le premier 1 % est égalé dollar par dollar par les gouvernements (jusqu’à 10 000 $).
- Il faut d’abord retirer les contributions gouvernementales, qui sont imposables au moment du retrait.
- Il n’y a pas de déclencheur de retrait — les producteurs gèrent leurs comptes comme bon leur semble.
- Il y a plus de 2,6 milliards de dollars dans les comptes Agri-investissement, le solde moyen par compte étant d’environ 29 600 $ (en juillet 2023).
Partage des coûts du programme
- Fédéral, 60 %
- Provincial, 40 %
Exécution du programme
- Fédéral : Manitoba, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Alberta, Île-du-Prince-Édouard
- Provincial : Québec
Paiements FPT à ce jour, en janvier 2023 ($)
Cultivons l’avenir 2 (2013-2018) 1 391 273 064 Partenariat canadien pour l’agriculture (2018-2023)
995 142 525 Domaines de couverture ciblés
Soutien d’Agri-investissement
Fluctuations des prix du marché
Oui
Flux de trésorerie des exploitations
Oui
Augmentation des dépenses
Oui
Pertes de production ou de qualité
Oui
Investissements dans les outils de gestion des risques
Oui
Investissements dans les exploitations agricoles
Oui
Agri-stabilité
Programme individuel fondé sur la marge qui aide à faire face aux baisses importantes de la marge causées par la forte volatilité du marché et les catastrophes.
- Offre un soutien aux producteurs dont la marge diminue considérablement (plus de 30 %) au cours d’une année donnée par rapport à leurs marges historiques.
- À compter de 2023, le paiement représente 80 % des baisses de marge.
- Couvre tous les principaux risques liés au revenu d’une exploitation agricole dans le cadre d’un programme (c'est-à-dire, perte de revenu attribuable à des problèmes de production, baisse des prix des produits de base ou augmentation des coûts des intrants).
- La couverture est offerte pour la plupart des produits agricoles et est adaptée aux circonstances individuelles.
- Agri-stabilité a versé plus de 3 milliards de dollars aux producteurs depuis 2013.
Partage des coûts du programme
- Fédéral, 60 %
- Provincial, 40 %
Exécution du programme
- Fédéral : Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador
- Provincial : Colombie-Britannique, Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Québec, Saskatchewan, Ontario
Paiements FPT à ce jour, en janvier 2023 ($)
Cultivons l’avenir 2 (2013-2018) 1 607 553 449 Partenariat canadien pour l’agriculture (2018-2023) 1 445 909 066 Domaines de couverture ciblés
Soutien d’Agri-stabilité
Fluctuations des prix du marché
Oui
Flux de trésorerie des exploitations
Non
Augmentation des dépenses
Oui
Pertes de production ou de qualité
Oui
Investissements dans les outils de gestion des risques
Non
Investissements dans les exploitations agricoles
Non
Agri-protection
Protection contre les risques naturels (c'est-à-dire, sécheresse, inondation, vent, gel, pluies ou chaleur excessives, neige, pertes causées par des maladies incontrôlables, infestation d’insectes et animaux sauvages).
- Offre une protection contre les baisses de production attribuables à des risques naturels (par exemple, vent, gel, pluies ou chaleur excessives, neige, maladies et ravageurs)
- Les régimes d’assurance sont conçus par les administrations provinciales pour répondre aux besoins régionaux :
- Les provinces surveillent l’industrie (par exemple, nouvelles cultures, nouvelles techniques de production) et répondent aux besoins des producteurs en élaborant ou en adaptant des régimes d’assurance qui comblent les lacunes dans la couverture.
- Les producteurs choisissent les produits à assurer, le type de programme et le niveau de couverture, et les gouvernements paient une partie du coût des primes.
- En général, 60 % des primes sont payées par les gouvernements, et ceux-ci couvrent la totalité des coûts d’administration du programme.
- Des indemnités sont versées lorsque le volume ou la qualité de la production tombe en deçà du niveau de production assuré.
Partage des coûts du programme
- Fédéral, 36 %
- Provincial, 24 %
- Producteur, 40 %
Exécution du programme
- Provincial : les 10 provinces
Paiements FPT à ce jour, en janvier 2023 ($)
Cultivons l’avenir 2 (2013-2018) 5 171 822 278 Partenariat canadien pour l’agriculture (2018-2023) 5 485 309 238 Domaines de couverture ciblés
Soutien d’Agri-protection
Fluctuations des prix du marché
Non
Flux de trésorerie des exploitations
Non
Augmentation des dépenses
Non
Pertes de production ou de qualité
Oui
Investissements dans les outils de gestion des risques
Non
Investissements dans les exploitations agricoles
Non
Agri-relance
Cadre FPT qui facilite la mise en œuvre des mesures d’intervention élaborées par les gouvernements fédéral et provinciaux en cas de catastrophes naturelles, d’infestations de ravageurs ou d’éclosions.
- Mécanisme permettant aux gouvernements FPT d’élaborer des initiatives individuelles pour faire face à des catastrophes particulières selon des critères prédéfinis.
- Le cadre prévoit :
- un protocole pour l’interaction FPT;
- une définition de la catastrophe pour pouvoir déterminer lorsqu’une intervention est justifiée;
- des lignes directrices sur le type d’aide à fournir.
- Vise à aider à assumer les coûts exceptionnels nécessaires pour la relance après une catastrophe, et non à remplacer la protection offerte par les programmes Agri-protection, Agri-stabilité et Agri-investissement.
- Ne vise pas à fournir une aide en cas de catastrophes récurrentes, car une catastrophe récurrente pourrait indiquer qu’il faut chercher des options à plus long terme.
Partage des coûts du programme
- Fédéral, 60 %
- Provincial, 40 %
Exécution du programme
- Fédéral : au cas par cas
- Provincial : les 10 provinces
Paiements FPT à ce jour, en juillet 2023 ($)
Cultivons l’avenir 2 (2013-2018) 38 508 993 Partenariat canadien pour l’agriculture (2018-2023) 861 275 334 Domaines de couverture ciblés
Soutien d’Agri-relance
Fluctuations des prix du marché
Non
Flux de trésorerie des exploitations
Non
Augmentation des dépenses
Oui
Pertes de production ou de qualité
Non
Investissements dans les outils de gestion des risques
Non
Investissements dans les exploitations agricoles
Non
Programmes de gestion des risques de l’entreprise additionnels
Programmes de gestion des risques relevant exclusivement du gouvernement fédéral :
- L’assurance des prix du bétail (APB; ouest du Canada) permet aux producteurs de bovins et de porcs de contracter une assurance contre les baisses de prix imprévues, offrant ainsi une protection contre la volatilité du marché. Les producteurs paient 100 % des primes, tandis que les gouvernements FPT paient les coûts d’administration et le financement du déficit d’assurance couvert par le Canada. Le total des primes de l’APB recueillies se chiffre à 11,8 millions de dollars pour 2021-2022, à 15,6 millions de dollars pour 2022-2023 et à 8,1 millions de dollars en juin 2023 pour 2023-2024 (l’année de programme se termine en mars 2024).
- Le Programme de paiements anticipés est un programme de garantie de prêts qui offre aux producteurs un accès facile à des avances de fonds à faible taux d’intérêt en fonction de leur production future afin de fournir des liquidités et une certaine souplesse pour la commercialisation (un prêt annuel moyen de 2,8 milliards de dollars); et
- La Loi canadienne sur les prêts agricoles est un programme de garantie de prêt conçu pour que les producteurs aient plus facilement accès à des prêts, afin d’établir, d’améliorer et de développer des exploitations agricoles (prêts annuels moyens de 75 millions de dollars).
Améliorations aux programmes de gestion des risques de l’entreprise dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable
Les gouvernements FPT, qui continuent de collaborer à l’amélioration des programmes de GRE, ont convenu des points suivants :
- Entreprendre un processus d’examen pour évaluer comment les programmes de GRE peuvent contribuer positivement à réduire l’incidence de l’agriculture sur les changements climatiques, afin d’encourager les producteurs agricoles à s’adapter aux changements climatiques. L’examen évaluera également les conséquences financières des changements climatiques sur les programmes de GRE;
- Augmenter le taux d’indemnisation d’Agri-stabilité de 70 % à 80 % afin de mieux soutenir les producteurs en cas de besoin;
- Exiger que les grandes exploitations (ventes nettes ajustées de à 1 million de dollars ou plus) fassent l’objet d’une évaluation des risques agroenvironnementaux (par exemple, plan agroenvironnemental) d’ici 2025 pour pouvoir participer à Agri-investissement;
- Explorer la possibilité d’un modèle d’Agri-stabilité simplifié et accéléré;
- Dans le cadre d’Agri-protection, permettre aux provinces d’offrir aux producteurs un partage des coûts de l’ensemble de leur exploitation comme protection de rechange pour favoriser la diversification et la diminution des primes des producteurs;
- Offrir des rabais sur les primes d’Agri-protection aux producteurs qui adoptent des pratiques de gestion bénéfiques pour l’environnement qui réduisent aussi les risques liés à la production. Les provinces conviennent de mettre en œuvre un rabais pour l’adoption d’au moins une pratique de gestion bénéfique pendant la durée du cadre;
- Continuer d’explorer la possibilité d’un programme d’assurance du revenu de l’ensemble de l’exploitation agricole.
-
Catastrophes naturelles – sécheresse et feux de forêt
Agri-relance
Cadre fédéral-provincial-territorial (FPT) qui facilite la mise en œuvre des mesures d’intervention élaborées par les gouvernements fédéral et provinciaux en cas de catastrophes naturelles, d’infestations de ravageurs ou d’éclosions.
- Mécanisme permettant aux gouvernements FPT d’élaborer des initiatives individuelles pour faire face à des catastrophes particulières selon des critères prédéfinis.
- Le cadre prévoit :
- un protocole pour l’interaction FPT;
- une définition de la catastrophe pour pouvoir déterminer lorsqu' une intervention est justifiée;
- des lignes directrices sur le type d’aide à fournir.
- Vise à aider à assumer les coûts exceptionnels nécessaires pour la relance après une catastrophe, et non à remplacer la protection offerte par les programmes Agri-protection, Agri-stabilité et Agri-investissement (l’ensemble de programmes de gestion des risques de l’entreprise [GRE]).
- Ne vise pas à fournir une aide en cas de catastrophes récurrentes, car une catastrophe récurrente pourrait indiquer qu’il faut chercher des options à plus long terme.
Partage des coûts du programme
- Fédéral, 60 %
- Provincial, 40 %
Exécution du programme
- Fédéral : au cas par cas
- Provincial : les 10 provinces
Paiements FPT à ce jour, en date de juillet 2023 ($)
Cultivons l’avenir 2 (2013-2018) 38 508 993
Partenariat canadien pour l’agriculture (2018-2023) 861 275 334 Domaines de couverture ciblés
Soutien d’Agri-relance
Fluctuations des prix du marché
Non
Flux de trésorerie des exploitations
Non
Augmentation des dépenses
Oui
Pertes de production ou de qualité
Non
Investissements dans les outils de gestion des risques
Non
Investissements dans les exploitations agricoles
Non
Cadre d’Agri-relance
Agri-relance prévoit un processus permettant aux gouvernements FPT de mettre en œuvre, dans certaines circonstances déterminées, des initiatives ponctuelles destinées à aider les producteurs touchés par une catastrophe naturelle, une maladie ou une infestation de ravageurs.
L’objectif du cadre d’Agri-relance est d’aider les producteurs à faire face aux coûts exceptionnels associés à la reprise de leurs activités commerciales aussitôt que possible après une catastrophe.
D’autres programmes de GRE sont offerts pour aider les producteurs à assumer les pertes de production ou de revenu.
Les interventions d’Agri-relance prévoient généralement une pleine participation aux programmes de GRE offerts.
Les initiatives du programme Agri-relance sont déterminées par des évaluations conjointes fondées sur les renseignements fournis par la province ou le territoire qui demande l’aide.
Agri-relance s’inscrit dans le cadre d’une intervention générale du gouvernement du Canada en cas de catastrophe. La mise au point des interventions au titre d’Agri-relance dépend souvent de la mise au point d’autres interventions gouvernementales n’étant pas liées à l’agriculture, prévues notamment dans le cadre des Accords d’aide financière en cas de catastrophe du gouvernement fédéral mis en œuvre par Sécurité publique Canada.
Agri-relance — sécheresse et feux de forêt en 2023
Compte tenu des phénomènes météorologiques extrêmes des dernières années, Agri-relance s’est avéré un outil important.
Récemment, la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan ont présenté à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) des demandes officielles d’évaluation au titre du programme Agri-relance visant les répercussions des conditions de sécheresse actuelles. AAC a également reçu une demande de l’Alberta concernant les feux de forêt.
- En ce qui concerne les feux de forêt, l’Alberta souhaite attendre la fin de la saison avant de fournir les renseignements requis pour une évaluation. L’évaluation de la Colombie-Britannique portera à la fois sur les répercussions des feux de forêt et de la sécheresse.
- En ce qui concerne les conditions de sécheresse, les représentants d’AAC travaillent actuellement avec leurs homologues provinciaux sur les évaluations conjointes afin de déterminer si la catastrophe répond aux critères du cadre d’Agri-relance.
- Ces évaluations permettront de déterminer si les initiatives d’Agri-relance sont justifiées et d’établir la nature du soutien nécessaire pour aider les producteurs à faire face aux coûts exceptionnels liés à la reprise de leurs activités.
- L’intervention d’Agri-relance visant la sécheresse de 2021, qui prévoyait un soutien aux provinces de l’Ouest et à l’Ontario, a coûté près de 440 millions de dollars (contribution de 60 % du gouvernement fédéral).
- Les interventions du programme Agri-relance pour faire face à la sécheresse actuelle nécessiteraient des autorisations supplémentaires en matière de politiques et de financement, excédant le budget annuel standard de 118 millions de dollars.
-
Politique alimentaire pour le Canada
Qu’est-ce qu’une politique alimentaire?
Cadre
Une vision globale, des principes directeurs et des résultats à long terme favorisant une approche fondée sur les « systèmes alimentaires » qui tient compte des liens entre les personnes, les processus et les produits touchés par tous les aspects de l’approvisionnement en denrées alimentaires et de ses incidences sociales, sanitaires, environnementales et économiques.
Collaboration
Des structures de gouvernance et une mobilisation inclusive qui favorisent une approche à laquelle tous les intervenants peuvent participer en vue d’une collaboration entre les ministères fédéraux et avec les différents acteurs et partenaires du système alimentaire, y compris le secteur, la société civile, le milieu universitaire et les peuples autochtones.
Initiatives
Des investissements coordonnés dans des domaines d’action à court terme au sein de plusieurs ministères et organismes qui cherchent à résoudre les problèmes émergents des systèmes alimentaires et à combler les principales lacunes des programmes fédéraux liés à l’alimentation.
Politique alimentaire pour le Canada
Vision
Toutes les personnes vivant au Canada peuvent avoir accès à une quantité suffisante d’aliments salubres, nutritifs et diversifiés sur le plan culturel. Le système alimentaire du Canada est résilient et novateur, protège notre environnement et soutient notre économie.
Résultats à long terme
- Amélioration des résultats pour la santé liés à l’alimentation
- Croissance économique inclusive
- Communautés florissantes
- Liens accrus au sein des systèmes alimentaires
- Pratiques alimentaires durables
- Robustes systèmes alimentaires autochtones
Principes directeurs
- Inclusion et diversité
- Réconciliation
- Collaboration
- Innovation
- Durabilité
- Données probantes et imputabilité
Domaines d’action à court terme
- Aider les collectivités canadiennes à avoir accès à des aliments sains
- Faire des aliments canadiens le premier choix des consommateurs au Canada et à l’étranger
- Assurer la sécurité alimentaire dans les collectivités nordiques et autochtones
- Réduire le gaspillage alimentaire
Gouvernance de la politique alimentaire
Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada
- Organisme consultatif externe qui reflète les divers points de vue de différents acteurs du système alimentaire, notamment du domaine de la santé, des services sociaux, du milieu universitaire et de l’industrie.
- Fournit à la ministre des conseils visant à améliorer les systèmes alimentaires du Canada.
- Lancé avec 24 membres en février 2021; il compte actuellement 19 membres.
- On prépare actuellement la relève des membres; le processus de candidature a été ouvert le 6 juillet.
- La ministre a proposé une nouvelle orientation pour le Conseil, qui a été mise en œuvre lors de la première réunion en personne en novembre 2022.
Comité interministériel sur la politique alimentaire
Tribune permettant aux sous-ministres adjoints (SMA) de discuter de l’amélioration de la cohérence entre les politiques fédérales liées à l’alimentation, qui constitue également un point de convergence entre les comités qui ont une incidence sur l’alimentation ou qui sont touchés par l’alimentation.
Comprend des représentants de :
- Agence canadienne d’inspection des aliments
- Santé Canada
- Agence de la santé publique du Canada
- Pêches et Océans Canada
- Environnement et Changement climatique Canada
- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
- Services aux Autochtones Canada
- Statistique Canada
- Innovation, Science et Développement économique Canada
- Emploi et Développement social Canada
- Secrétariat du Conseil du Trésor
- Affaires mondiales Canada
Initiatives liées à la politique alimentaire
Aider les collectivités canadiennes à avoir accès à des aliments sains (sur la bonne voie)
- Fonds des infrastructures alimentaires locales (70 millions de dollars sur 5 ans) (AAC)
- Lutte contre la fraude alimentaire (24,4 millions de dollars sur 5 ans) (ACIA)
- Intervention contre la COVID-19 Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire (330 millions de dollars) (AAC)
Faire des aliments canadiens les aliments de premier choix au Canada et à l’étranger (sur la bonne voie)
- Initiative Agri-communication (25 millions de dollars sur 5 ans) (AAC)
- Volet 1 : Promotion de l’agriculture durable
- Programme Agri-communication (8 millions de dollars sur 3 ans)
- Campagne Du cœur dans chaque bouchée / Programme renouvelé de la marque Canada
- Volet 2 : Amélioration de la compréhension par le secteur de l’évolution de la demande des consommateurs
- Volet 1 : Promotion de l’agriculture durable
Appuyer la sécurité alimentaire dans les communautés nordiques et autochtones (sur la bonne voie)
- Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (15 millions de dollars sur 5 ans) (Agence canadienne de développement économique du Nord)
Réduire le gaspillage alimentaire (sur la bonne voie)
- Défi de réduction du gaspillage alimentaire (20 millions de dollars sur 4 ans) (AAC)
- Leadership fédéral en réduction du gaspillage alimentaire (6,3 millions de dollars sur 5 ans dans les autorisations existantes) (AAC)
- Intervention contre la COVID-19, Programme de récupération d’aliments excédentaires (50 millions de dollars) (AAC)
Jalon
2015
- Lettre de mandat de la ministre lui demandant de s’engager à élaborer une politique alimentaire
2017
- Tables rondes approfondies avec les intervenants, séances dirigées par les organisations autochtones nationales (OAN) et participation en ligne de 45 000 Canadiens
2018
- Publication du rapport sur les consultations
2019
- Budget de 2019 et lancement ministériel de la Politique alimentaire pour le Canada : Tout le monde à table
- Fonds des infrastructures alimentaires locales (70 millions de dollars, y compris des montants complémentaires en 2021 et en 2023)
- Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (15 millions de dollars)
2020
- Défi de réduction du gaspillage alimentaire (20 millions de dollars)
- Programme de lutte contre la fraude alimentaire (24,4 millions de dollars)
- Réaction à la COVID-19
- Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire (330 millions de dollars)
- Programme de récupération d’aliments excédentaires (50 millions de dollars)
2021
- Conseil consultatif de la Politique alimentaire du Canada et Programme Agri‑communication (8 millions de dollars)
- Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies
2023
- Marque Canada et Campagne Du cœur dans chaque bouchée
Politique alimentaire de 2019-2024 – Bilan
Succès
- Le Canada est maintenant un chef de file mondial dans la promotion de l’approche des systèmes alimentaires et dans le soutien des efforts internationaux (Nations Unies, Organisation de coopération et de développement économiques, G7/G20).
- Maintien de l’alignement sur les priorités du gouvernement, conformément aux engagements pris dans les lettres de mandat de la ministre de 2019 et de 2021.
- Contribution à l’élargissement du mandat du Ministère de manière à prendre en compte les enjeux et les intervenants des systèmes alimentaires au-delà du secteur de l’agriculture et de l’alimentation.
- Mise en place d’une plateforme qui a permis de réunir rapidement divers intervenants et de passer à un soutien d’urgence aux systèmes alimentaires pendant la pandémie de COVID-19.
- Les investissements dans l’infrastructure alimentaire locale pour soutenir la sécurité alimentaire ont comblé une lacune importante des programmes fédéraux.
- Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire a introduit un nouveau modèle de financement à AAC, qui permet d’accélérer très efficacement le franchissement des étapes initiales des innovations.
Occasions et possibilités
- Améliorer la cohérence entre les politiques qui ont une incidence sur l’alimentation ou qui sont influencées par celle-ci et harmoniser les mesures dans l’ensemble des systèmes alimentaires du Canada.
- Établir un cadre de suivi comprenant des indicateurs pancanadiens sur les systèmes alimentaires et un rapport annuel sur les résultats partagés et la cohérence entre les politiques alimentaires du gouvernement du Canada.
- Accroître la collaboration directe et véritable avec les partenaires autochtones afin de faire progresser les priorités qu’ils auront déterminées d’eux-mêmes.
- Soutien supplémentaire à la participation des groupes en quête d’équité.
- Améliorer la coordination des investissements fédéraux soutenant les solutions communautaires pour aborder les multiples dimensions de la sécurité alimentaire.
- Élaborer une stratégie visant à réduire les pertes et le gaspillage de denrées alimentaires dans l’ensemble du système alimentaire en s’appuyant sur les investissements réalisés à ce jour et en encourageant les partenariats entre les chaînes d’approvisionnement.
Renouvellement de la politique alimentaire – Contexte
Recommandations des intervenants
- Conseil consultatif
- Dialogues du Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies
- Organisations autochtones nationales
- Participation ponctuelle
Défis actuels et nouveaux
- Abordabilité des denrées alimentaires pour les personnes à faible revenu
- Perturbations de la chaîne d’approvisionnement
- Systèmes alimentaires autochtones autodéterminés
- Coût de renonciation des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires
Nouveaux engagements
- Fonds de lutte contre le gaspillage alimentaire (lettre de mandat de 2021)
- Plan d’action pour la réduction des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires (Sommet des leaders nord-américains de 2023)
- Document sur la démarche nationale
- Réponse du gouvernement aux rapports du Bureau du vérificateur général et du Comité permanent des comptes publics (PACP) sur la protection du système alimentaire canadien
Politique alimentaire de 2024-2029 – Perspectives
Le financement du programme prendra fin en 2024 et nous entreprenons un travail stratégique pour produire une politique alimentaire renouvelée.
- Mobilisation d’autres ministères au niveau opérationnel; comité interministériel des SMA sur la politique alimentaire.
- Le Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada a formulé des conseils sur la mise en œuvre de la politique et du programme à ce jour, en ciblant des possibilités d’améliorer la cohérence de la politique et du programme.
Dans quatre domaines clés, les interventions fédérales permettraient de consolider les progrès réalisés à ce jour, de respecter les engagements du gouvernement, de répondre aux commentaires des intervenants et de relever d’importants défis liés aux systèmes alimentaires.
- Systèmes alimentaires communautaires résilients
- Réduction des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires
- Renforcement des systèmes alimentaires autochtones
- Promotion d’aliments canadiens nutritifs
Il est également possible d’améliorer les mécanismes de soutien de la politique alimentaire.
- Mettre davantage l’accent sur les moyens de mise en œuvre dans le cadre stratégique.
- Supprimer les obstacles financiers à la participation des groupes en quête d’équité et établir des mécanismes pour soutenir une élaboration conjointe à long terme à l’échelle du Ministère avec les partenaires autochtones.
- Renforcer une approche pangouvernementale en améliorant la coordination, la cohérence et la collaboration, notamment en matière de données et de suivi.
-
Inflation, hausse des coûts des intrants et des prix des aliments
Inflation
À la fin de 2021, l’inflation mensuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) a commencé à s’accélérer au Canada. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’IPC mensuel global au Canada a atteint un sommet de 8,1 % en juin 2022.
Inflation des prix des aliments
Depuis l’hiver 2021-2022, le rythme de l’inflation des prix des aliments au détail s’est accéléré et est demeuré plus élevé que l’inflation globale des prix au Canada. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les prix des aliments au détail sont demeurés élevés.
Après les fortes hausses du taux d’intérêt de la Banque du Canada, l’inflation mensuelle globale des prix au Canada a beaucoup ralenti et a chuté à 2,8 % en juin 2023. Toutefois, l’inflation des prix des aliments au détail au Canada demeurait supérieure à 9 % en juin 2023.
La hausse des prix des aliments a un effet négatif sur la sécurité alimentaire des Canadiens à faible revenu, en particulier des ménages monoparentaux, des Autochtones, des nouveaux immigrants, et des personnes vivant dans des régions éloignées et rurales.
Plusieurs raisons ont été invoquées pour expliquer la hausse de l’inflation des prix au Canada et dans le monde : les effets persistants des perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la pandémie de COVID-19, les pénuries de main-d’œuvre, la hausse des prix de l’énergie, la hausse du dollar américain et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Figure 1 : Augmentations sur 12 mois des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, de janvier 2021 à juin 2023.

Source : Statistique Canada
[Description de l’image ci-dessous]
Graphique illustrant les augmentations sur 12 mois de l’indice mensuel des prix à la consommation au Canada, de janvier 2021 à juin 2023. Le graphique compare l’augmentation des prix d’une année à l’autre de tous les articles (c’est-à-dire l’inflation globale des prix) par rapport aux aliments achetés en magasin (c’est-à-dire l’inflation des prix des aliments au détail). Il indique également la date importante de l’invasion de l’Ukraine par la Russie (le 24 février 2022) pour montrer comment les prix ont continué de demeurer élevés après cet événement.
Depuis l’hiver 2021-2022, le rythme de l’inflation des prix des aliments au détail s’est accéléré et est demeuré plus élevé que l’inflation globale des prix au Canada. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les prix des aliments au détail sont demeurés élevés.
Après les fortes hausses du taux d’intérêt de la Banque du Canada, l’inflation globale des prix au Canada a beaucoup ralenti et a chuté à 2,8 % en juin 2023. Toutefois, l’inflation des prix des aliments au détail au Canada demeurait supérieure à 9 % en juin 2023.
Augmentations sur 12 mois des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, de janvier 2021 à décembre 2021.
Janv-21
Févr-21
Mars-21
Avr-21
Mai-21
Juin-21
Juil-21
Août-21
Sept-21
Oct-21
Nov-21
Déc-21
Tous les produits
1,0%
1,1%
2,2%
3,4%
3,6%
3,1%
3,7%
4,1%
4,4%
4,7%
4,7%
4,8%
Aliments achetés en magasin
0,1%
1,3%
1,3%
0,1%
0,9%
0,7%
1,0%
2,6%
4,2%
3,9%
4,7%
5,7%
Augmentations sur 12 mois des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, de janvier 2022 à décembre 2022.
Janv -22
Févr-22
Mars-22
Avr-22
Mai-22
Juin-22
Juil-22
Août-22
Sept-22
Oct-22
Nov-22
Déc-22
Tous les produits
5,1%
5,7%
6,7%
6,8%
7,7%
8,1%
7,6%
7,0%
6,9%
6,9%
6,8%
6,3%
Aliments achetés en magasin
6,5%
7,4%
8,7%
9,7%
9,7%
9,4%
9,9%
10,8%
11,4%
11,0%
11,4%
11,0%
Augmentations sur 6 mois des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, de janvier 2023 à juin 2023.
Janv -23
Févr-23
Mars-23
Avr-23
Mai-23
Juin-23
Tous les produits
5,9%
5,2%
4,3%
4,4%
3,4%
2,8%
Aliments achetés en magasin
11,4%
10,6%
9,7%
9,1%
9,0%
9,1%
Coût des intrants agricoles
- Les dépenses totales d’exploitation agricole au Canada ont augmenté de 3,7 %, en moyenne, au cours de la période de 2016 à 2020. Cependant, en 2021, les dépenses ont augmenté considérablement (9,6 % pour atteindre 59,8 milliards de dollars) en raison de la hausse des prix des engrais, des aliments pour animaux et du carburant. De plus, les prix des intrants ont également été touchés par l’inflation générale, qui a augmenté à l’échelle mondiale à compter de 2021 en raison du rebond de la demande après la pandémie et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.
- En 2022, les dépenses agricoles ont encore augmenté de 21,2 % pour atteindre 72,5 milliards de dollars. Il s’agit de la plus forte augmentation depuis 1974 (+22 %), car les prix des engrais, des aliments pour animaux et du carburant ont continué d’augmenter. Les prix des intrants ont également augmenté, l’inflation générale ayant considérablement augmenté en 2022 en raison de la nouvelle hausse des prix de l’énergie et des aliments découlant de la guerre russe contre l’Ukraine.
- Les dépenses devraient augmenter en 2023, mais à un rythme beaucoup plus modeste. Plusieurs catégories de dépenses, y compris les intérêts, le bétail et la main-d’œuvre, devraient continuer d’augmenter en 2023, après des augmentations considérables en 2022. Cependant, les dépenses en carburant et en engrais devraient diminuer en raison de la baisse prévue des prix des cultures et des prix du gaz naturel.
- Alors que la hausse des prix des produits agricoles a entraîné des recettes monétaires agricoles record (95 milliards de dollars) en 2022, la hausse des prix des principaux intrants a dépassé la hausse des prix des produits agricoles, ce qui a entraîné une légère baisse du revenu net pour atteindre 22,5 milliards de dollars en 2022 (par rapport à 22,9 milliards de dollars en 2021).
-
Environnement et changement climatique / Stratégie pour une agriculture durable
Positionner le secteur sur la voie du succès - perspectives sur le changement climatique et l'environnement
Contexte
- Les Canadiens et notre secteur sont confrontés à la triple menace du changement climatique, de la pollution et de la perte de biodiversité.
- Gouvernements fédéral-provinciaux-territoriaux (FPT) - objectifs environnementaux communs à long terme pour lesquels nous devons travailler ensemble
- Des efforts et des investissements sont nécessaires pour y parvenir – mais le paysage des politiques et des programmes visant à résoudre ces problèmes devient complexe et difficile à naviguer
- C'est pourquoi les questions d'environnement et de durabilité dans l'agriculture sont de plus en plus présentes à l'ordre du jour international
- La démonstration de la durabilité environnementale devient de plus en plus importante pour obtenir/maintenir l'accès au marché et répondre aux exigences réglementaires et aux demandes des consommateurs.
- Le secteur a besoin d'un soutien, au-delà de la programmation, pour démontrer sa durabilité.
La durabilité est un facteur clé de l’avenir
- Les consommateurs recherchent des aliments cultivés et produits de manière durable, et s’attendent à en trouver.
- Les marchés mondiaux mettent de plus en plus l’accent sur la durabilité et la gestion de l’environnement.
- Les principaux concurrents commerciaux élaborent leurs propres approches en matière de durabilité.
- L’avenir du secteur passe par un environnement sain.
Production alimentaire et environnement
(Source : Sondage de référence de la Campagne de promotion de l’achat de produits canadiens 2020)
La moitié des consommateurs considèrent que les agriculteurs son respectueux de l’environnement, mais beaucoup sont préoccupés par les répercussions des activités agricoles.
Agriculteurs
- 73 % font confiance aux agriculteurs et aux éleveurs pour prendre soin de l’environnement.
- 53 % estiment que les agriculteurs sont respectueux de l’environnement.
Agriculture
- 38 % sont préoccupés par la durabilité de l’environnement en agriculture.
- 38 % sont préoccupés par les répercussions des activités agricoles sur l’environnement.
Confiance à l’égard du processus
- 53 % pensent que la mise en œuvre de pratiques durables et écologiques dans le domaine de la production alimentaire est très importante pour bâtir ou maintenir la confiance.
- 43 % estiment que l’alimentation durable a des effets positifs sur l’environnement.
- 44 % des personnes qui achètent rarement des produits fabriqués selon des pratiques durables sur le plan environnemental ou qui n’en achètent jamais ne sont pas portées à acheter ces produits puisqu’elles ne sont pas certaines qu’ils ont été produits de façons durable.
Durabilité de l’agriculture canadienne – efforts à ce jour
- Les émissions du secteur agricole sont restées relativement stables depuis 2005, avec une diminution des émissions dans certaines régions et une augmentation dans d'autres.
- Les sols agricoles du Canada constituent un puits de carbone important depuis 2000
- En Saskatchewan, 95 % d’adoption du travail minimal du sol - a entraîné une augmentation de la matière organique du sol
- Le Canada a réduit l'intensité des émissions de méthane par unité de production
- Le Canada a obtenu de très bons résultats dans les comparaisons mondiales, mais la définition et l'étalonnage de la durabilité sont difficiles et nécessitent des données substantielles - et les autres pays s'améliorent également
- L'amélioration de la mesure de la durabilité et l'analyse comparative des changements au fil du temps constituent également une priorité pour le secteur.
- Une coalition public-privée de 129 partenaires a soutenu le premier indice de durabilité pour le secteur agricole et agroalimentaire canadien, l'Indice national de performance agroalimentaire (2023).
- Mieux mesurer et démontrer la durabilité environnementale du Canada est crucial pour aider le pays à se positionner en tant que leader sur les marchés mondiaux.
Autres initiatives sectorielles de développement durable
Le secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire a pris des engagements à long terme en matière de durabilité pour réduire les émissions, protéger la biodiversité et améliorer sa résilience.
- Producteurs laitiers du Canada - carboneutralité d’ici 2050
- Producteurs de grains du Canada – carboneutralité d’ici 2050
- Les Producteurs d’œufs du Canada – carboneutralité d’ici 2050
- Nestle – carboneutralité d’ici 2050
- Table ronde canadienne sur le bœuf durable – Cadre de certification du bœuf durable
- McCain Foods – Cadre de l’agriculture régénératrice McCain
- Fédération canadienne de l’agriculture – Initiative de durabilité agroalimentaire canadienne
- Fertilisants Canada – Gérance des nutriments 4B
- Producteurs d’œufs du Canada, Producteurs de poulet du Canada, Producteurs laitiers du Canada, Pulse Canada – évaluations du cycle de vie
- Maple Leaf – réduire l’empreinte environnementale de 50 % d’ici 2025
Ces initiatives contribuent toutes à la durabilité de l'agriculture canadienne.
Vue d’ensemble de la Stratégie pour une agriculture durable
La Stratégie pour une agriculture durable (SAD) contribuera à définir une orientation partagée pour la prise de mesures visant à améliorer la performance environnementale du secteur à long terme tout en tenant compte de la compétitivité et de la viabilité économique de la mise en œuvre de nouvelles actions, ainsi que de la durabilité sociale et de la vitalité à long terme du secteur.
La Stratégie se concentrera sur le pilier environnemental, mais utilisera une lentille économique et sociale, afin de garantir que les actions auront également un effet positif sur les moyens de subsistance des producteurs et sur la compétitivité du secteur.
Objectifs :
- Cibler les ressources et les mesures pour un secteur agricole écologiquement et économiquement durable.
- Gérer les effets des changements climatiques de façon proactive.
- Tirer parti des opportunités associées aux marchés de l'alimentation durable.
- Contribuer aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada.
La Stratégie s’appuiera sur le bon travail qui a été et continue d’être réalisé.
Thèmes prioritaires de la Stratégie pour une agriculture durable
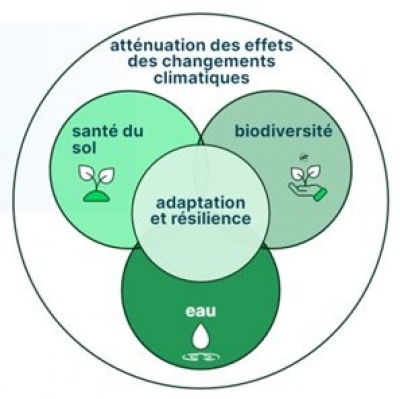
[Description de l’image ci-dessous]
Thèmes prioritaires de la stratégie pour une agriculture durable.
Diagramme de Venn montrant les liens entre les cinq thèmes de la Stratégie pour une agriculture durable, soit l’atténuation des effets des changements climatiques, la santé du sol, la biodiversité, l’adaptation et la résilience, et l’eau.
S’appuyer sur une base solide pour soutenir les efforts de durabilité dans le secteur : initiatives fédérales
Incitatifs à l’adoption de pratiques agroenvironnementales à la ferme :
- Fonds pour des solutions climatiques naturelles (2021-2031)
- Solutions agricoles pour le climat : Fonds d'action climatique à la ferme (2021-2024 ; 2024-2028)
- Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (Environnement et Changement climatique Canada [ECCC]) (2021-2022 à 2030-2031)
- Programme 2 milliards d'arbres (Ressources naturelles Canada) (2021-2022 à 2030-2031)
- Programme des technologies propres en agriculture (2022 à 2028)
Science, recherche et innovation :
- Solutions agricoles pour le climat – Laboratoires vivants
- Programme des technologies propres en agriculture (2022 à 2028)
- Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) - Activités internes scientifiques et technologiques
S’appuyer sur une base solide pour soutenir les efforts de durabilité dans le secteur : Partenariat canadien pour une agriculture durable
Incitatifs à l’adoption de pratiques agroenvironnementales à la ferme :
- Programmes à coûts partagés - Changements climatiques et environnement (provinces et territoires)
- Programme de paysages agricoles résilients
Science, recherche et innovation :
- Programmes à coûts partagés - Science, recherche et innovation (provinces et territoires)
- Agri-science - Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) (fédéral)
- Agri-innover - PCA durable (fédéral)
S’appuyer sur une base solide pour soutenir les efforts de durabilité dans le secteur : initiatives provinciales/territoriales (exemples)
- Alberta - Emissions Reduction and Energy Development Plan
- Colombie-Britannique - Regenerative Agriculture and Agritech Minister’s Advisory Group final report; Extreme Weather Preparedness/Food Security Funding
- Manitoba - Made in Manitoba Climate and Green Plan; Manitoba Water Management Strategy; Manitoba Sustainable Protein Strategy
- Nouveau Brunswick - Stratégie sur les changements climatiques en agriculture; Fonds pour les changements climatiques
- Terre-Neuve - Provincial Agriculture Crown Land Program
- Territoires du Nord-Ouest - 2030 NWT Climate Change Strategic Framework
- Nouvelle Écosse - Climate Adaptation Leadership Program; Agriculture Energy Partnership
- Ontario - Ontario’s Soil Resource Inventory and Agricultural Soil Information System; Ontario’s Agri-Food Energy Cost Savings Initiative
- Île-du-Prince-Édouard - 2040 Net Zero Framework; Climate Adaptation Plan (Agriculture)
- Québec - l’entente entre le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et les Producteurs de lait du Québec (PLQ), touchant la mise en place d’un projet visant la réduction des émissions de méthane entérique des troupeaux laitiers
- Saskatchewan - Global Institute for Food Security : recherche sur l'empreinte carbone; amélioration mesurée des indicateurs environnementaux
- Yukon - Our Clean Future: A Yukon strategy for climate change, energy and a green economy; Cultivating Our Future: 2020 Yukon Agriculture Policy
Mobilisation en appui à la Stratégie pour une agriculture durable
Engagement du secteur
- Avec les producteurs :
- Ateliers de producteurs
- Avec les parties prenantes du secteur :
- Ateliers pour les parties prenantes
- Conseils / tables consultatifs existants
- Tables rondes du SAD
- Avec les provinces et les territoires :
- Groupes de travail fédéral-provinciaux-territoriaux établis par AAC
- Avec les peuples autochtones :
- Engagement avec les partenaires des Premières Nations, Inuits, et Métis
- Toutes les audiences ciblées :
- Questionnaire en ligne
- Soumissions écrites
Comité consultatif
- Représentation diversifiée des parties prenantes du secteur
- Faciliter une discussion ouverte, informelle et constructive entre AAC, le secteur agricole et d'autres intervenants clés
- Fournir des informations, des recommandations et des conseils sur l'élaboration de résultats communs, d'étapes potentielles et de mesures visant à soutenir ces étapes
- Rôle important dans la facilitation de la collaboration, de la transparence et du partage d'informations
Stratégie pour une agriculture durable – principaux thèmes découlant de la rétroaction
Réalités vécues par les producteurs
- Les producteurs sont avant tout des propriétaires d’entreprises - considérations économiques
- Les agriculteurs vieillissants quittent le secteur plus rapidement que la capacité des nouveaux venus à devenir viables
- Il faut du temps pour observer des changements à la suite de la mise en œuvre de nouvelles pratiques environnementales
- Le manque de services de vulgarisation dans l’ensemble du pays pour aider les producteurs à prendre des décisions éclairées
La régionalité doit être un principe clé de la SAD
- Une approche unique ne fonctionnera pas
- L'ampleur des problèmes environnementaux et les solutions disponibles varient d'une région à l'autre
- Les petites et moyennes exploitations agricoles ont besoin de soutiens différents et peuvent offrir des solutions différentes
Une approche environnementale, économique et sociale de la durabilité
- La SAD devraient inclure les trois piliers de la durabilité, à savoir les piliers social, économique et environnemental.
- La biodiversité est essentielle à la multifonctionnalité de l’agriculture
- La vision de la SAD doit aller au-delà de l’Énoncé de Guelph
Stratégie pour une agriculture durable – principaux thèmes des provinces et territoires
Nécessité d’un lien clair entre les cadres stratégiques pour l’agriculture (5 ans) et la SAD (25 ans).
Préoccupations
- La SAD ne doit pas déplacer les cadres stratégiques pour l’agriculture pour financer un nouvel ensemble d’objectifs environnementaux
- La confusion relativement aux programmes de développement durable fédéraux et provinciaux – il est nécessaire de clarifier les rôles et les responsabilités
- La SAD ne doit pas contredire ce qui se passe dans le cadre du PCA durable si les plans provinciaux suivent des calendriers différents
Prochaines étapes
- Consultation supplémentaire avec les partenaires PT
- Carte des initiatives fédérales et provinciales en matière de développement durable pour voir comment elles s’intègrent les unes aux autres
- Tirer les leçons des succès remportés par des actions spécifiques
- À mesure que la SAD se développe, il faut envisager de faciliter la possibilité pour les producteurs de cumuler les financements des PT et des programmes fédéraux
Prochaines étapes de la SAD
- Travailler avec les acteurs du secteur
- Groupes de travail SAD-comité consultatif - atténuation des effets des changements climatiques, engrais, adaptation, biodiversité, santé du sol
- Le comité consultatif continuera à se réunir deux fois par mois
- Discussions provinciales et territoriales
- Réunions bilatérales avec les provinces et les territoires - en cours
- Session des sous-ministres adjoints FPT - automne 2023
- Rapport sur ce que nous avons entendu - automne 2023
- Analyse et élaboration de politiques en vue du lancement de la SAD en 2024
Annexe A : Autres initiatives environnementales fédérales selon les priorités
Eau
Activités fédérales
- Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) : Budget de 2023 : 85,1 millions de dollars sur cinq ans pour la création d’une nouvelle Agence canadienne de l’eau (siège à Winnipeg) et 650 millions de dollars sur dix ans pour le renforcement du Plan d’action sur l’eau douce.
- ECCC continue de travailler à l’interne sur une proposition de plan pour la mise en place de cette enveloppe budgétaire.
Rôle d'AAC
- Coordination et engagement avec ECCC.
Participation des PT (Les provinces et territoires ne participent pas toutes dans les initiatives listées)
- Aucun
Biodiversité
Activités fédérales
- Développement sous l’égide d’ECCC des stratégies et des plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) soulignant les contributions du Canada au Cadre mondial de la biodiversité (CMB) de Kunming à Montréal.
- Plan d'action pour la conservation des espèces en péril dans le secteur agricole (AgSAR) (équipe de planification codirigée par l'ECCC et la Table ronde canadienne sur le bœuf durable).
Rôle d'AAC
- AAC soutient ECCC dans l'élaboration du SPANB et des contributions du Canada - co-responsable des objectifs 7 et 10.
- Engagement avec les ministères de l'agriculture.
- Faciliter le partage d'informations pour AgSAR.
Participation des PT (Les provinces et territoires ne participent pas toutes dans les initiatives listées)
- CMB : les PT sont invités à participer à la session d'engagement sur l'agriculture avec les parties prenantes et à s'engager avec les ministères de l'environnement des PT.
- AgSAR : les ministères de l'agriculture des PT sont encouragés à impliquer leurs homologues de l'environnement pour apporter leur contribution.
Adaptation
Activités fédérales
- ECCC à publié la version finale de la Stratégie nationale d’adaptation en juin 2023, ainsi qu’une version mise à jour du Plan d’action sur l’adaptation du gouvernement du Canada.
Rôle d'AAC
- Coordination et engagement avec ECCC et les parties prenantes; facilitation de l'engagement avec les ministères de l'agriculture.
Participation des PT (Les provinces et territoires ne participent pas toutes dans les initiatives listées)
- ECCC dirige l’élaboration de plans d’action bilatéraux avec les PT.
Changement climatique
Activités fédérales
- Le gouvernement du Canada s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et à parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050.
- Le secteur agricole canadien contribue à ces objectifs en participant à des initiatives telles que l’engagement mondial sur le méthane, et en fixant un objectif national de réduction des émissions liées à l'application d'engrais de 30 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2020.
Rôle d'AAC
- Programmation et rapports associés.
- Coordination des rapports pour le secteur agricole.
- Engagement et coordination avec ECCC et les parties prenantes.
Participation des PT (Les provinces et territoires ne participent pas toutes dans les initiatives listées)
- Mises à jour régulières lors des réunions du groupe de travail FPT sur les politiques agro-environnementales.
Engagement international
Activités fédérales
- Prochains événements internationaux
- Bilan – Sommet sur systèmes alimentaires des Nations Unies: juillet 2023
- Sommet sur le climat des Nations Unies : Septembre 2023
- Conférence Adaptation Futures : octobre 2023
- COP28 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) : 30 novembre – 12 décembre 2023
Rôle d'AAC
- AAC mène pour Adaptation Futures; UN FSS; négociations sur l'agriculture de la CCNUCC.
- Coordination et engagement avec ECCC et les parties prenantes; facilitation de l'engagement avec les ministères de l'agriculture.
Participation des PT (Les provinces et territoires ne participent pas toutes dans les initiatives listées)
- Les PT seront invités à participer à des séances d'information.
- Mises à jour régulières lors des réunions du groupe de travail FPT sur les politiques agro-environnementales.
Annexe B : Stratégie pour une agriculture durable et cadres stratégiques pour l’agriculture
- PCA durable (2023-2028)
- Stratégie pour une agriculture durable (2024-2050)
- Cadres stratégiques pour l’agriculture (2028-2033; 2033-2038, etc.)
S'attaquer aux changements climatiques et protéger l'environnement afin de réduire les émissions de GES et de soutenir la viabilité à long terme du secteur, tout en positionnant les producteurs et les transformateurs de façon à ce qu'ils puissent saisir les possibilités économiques découlant des demandes changeantes des consommateurs. (Priorité environnementale du PCA durable dans L’Énoncé de Guelph).
Autres plans/strategies- Plan de réduction des émissions pour 2030
- Stratégie canadienne sur le méthane
- Stratégie nationale d’adaptation du Canada
- Plan d’action pour la conservation des espèces en péril dans le secteur agricole
- Stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité
- Plan d’action sur l’eau douce
Engagements nationaux
- Objectif de réduction des émissions attribuables aux engrais de 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici à 2030
Engagements internationaux
- Protéger 30 % des terres et des océans du Canada d'ici à 2030 et d’autres objectifs du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal.
- Appui à l’engagement international de réduire les émissions de méthane de 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici à 2030
- 40-45 % de réduction des émissions de GES par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à 2030
- Carboneutralité d'ici 2050
-
Gestion de l’offre et programmes connexes
Aperçu du système de gestion de l’offre (GO) dans les secteurs canadiens du lait, de la volaille et des œufs et des programmes d’indemnisation liés aux accords commerciaux.
Qu’est-ce que la gestion de l’offre?
La GO est le système selon lequel les produits laitiers (lait de vache), les œufs en coquille, les œufs d’incubation, le poulet et le dindon sont produits et commercialisés au Canada.
La GO vise à assurer que les producteurs obtiennent un rendement raisonnable pour leur travail et leurs investissements, tout en fournissant aux consommateurs un approvisionnement prévisible.
Le système de GO repose sur trois piliers :
- Mécanismes de fixation des prix
- Contrôle de la production
- Contrôle des importations
La gestion de l’offre, comment ça fonctionne?
La production est conçue pour correspondre à la demande intérieure.
- Les niveaux de production sont fixés à l’échelle nationale puis alloués aux offices de commercialisation provinciaux, qui attribuent ensuite des quotas (ou niveaux de production maximaux) aux producteurs.
La fixation des prix a pour but de veiller à ce que les producteurs reçoivent un juste retour sur leur travail.
- Les offices de commercialisation provinciaux fixent les prix auxquels les producteurs vendent leurs produits en tenant compte de facteurs comme le coût de production et l’inflation. Les prix de détail ne sont pas réglementés.
Les importations sont gérées et administrées par le gouvernement fédéral.
- Les importations de produits sous GO sont contrôlées au moyen des contingents tarifaires (CT) grâce auxquels on fixe des limites sur le volume des importations qui peuvent entrer au Canada à un taux de droit faible ou nul; toute importation au-delà de ce volume est assujettie à des droits beaucoup plus élevés.
Aperçu du secteur
Produits laitiers
- 9 739 fermes laitières au Canada, dont la majorité (80 %) sont situées en Ontario et au Québec.
- Recettes monétaires agricoles (2022) = 8,23 milliards de dollars
- Revenu net d'exploitation moyen (2021) = 228 609 $
Volaille et œufs
- 2 826 producteurs de poulet, 513 producteurs de dindon, 235 producteurs d’œuf d’incubation de poulet à chair et 1 218 producteurs d’œufs au Canada, dont la majorité (62 %) sont situés en Ontario et au Québec.
- Recettes monétaires agricoles (2022) = 5,9 milliards de dollars
- Revenu net d'exploitation moyen (2021) = 224 433 $
Secteur de la transformation
- Environ 507 transformateurs laitiers et 460 usines de transformation de la volaille et des oeufs au Canada, dont la majorité sont situés en Ontario et au Québec.
- Expéditions de produits manufacturés = 24,8 milliards de dollars (16,2 milliards de dollars dans le secteur laitier et 8,7 milliards de dollars dans les secteurs de la volaille et des œufs).
- Nombre d’employés dans la transformation des produits sous GO : 24 500 dans le secteur laitier* et plus de 28 000 dans les secteurs de la volaille et des œufs1
1Chiffres déclarés par l’industrie.
Accords commerciaux récents
AECG (2017)
- Accord économique et commercial global – Secteur laitier (fromage) seulement
PTPGP (2019)
- Partenariat transpacifique global et progressiste – Tous les secteurs sous GO
ACEUM (2020)
- Accord Canada–États-Unis–Mexique – Tous les secteurs sous GO
Les accords commerciaux récents offrent aux partenaires commerciaux du Canada un accès additionnel au marché canadien des produits laitiers, de la volaille et des œufs, tout en gardant le système de GO et ses piliers intacts.
Cet accès se fait au moyen des CT, qui permettent l’importation de volumes établis de produits donnés à des taux de droits faibles ou nuls.
Les nouvelles importations aux termes de ces accords remplacent des produits qui auraient autrement été fournis par des producteurs canadiens.
Les importations aux termes de l’AECG, du PTPGP et de l’ACEUM ont jusqu’ici été élevées pour certains produits, tandis que certains taux d’utilisation des CT de l’ACEUM et du PTPGP ont été plus bas que prévu pour différentes raisons.
Indemnisation pour l’AECG et le PTPGP
Indemnisation globale pour les impacts de l’AECG et du PTPGP = 3,083 milliards de dollars
En 2016, le gouvernement du Canada a annoncé 350 millions de dollars en indemnisation pour les impacts de l’AECG.
Producteurs laitiers
- Programme d’investissement pour fermes laitières (250 millions de dollars sur 6 ans; le programme a pris fin le 31 mars 2023)
Transformateurs laitiers
- Fonds d’investissement dans la transformation des produits laitiers (100 millions de dollars sur 5 ans; le programme a pris fin le 31 mars 2022)
PTPGP – Dans les budgets de 2019 et de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un financement additionnel de 2,733 milliards de dollars pour soutenir les secteurs sous gestion de l’offre.
Producteurs sous GO
- Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers (1,750 millions de dollars sur 4 ans)
- Programme d’investissement à la ferme pour la volaille et les œufs (647 millions de dollars sur 10 ans)
- Programme de développement des marchés du dindon et du poulet (44 millions de dollars sur 10 ans)
Transformateurs de produits laitiers, de volailles et d'œufs :
- Fonds d’investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l’offre (292,5 millions de dollars sur 6 ans)
Indemnisation pour l’ACEUM
Dans l’Énoncé économique de l’automne 2022, le gouvernement a annoncé 1,7 milliard $ pour compenser les impacts de l’ACEUM. La majeure partie du financement sera offerte au moyen des programmes d’indemnisation existants :
Producteurs laitiers
- Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers (1,2 milliard de dollars sur 4 ans)
Producteurs de volaille et d'œufs
- Programme d’investissement à la ferme pour la volaille et les œufs (112 millions de dollars sur 8 ans)
Transformateurs de produits laitiers, de volailles et d'œufs
- Fonds d’investissement pour la transformation des produits sous gestion de l’offre (105 millions de dollars sur 5 ans)
Situation actuelle
- █████████████████████████████████████████████████████████████████████
L’indemnisation pour l’ACEUM comprend aussi une somme maximale de 333 millions de dollars pour un nouveau programme (le Fonds d'innovation et d'investissement dans l'industrie laitière) visant à soutenir les efforts des transformateurs laitiers pour gérer l’excédent de solides non gras, un sous-produit de la transformation laitière.
Situation actuelle
- Le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’investir dans ce nouveau programme pour le secteur laitier à la suite de l’Énoncé économique de l’automne 2022.
- Des consultations avec les intervenants et associations clés du secteur laitier ont eu lieu en janvier et février 2023.
- █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Prochaines étapes
███████████████████████████████████████████████
Secteurs sous GO : Priorités et enjeux clés
- Inflation (par exemple, hausse du coût des intrants)
- Confiance du public (par exemple, durabilité environnementale, bien-être des animaux)
- Pénurie de main-d’œuvre
Produits laitiers
- Conflits commerciaux (CT pour les produits laitiers dans le cadre de l’ACEUM et du PTPGP)
- Inquiétudes des consommateurs à l’égard de la hausse des prix du lait
- Élimination du lait et excédent de solides non gras (par exemple, poudre de lait écrémé, poudre de lactosérum)
- Exercice d’établissement d’une vision pour l’industrie laitière pour tracer la voie de l’avenir de celle-ci
Volaille et œufs
- Influenza aviaire
- Le Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine – suppression des tarifaire temporaire de produits en provenance de l’Ukraine (expiré en juin 2023)
Annexe A – Principaux acteurs de l’industrie laitière
Les Producteurs laitiers du Canada
- Organisme d’élaboration de politiques, de lobbyisme et de promotion dirigé par les producteurs :
- Joue un rôle de coordination auprès des producteurs
- Administre les programmes destinés aux producteurs et exécute les politiques du secteur, comme le programme proAction.
- Prend la défense des producteurs sur les scènes nationale et internationale et exerce des pressions sur le gouvernement.
- Mène, au nom des producteurs, des activités de publicité, des événements et d’autres activités de promotion.
- Président : David Wiens; Directeur exécutif : Jacques Lefebvre
- Financé au moyen de prélèvements auprès des producteurs.
Offices de commercialisation provinciaux
- Assument la responsabilité de la mise en œuvre du système à l’échelle provinciale :
- Commercialisent le lait auprès du secteur de la transformation.
- Établissent le prix de chaque classe de lait.
- Administrent les politiques provinciales sur les quotas; attribuent les quotas aux producteurs.
Association des transformateurs laitiers du Canada
- Association nationale qui représente les transformateurs laitiers canadiens.
- Membre sans droit de vote du Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait.
Commission canadienne du lait
- Est responsable de la surveillance fédérale du système de gestion de l’offre.
- Elle rend compte au Parlement par l’entremise de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et a les responsabilités suivantes :
- Estimer les exigences canadiennes relatives aux quotas.
- Établir les prix de soutien pour le beurre.
- Administrer le Programme de permis de classes spéciales de lait, la mise en commun du lait et un certain nombre de programmes du secteur laitier (le Programme d'innovation laitière, le Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers, le programme Lait pour la croissance et les Programmes intérieurs de saisonnalité).
- Compte 3 membres et 60 employés; Président-directeur général : Benoit Basillais; Présidente : Jennifer Hayes
- Financement : 50 % d’affectations, 50 % du secteur et du marché.
Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait
- Supervise l’administration du Plan national de commercialisation du lait (PNCL).
- Prend les décisions relatives aux quotas et à l’établissement des prix, ainsi que les décisions concernant le système de classement du lait.
- Gère les questions de politiques influant sur le système de GO des produits laitiers.
- Est présidé par la Commission canadienne du lait et comprend des représentants des offices de commercialisation et des gouvernements provinciaux. Les Producteurs laitiers du Canada, l’Association des transformateurs laitiers du Canada et l’Association des consommateurs du Canada sont des membres sans droit de vote/observateurs.
Annexe B – Principaux acteurs de l’industrie de la volaille et des oeufs
Conseil des produits agricoles du Canada (organisme fédéral)
- Approuve les allocations de production et les prélèvements.
- Supervise les activités des offices de commercialisation nationaux en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles et relève de la ministre.
- Examine les plaintes des intervenants relatives aux décisions des offices de commercialisation nationaux.
Offices de commercialisation nationaux (constitués de producteurs)
Les Producteurs de poulet du Canada, Les Éleveurs de dindon du Canada, Les Producteurs d’œufs du Canada et Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada ont les responsabilités suivantes :
- Estimer les besoins en production nationaux.
- Jouer un rôle central de coordination pour le secteur.
- Administrer les programmes destinés aux producteurs et exécuter les politiques du secteur.
- Mener des activités de publicité, des événements et d’autres activités de promotion.
- Prendre la défense des producteurs du secteur et exercer des pressions sur le gouvernement.
Sont financés par les producteurs et au moyen de prélèvements effectués auprès des consommateurs.
Offices de commercialisation provinciaux (constitués de producteurs)
Prennent leur part des quotas nationaux et distribuent ceux-ci aux producteurs et approuvent les prix fixés par le conseil de supervision des prix de la province en cause.
Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles
Association de l’industrie qui représente les transformateurs primaires et secondaires de viande de poulet et de dindon, les classeurs d’œufs, les surtransformateurs d’œufs et les couvoirs du Canada.
-
Difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement
Les chaînes d’approvisionnement agricoles et agroalimentaires pendant la pandémie
Dans l’ensemble, pendant la pandémie de COVID-19, la chaîne d’approvisionnement alimentaire a continué d’offrir aux Canadiens et aux Canadiennes un accès sûr à des aliments et a maintenu une croissance économique saine.
Cependant, la pandémie a perturbé la chaîne d’approvisionnement alimentaire de diverses façons :
- Les restrictions affectant la main-d’œuvre et les déplacements ont fait ressortir le caractère essentiel des travailleurs de l’alimentation
- Il a été difficile de livrer les exportations et les importations
- Immobilisations de la production
- Excédent d’aliments dans certaine régions et pénurie dans d’autres
- Les difficultés d’approvisionnement alimentaire existantes ont été exacerbées dans les collectivités rurales et les communautés autochtones éloignées
- La hausse des prix des aliments a exercé des pressions sur de nombreux ménages
La pandémie a révélé les vulnérabilités préexistantes et attiré l’attention sur la nécessité d’une plus grande résilience dans le système d’alimentation du Canada. Ces problèmes ont été amplifiés par les catastrophes naturelles, les blocus aux frontières, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et d’importantes mesures syndicales.
Chaîne d’approvisionnement alimentaire du Canada
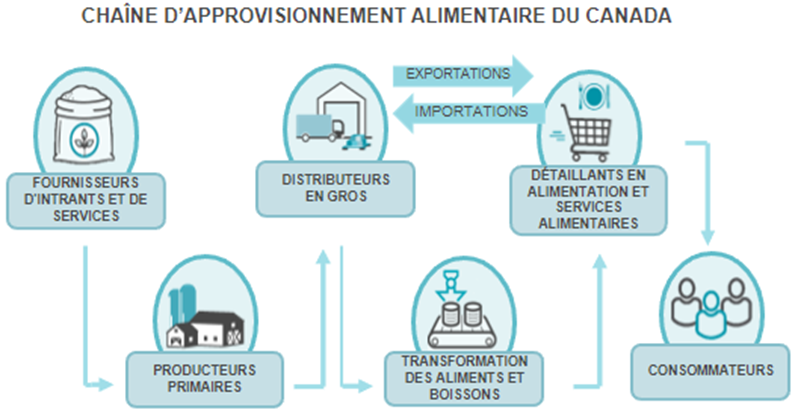
[Description de l’image ci-dessous]
La chaîne d’approvisionnement du Canada est un système connecté qui commence par :
- les fournisseurs d’intrants et de services;
- les producteurs primaires;
- les distributeurs en gros;
- la transformation des aliments et boissons
- les détaillants en alimentation et les services alimentaires, et se termine par
- le consommateur final.
La chaîne d’approvisionnement alimentaire fonctionne de la même façon, que les produits soient importés au Canada ou qu’ils soient exportés.
Stratégie nationale de la chaîne d’approvisionnement du transport
Les chaînes d’approvisionnement sont mentionnées dans 10 lettres de mandat.
Engagement pris dans le Budget de 2022 d’élaborer une stratégie nationale sur la chaîne d’approvisionnement (sous la direction de Transports Canada) – 603,2 millions de dollars pour les investissements engagés dans la chaîne d’approvisionnement.
Le Groupe de travail sur la chaîne d’approvisionnement a présenté son rapport final en octobre 2022.
Grâce au financement actuel du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) d’une valeur de 4,6 milliards de dollars échelonnés sur 11 ans (2017-2028), on doit investir dans les actifs de transport essentiels
- Porte d’entrée du Pacifique - 550 millions de dollars de marchandises chaque jour.
- L’ensemble du trafic des conteneurs sur la côte Ouest a augmenté d'environ 4,7 % par an depuis 2010 – sans expansion, les encombrements continueront de s’aggraver.
Lancement de l’examen réglementaire de la chaîne d’approvisionnement – sous la direction du Secrétariat du Conseil du Trésor
- Annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2022.
- Planification en cours pour des consultations sur les principaux secteurs – le calendrier doit être établi.
Engagements pris dans le cadre du Budget de 2023 en vue d’améliorer les chaînes d’approvisionnement du Canada :
- Verser 27,2 millions de dollars à Transports Canada sur cinq ans pour établir un Bureau des chaînes d’approvisionnement.
- Verser 25 millions de dollars à Transports Canada échelonnés sur cinq ans pour élaborer des données sur les chaînes d’approvisionnement dans le secteur des transports.
- Projet pilote de 18 mois d’interconnexion repoussée pour le transport ferroviaire dans les Prairies (annexe A).
Convergence du mandat de transport d’Agriculture et Agroalimentaire Canada historiquement axée sur les grains
Secteur des grains et transport ferroviaire
Avec une valeur annuelle de 47 milliards de dollars, la production céréalière représente un peu plus de 55 % des recettes monétaires agricoles canadiennes, et sur les quelque 90 millions de tonnes métriques de grains produites chaque année au Canada, environ 50 % sont exportées.
Pour atteindre les ports, les grains canadiens doivent parcourir les distances les plus longues par rapport à n’importe quel autre concurrent international du Canada.
- 94 % de tous les grains exportés utilisent le transport ferroviaire, soit pour être acheminé vers le port ou directement jusqu’à une destination finale aux États‑Unis ou au Mexique.
Les exportations de légumineuses et de cultures spéciales ont considérablement augmenté ces dernières années, alimentant la demande de conteneurs vides.
Compte tenu de l’importance cruciale du transport ferroviaire, les défis et les préoccupations concernant la prévisibilité et la qualité des services ferroviaires ont été systématiquement désignés comme principal problème de la chaîne d’approvisionnement pour les intervenants du secteur des grains.
Engagement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à l’égard du secteur et soutien de ce secteur
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire confie au Groupe de travail sur la logistique du transport des récoltes le mandat de déterminer et de résoudre les principaux enjeux qui se rattachent au transport des grains (récemment renouvelé pour 2022-2024, Annexe C).
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et Transports Canada se partagent un contrat en ce qui concerne le Programme de surveillance du grain du Canada afin de fournir des données et des analyses de qualité supérieure sur le rendement du réseau de transport des grains du Canada.
Dépendance du secteur des grains à l’égard du transport ferroviaire
Les producteurs et les sociétés céréalières affirment que le pouvoir de marché du service ferroviaire est à l’origine de problèmes de service et de capacité ferroviaires qui nuisent au secteur des grains.
- Deux grandes compagnies de chemin de fer (le Canadien National et le Canadien Pacifique Kansas City) acheminent les grains vers les clients nord‑américains et vers les ports maritimes en vue de leur exportation.
- L’imprévisibilité et les perturbations des services ferroviaires peuvent avoir des conséquences néfastes pour les expéditeurs; notamment des pénalités contractuelles, des redevances de stationnement et des pertes de ventes qui se répercutent sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
- La campagne agricole 2021-2022 a affiché un piètre rendement du transport ferroviaire en dépit du faible volume des récoltes attribuable à la sécheresse. La campagne agricole 2022-2023 a été témoin d’un meilleur rendement du transport ferroviaire avec une production des récoltes nettement plus élevée.
- Les prévisions indiquent une croissance accrue des exportations dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, de l’exploitation minière et du pétrole, ce qui exercera sans doute de plus fortes pressions sur la capacité ferroviaire et aggravera les problèmes de service si des investissements stratégiques ne sont pas engagés.
- Les pressions sont particulièrement fortes au port de Vancouver, touché notamment par les actions syndicales dans les ports de la Colombie-Britannique en juillet 2023.
Concentration du pouvoir de marché : bien qu’il s’agisse techniquement d’un duopole, le système ferroviaire fonctionne souvent comme un monopole spatial, puisqu’environ 99 % des silos à grains ne sont desservis que par un seul chemin de fer.
« Le manque de fiabilité du service ferroviaire, l’inefficacité des mécanismes de règlement des différends et le manque de confiance dans la capacité des fournisseurs de services ferroviaires à répondre aux besoins des expéditeurs (et la capacité générale du secteur ferroviaire à accroître sa capacité pour répondre à la demande saisonnière) sont des défis importants soulevés par les expéditeurs. L’industrie a également exprimé des préoccupations quant à la pénurie importante de travailleurs et d’équipages ferroviaires, qui nuit à la capacité des fournisseurs de compter sur le rail pour la livraison des produits en temps opportun. » – Rapport final du Groupe de travail national sur la chaîne d’approvisionnement 2022
Parmi les principales recommandations du Groupe de travail national sur la chaîne d’approvisionnement, mentionnons les suivantes pour l’agriculture
Remédier à l’encombrement des ports
Modifier la gouvernance des ports et améliorer les infrastructures portuaires.
Développer l’Agence canadienne d’inspection des aliments et d’autres services gouvernementaux ayant trait au traitement des marchandises commerciales.
Interconnexion repoussée
Repousser la distance de l’interconnexion au‑delà des 30 km actuels dans tout le Canada afin d’offrir aux expéditeurs davantage d’options ferroviaires et de résoudre les problèmes d’équilibre des forces entre expéditeurs et chemins de fer (annexe A).
Révision de l’Office des transports du Canada
Réviser le mandat de l’Office des transports du Canada et lui accorder l’indépendance, l’autorité et le financement nécessaires à l’accomplissement de ce mandat.
Améliorer les enquêtes sur les initiatives propres et la collecte de données.
Visibilité de la chaîne d’approvisionnement et numérisation
Numériser et créer une visibilité de la chaîne d’approvisionnement globale pour plus d’efficacité, de responsabilité, de planification, d’investissement et de sécurité.
Questions relatives à la main-d'œuvre dans la chaîne d’approvisionnement
Élaborer une stratégie sur la main‑d’œuvre dans la chaîne d’approvisionnement.
Bureau de la chaîne d’approvisionnement
Créer un Bureau de la chaîne d’approvisionnement afin d’unifier la responsabilité et l’autorité du gouvernement fédéral en matière de gestion des transports de la chaîne d’approvisionnement.
Autres grands problèmes de transport et de chaîne d’approvisionnement ayant des répercussions sur le secteur agricole
Préoccupations constantes suscitées par la concurrence ferroviaire, la fiabilité et la résilience, ainsi que la fonctionnalité des instruments législatifs et des mécanismes de recours existants.
- ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Mesures visant à remédier à l’encombrement des ports (Transports Canada et Administration portuaire Vancouver-Fraser).
- Mise en œuvre de la gestion des navires actifs (GNA) (destinée à renforcer la sécurité maritime, à faciliter la circulation des marchandises et à gérer les incidences environnementales et sociales).
- Efforts en vue de trouver des solutions pour permettre le chargement des grains par mauvais temps.
Préoccupations des intervenants concernant l’Administration portuaire Vancouver-Fraser, notamment le conflit d’intérêts perçu en tant que promoteur et régulateur, et les modifications apportées aux redevances d’infrastructures portuaires.
Préoccupations suscitées par la fiabilité et la stabilité de la main-d'œuvre, y compris les appels à des règles sur les services essentiels pour éviter les grèves et autres perturbations à l’issue d’une grève par les travailleurs portuaires de Colombie-Britannique en juillet 2023, qui a eu de profondes répercussions sur les activités portuaires (annexe B).
Prochaines étapes
- Surveiller le rétablissement de la chaîne d’approvisionnement à l’issue de la grève des travailleurs de la Colombie-Britannique et continuer de mobiliser les intervenants du secteur agricole par le biais des tribunes existantes.
- Appuyer Transports Canada dans l’examen de la politique ferroviaire, notamment en mobilisant les intervenants du secteur agricole
- Parmi les principaux enjeux qui se posent au secteur agricole, mentionnons les recours; la concurrence ferroviaire et l’établissement des tarifs ferroviaires
- Analyser une stratégie des données pour surveiller les mouvements dans la chaîne d’approvisionnement des produits agricoles, notamment recueillir des données sur l’utilisation et les conséquences du projet pilote d’interconnexion repoussée de Transports Canada
- Continuer à appuyer Transports Canada dans la conception du Bureau de la chaîne d’approvisionnement des transports
Annexe A – Interconnexion
Définition
- Le transfert de trafic entre deux compagnies de chemin de fer. Une compagnie de chemin de fer assure le transport des marchandises des expéditeurs une partie du chemin avant de transférer les marchandises à une compagnie de chemin de fer concurrente qui les transporte sur la distance restante jusqu’à destination. Ce transfert a lieu à une interconnexion – où les lignes des deux compagnies de chemin de fer se croisent.
Mesure antérieure de limite d’interconnexion repoussée (2014-2017)
- En 2014, le projet de loi C-30, la Loi sur les transports au Canada, a été modifié pour augmenter la distance de correspondance à 160 km (par rapport à 30 km) afin d’améliorer la compétitivité avec un calendrier de temporisation de trois ans.
- Après la temporisation, la mesure a été remplacée par la mesure d’interconnexion grande distance actuelle, qui a fait l’objet d’une adhésion très faible et qui est perçue par la plupart des expéditeurs comme étant inefficace et ingérable. La limite d’interconnexion repoussée continue d’être la mesure préférée des expéditeurs du secteur agricole.
Budget 2023
- Annonce d’un amendement à la Loi sur les transports au Canada en vue d’un nouveau projet pilote qui repoussera provisoirement la distance d’interconnexion à 160 km (soit la même distance que le projet pilote antérieur), contre 30 km au préalable.
- Même si AAC a préconisé une période d’essai longue ou flexible, ce projet pilote prendra fin automatiquement 18 mois après être entré en vigueur.
Surveillance constante
- Continuer de surveiller les réactions des intervenants.
- Préparer une stratégie sur les données afin d’analyser l’incidence du projet pilote sur le système de transport et de manutention des grains.
Annexe B – Grève dans les ports de la Colombie-Britannique en 2023
Situation :
- Sept mille quatre cents membres de l’International Longshore and Warehouse Union (ILWU) ont lancé un mouvement de grève en Colombie-Britannique, notamment au port de Vancouver et au port de Prince Rupert le 1er juillet 2023. Cette grève, qui a duré 12 jours, a entraîné l’arrêt quasi total des activités de chargement et de déchargement au port.
- Le travail a repris le 13 juillet à l’issue d’un accord de principe entre l’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique (BCMEA) et l’ILWU, selon des conditions recommandées par un médiateur indépendant, à la demande du ministre du Travail. Toutefois, le syndicat a par la suite rejeté ces conditions et amorcé un autre mouvement de grève (plus tard jugé illégal).
- Le caucus de l’ILWU a recommandé à ses membres de ratifier l’accord de principe au cours du scrutin d’adhésion le 25 juillet.
Rétablissement :
- L’élimination de l’arriéré de conteneurs et d’autres marchandises en vrac devrait se prolonger jusqu’à l’automne, ce qui coïncidera avec le début des livraisons de la campagne agricole de 2023.
- D’un point de vue agricole, les perturbations durant la grève ont eu les répercussions les plus graves sur les expéditions conteneurisées, car les terminaux de grains en vrac ont continué de fonctionner en vertu du fait que le paragraphe 87.7 du Code du travail du Canada stipule que les débardeurs doivent continuer de charger et de décharger les navires qui transportent des grains en vrac.
- Répercussions sur la réputation du Canada sur un marché international concurrentiel
Annexe C – Surveillance du réseau de transport des grains
Le Groupe de travail sur la logistique du transport des récoltes (GTLTR) est un instrument précieux qui facilite la collaboration entre AAC et Transports Canada et l’industrie :
- Il est coprésidé par AAC (sous-ministre adjoint –Tom Rosser) et par la Canadian Canola Growers Association (Rick White).
- Il comporte des représentants des intervenants du secteur des grains comme Pulse Canada, la Western Grain Elevator Association, la Prairie Oat Growers Association et certains membres des gouvernements provinciaux.
- Il tient lieu de tribune aux intervenants pour discuter des enjeux actuels du Système de transport et de manutention des grains, des chaînes d’approvisionnement et de la prévention des encombrements.
AAC et Transports Canada ont signé un contrat conjoint avec la Quorum Corporation pour agir à titre de surveillant du transport des grains du Canada :
- Ce contrat est d’une valeur d’environ 1,2 million de dollars par an, dont AAC règle la moitié
- Le programme de surveillance des grains publie des mises à jour hebdomadaires, mensuelles et annuelles sur l’état du réseau de transport des grains au Canada, de même qu’une analyse sur les enjeux qui affectent les compagnies de chemin de fer et les expéditeurs de grain tout au long de l’année
-
Stratégie sur la main-d’œuvre agricole et travailleurs étrangers temporaires
Question
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a travaillé avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) et d’autres intervenants clés pour élaborer une stratégie sur la main-d’œuvre agricole (la Stratégie), afin de pallier les pénuries de main-d’œuvre chroniques dans le secteur.
Contexte
Le secteur agricole canadien fait face à des problèmes complexes persistants qui avaient déjà entraîné des pénuries chroniques de main-d’œuvre avant la pandémie, tant dans le secteur de l’agriculture primaire que de la transformation des aliments. Les pénuries sont particulièrement graves dans l’industrie de l’horticulture (par exemple, serres, pépinières, culture de fruits et légumes) et sont de plus en plus importantes dans le domaine de la fabrication d’aliments et de boissons (par exemple, pizzas surgelées, repas préparés).
- Taux de postes vacants (de 2015 à 2021) :
- Industries agricoles primaires : entre 7,5 % et 15,9 %;
- Industries de la transformation des aliments : entre 1,9 % et 5,8 %;
- Comparativement à 3,2 % pour l’ensemble de l’économie canadienne.
Dans l’avenir, la situation du marché du travail sera difficile dans le secteur, car la population vieillissante devrait entraîner une baisse du taux de participation global. Le Conseil sectoriel des ressources humaines en agriculture (CSRHA) croit que d’ici 2029, le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire comptera 123 000 emplois de plus que ce que la main-d’œuvre nationale pourra combler.
La pénurie de main-d’œuvre touche aussi l’ensemble de l’économie canadienne dans certains secteurs, comme la santé (par exemple, le personnel infirmier), le transport (par exemple, les camionneurs) et les métiers généraux (par exemple, les électriciens). Toutefois, si les tensions sur le marché du travail se sont poursuivies au premier trimestre de 2023, on observe des signes d’amélioration progressive. Le ratio chômeurs-postes vacants était de 1,3 personne sans emploi pour chaque poste vacant au Canada au premier trimestre de 2023, par rapport à 2,4 au premier trimestre de 2020.
La lettre de mandat de 2021 de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire incluait l’engagement suivant : « Avec l’appui de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap, et en partenariat avec les provinces et territoires, les employeurs, les syndicats et les travailleurs, élaborer une stratégie en matière de main-d’œuvre dans le secteur agricole pour combler les pénuries de main-d’œuvre chroniques et persistantes dans les secteurs de l’agriculture et de la transformation des aliments à court et long terme. »
Le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) aide les employeurs à répondre à leurs besoins en main-d’œuvre lorsque des Canadiens et des Canadiennes ou des résidents permanents qualifiés ne sont pas disponibles et garantit que les travailleurs étrangers temporaires (TET) sont protégés lorsqu’ils sont au Canada. Le PTET repose sur la demande des employeurs, qui peuvent l’utiliser pour combler temporairement des besoins immédiats en matière de compétences et de main-d’œuvre.
Les employeurs doivent obtenir une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) positive ou neutre, de sorte que l’embauche d’un TET n’ait pas d’incidence négative sur le marché du travail canadien. Les principaux éléments requis pour procéder à une embauche sous le régime du PTET sont 1) une EIMT accordée à l’employeur par EDSC et 2) une admissibilité au permis de travail, telle que déterminée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
Les économies avancées du monde entier se sont tournées vers la main-d’œuvre étrangère pour pallier le manque de travailleurs canadiens. Le Canada est de plus en plus dépendant des TET pour combler les pénuries de main-d’œuvre, et les TET constituent un segment croissant de la main-d’œuvre agricole, en raison de la difficulté à attirer des travailleurs canadiens; ils représentent environ 20 % de la main-d’œuvre de l’industrie saisonnière.
L’immigration est aussi un facteur déterminant de l’offre de main-d’œuvre au Canada, et selon les récentes estimations, elle compte pour presque toute la croissance de la population active au pays. La main-d’œuvre canadienne est la plus scolarisée des pays du G7, et les nouveaux immigrants représentent près de la moitié de la croissance de la proportion de Canadiens titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur. Toutefois, le secteur a besoin d’un plus grand nombre de travailleurs « non qualifiés » (c’est-à-dire des compétences acquises principalement par une formation en cours d’emploi et non par des études postsecondaires).
Situation actuelle
- Des consultations publiques sur la Stratégie ont été lancées durant l’été 2022, et les intervenants ont contribué de différentes façons : 1) consultations en ligne au moyen d’un questionnaire accessible du 27 juin au 28 septembre 2022; 2) boîte de courriel générique ouverte jusqu’au 31 décembre 2022; 3) collaboration ciblée avec des partenaires et d’autres intervenants; 4) échanges directs avec les provinces et les territoires sur divers forums fédéraux-provinciaux-territoriaux d’AAC. AAC a reçu des propositions écrites de 68 personnes et groupes du secteur, a examiné 218 questionnaires remplis en ligne, et a échangé sur des forums, dont le Conseil canadien de la jeunesse agricole et le Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada.
- Un rapport « Ce que nous avons entendu », qui résume les résultats des consultations a été publié le 18 mai 2023. Il est accessible à la page suivante : Rapport « Ce que nous avons entendu » - Stratégie sur la main-d’œuvre agricole.
- Compte tenu des thèmes abordés durant les consultations, la Stratégie prévoira des mesures ciblées dans les domaines suivants :
- Faciliter l’accès aux travailleurs étrangers;
- Accueillir les jeunes et les nouveaux arrivants tout en améliorant la représentation;
- Améliorer le soutien à la main-d’œuvre nationale;
- Créer les outils et les compétences de l’avenir;
- Renforcer la capacité : ressources humaines et information sur le marché du travail agricole.
- Le PTET et les efforts de réforme de l’immigration déployés par EDSC et par IRCC sont de la plus haute importance pour le secteur. AAC collabore étroitement avec EDSC et IRCC pour déterminer les paramètres des réformes à venir, notamment un modèle d’employeur de confiance, un nouveau programme de main-d’œuvre étrangère pour l’agriculture et la transformation du poisson et un cadre uniforme à l’échelle nationale concernant les logements des TET, en tenant compte des besoins du secteur agricole.
- Les ministères de l’Agriculture provinciaux-territoriaux (PT) jouent aussi un rôle important. Une partie du financement à coûts partagés de 2,5 milliards de dollars mis à leur disposition dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable peut être affectée à des initiatives liées à la main-d’œuvre et aux compétences, et des stratégies sur la main-d’œuvre agricole sont élaborées par certaines provinces. Les provinces peuvent également recourir au Programme des candidats des provinces pour combler les pénuries de main-d’œuvre, car elles ont la capacité de créer des groupes spécialisés en fonction de leurs besoins économiques et des titres de compétence qu’elles acceptent pour les candidats.
- En plus des travaux d’AAC, le secteur prend en charge les problèmes liés à la main-d’œuvre, et le Ministère tire parti des travaux dirigés par le CCRHA, en partenariat avec Aliments et boissons Canada et la Fédération canadienne de l’agriculture, pour élaborer le Cadre stratégique national sur la main-d’œuvre et s’assurer que la stratégie fédérale est complémentaire. Dans le cadre de cet engagement soutenu, les deux stratégies visent à collaborer pour déterminer des solutions à court, à moyen et à long terme aux pénuries de main-d’œuvre immédiates et aux problèmes systémiques liés à la main-d’œuvre.
Prochaines étapes
- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- Taux de postes vacants (de 2015 à 2021) :
-
Un code de conduite des épiceries
Contexte — Concentration et frais imposés par les détaillants
La concentration du marché confère aux grands détaillants une position dominante et un pouvoir de marché important
- Les cinq principaux détaillants alimentaires représentent environ 80 % du secteur
Les frais imposés par les détaillants aux fournisseurs ne sont pas nouveaux
- Les frais imposés par les détaillants sont les sommes totales que dépensent les fournisseurs auprès des détaillants pour que leurs produits se retrouvent dans les rayons (soit des dépenses de commercialisation)
- Ils sont un problème de longue date pour les transformateurs et les producteurs
- Certains frais sont mutuellement bénéfiques et prévisibles
- L’augmentation des autres frais est perçue comme étant unilatérale, rétroactive ou imprévisible depuis quelques années
Marché des épiceries canadiennes selon le volume des ventes, 2021
Épicerie Marché selon le volume des ventes (%) Loblaw
28
Sobeys
20
Metro
11
Costco
9
Walmart
8
Autres
24
Source: Who's Who Report 2021, Canadian Grocer Les frais imposés par les détaillants aux fournisseurs (annexe 1) varient généralement de mutuellement bénéfiques à controversés
Mutuellement bénéfiques
- Frais de commercialisation; frais d’adhésion et de présentation
Controversés
- Frais engagés par les détaillants et coûts d’investissement; amendes rétroactives et unilatérales
Appels à l’action
L’annonce des nouveaux frais imposés par les détaillants à l’été 2020, combinée aux défis et aux coûts associés à la pandémie de COVID-19, a attiré davantage l’attention sur les répercussions des pratiques du commerce de détail sur le reste de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
- Les intervenants, y compris les producteurs, les transformateurs et certains détaillants, ont lancé des appels à l’action afin d’assurer des pratiques commerciales équitables, transparentes et prévisibles pour l’industrie agroalimentaire.
- Les frais imposés par les détaillants sont liés aux transactions commerciales interentreprises et ils relèvent principalement de la compétence provinciale, ce qui complique l’adoption d’une approche nationale obligatoire.
Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) ont mis sur pied un groupe de travail, présidé par les ministres de l’Agriculture du Canada et du Québec, pour évaluer les répercussions des frais imposés par les détaillants sur l’industrie agroalimentaire.
- Les principales constatations ont été publiées en juillet 2021 (annexe 2).
- Les ministres ont demandé à l’industrie de diriger un processus collaboratif pour élaborer une proposition visant à améliorer la transparence, la prévisibilité et le respect des principes de l’utilisation équitable.
Processus dirigé par l’industrie
Les dirigeants de l’industrie ont répondu à l’appel en créant un modèle collaboratif de mobilisation de la chaîne d’approvisionnement en vue de concevoir un Code de conduite des épiceries.
- De multiples groupes de travail, formés d’entreprises et d’associations de l’industrie, ont participé au processus dirigé par l’industrie.
- Le leadership est assuré par le Comité directeur de l’industrie (annexe 3).
- Des mises à jour sur les progrès ont été fréquemment fournies aux ministres FPT.
Le Code de conduite des épiceries inclut des dispositions et des règles du commerce ainsi qu’un cadre pour la résolution des différends et la gouvernance au moyen d’un Bureau d’arbitrage du Code des épiceries.
- Alors que le Code est volontaire et dirigé par l’industrie, il est attendu que tous les principaux acteurs y participent.
- Il inclut l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, avec un accent sur les transformateurs et les détaillants.
Une grande consultation de l’industrie a été réalisée en mai 2023.
Situation actuelle
En juillet 2023, les ministres FPT ont réitéré leur appui au Code et à sa mise en œuvre d’ici la fin de l’année.
- Ils accepteraient de discuter d’un soutien financier à court terme afin de créer le Bureau.
Le Comité directeur de l’industrie continue de mettre la dernière main à la proposition à la suite des consultations.
- Révision des dispositions du Code.
- Ajout de détails sur la gouvernance, la résolution des différends et les prédictions du budget de fonctionnement.
- Établissement d’un calendrier pour que l’industrie déclare son intention de mettre en œuvre le Code (automne 2023).
Les gouvernements FPT continuent de faire un suivi actif et de soutenir les progrès de l’industrie.
- La proposition répond aux objectifs des ministres FPT, soit d’accroître la transparence, la prévisibilité et le respect des principes d’utilisation équitable dans les relations de la chaîne d’approvisionnement (annexe 4).
Dynamique de l’industrie
Le niveau de participation est essentiel pour concevoir un Code de conduite efficace.
- La participation généralisée au modèle volontaire dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire sera importante pour garantir son succès.
- Toutefois, l’essentiel sera la participation active des grands détaillants.
Certains intervenants, y compris de grands détaillants, ont identifié des domaines nécessitant d’autres discussions. Ils attendent de voir la proposition définitive avant de prendre un engagement.
- Afin de répondre directement à ces préoccupations, des efforts ciblés de l’industrie sont en cours.
Si certains grands détaillants ne garantissent pas leur participation, le Groupe de travail FPT pourrait préparer d’autres options à considérer.
Contexte général
Il y a beaucoup d’attention du public sur les chaînes d’approvisionnement alimentaires.
- Inflation des aliments, profits des épiceries, défis de la chaîne d’approvisionnement.
Les comités parlementaires continuent de demander l’adoption du Code de conduite des épiceries.
- Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire (AGRI), (avril 2021, juin 2022, juin 2023).
Il y a une volonté d’améliorer la concurrence dans l’industrie des épiceries.
- Publication de l’étude de marché du Bureau de la concurrence sur la concurrence dans le secteur de l’épicerie au Canada (juin 2023).
- Jusqu’à ce jour, l’amende la plus élevée visant la fixation des prix (50 millions de dollars) imposée par un tribunal canadien a visé la Canada Bread Company Ltd après avoir reconnu sa culpabilité dans la fixation illégale des prix.
- Examen de la Loi sur la concurrence.
Prochaines étapes
De concert avec les travaux de l’industrie, le groupe de travail FPT continuera de surveiller les progrès liés au développement du Code de conduite, d’encourager les prochaines étapes de mise en œuvre et de soutenir les efforts, au besoin (par exemple, du financement potentiel ou des communications).
Été 2023
- Mettre la dernière main à l’ébauche complète du modèle
- Dispositions du Code
- Gouvernance/concept juridique
- Modèle de règlement
Automne 2023
- Confirmation de l’industrie qu’elle s’engage à mettre en œuvre le Code
- Confirmation du financement des gouvernements FPT pour la création du Bureau d’arbitrage du Code des épiceries
Hiver 2023
- Création du Bureau d’arbitrage du Code des épiceries
- Nomination d’un arbitre du Code des épiceries
Annexe 1 : Exemples de frais imposés par les détaillants
Frais de rupture de stock des annonces
Pénalités imposées aux fournisseurs s’ils manquent de produits pendant la promotion.
Accords fondamentaux/nationaux
En général, les accords fondamentaux conclus entre les détaillants et les fournisseurs fixent des objectifs de vente nationaux et prévoient une prime pour le détaillant qui atteint l’objectif fixé. Ces accords peuvent donner lieu à un « traitement préférentiel », puisque les détaillants sont incités à accorder plus de place dans les rayons aux fournisseurs ayant conclu de tels accords, afin d’atteindre ses objectifs de vente. Ces accords peuvent rendre la concurrence difficile pour les nouveaux fournisseurs.
Frais de développement du commerce électronique
Une redevance basée sur un pourcentage que les vendeurs doivent payer sur tous les produits vendus par le détaillant au moyen de sa plateforme de commerce électronique. L’objectif de cette redevance est de compenser les investissements visant à accélérer l’expansion de la distribution de produits d’épicerie en ligne et des capacités de commerce électronique.
Frais d’exclusivité
Ceux-ci n’existent généralement pas en tant que tels, mais constituent un argument de négociation qui peut être échangé contre des frais de créneau.
Période de coupure ou de gel des prix prolongée
Les détaillants alimentaires imposeront unilatéralement un gel des prix (c’est-à-dire, des périodes de coupure obligatoires) pendant lequel il sera interdit aux fournisseurs de demander des augmentations de prix. Elles coïncident généralement avec les périodes de vacances (par exemple, de septembre à janvier). Si les fournisseurs doivent faire face à une augmentation du prix des ingrédients pendant cette période, ils doivent reporter l’augmentation de leur prix et, dans certains cas, ils doivent donner au détaillant un préavis de douze semaines. Si le détaillant accepte le nouveau prix, l’augmentation est valable à partir de la date d’acceptation et n’est pas antidatée à la date de la notification initiale.
Conditions supplémentaires
Une déduction de 1 à 2 %, appliquée par certains grands détaillants aux prix de leurs fournisseurs, pour financer des rénovations de magasins ou des acquisitions récentes.
Redevance de développement des infrastructures/allocation d’accélération stratégique
Ces frais, généralement exprimés en pourcentage du coût des marchandises achetées par le détaillant, sont facturés aux fournisseurs pour compenser les coûts d’infrastructure des détaillants, qui peuvent inclure la rénovation des magasins et des réseaux logistiques, la construction de nouveaux centres de distribution ou la mise en œuvre de systèmes nouveaux et mis à niveau pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.
Frais de retard de livraison
Frais qui sont déduits hors facture par le détaillant comme pénalité pour les livraisons effectuées plus tard que ce qui est indiqué sur le bon de commande. Ces frais varient généralement entre 500 et 1 000 dollars par commande, ou entre 200 et 500 dollars si le détaillant est prévenu du retard.
Frais supplémentaires
Ces frais correspondent à un pourcentage des ventes des fournisseurs, généralement compris entre 1 et 15 %, qui est déduit par le détaillant pour soutenir le travail de commercialisation (par exemple, la production des prospectus promotionnels) et sa distribution. Les frais supplémentaires sont une pratique courante dans l’industrie, mais ils varient d’une entreprise à l’autre. Ils s’appliquent à tous les fournisseurs, tant les acteurs établis que les nouveaux venus.
Conditions de paiement
En général, les fournisseurs de l’industrie offrent une réduction de 2 % sur les paiements effectués dans les 10 jours, ou ne facturent aucun intérêt pour les paiements effectués dans les 30 jours. Toutefois, certains grands détaillants imposent d’autres conditions de paiement standard (par exemple, aucun intérêt pour les paiements effectués dans les 90 jours). En outre, certains détaillants appliquent une déduction de 2 % sur la facture de vente en gros, même si le paiement a lieu en dehors de la fenêtre de 10 jours. Si cette pratique ne constitue pas nécessairement un obstacle à l’entrée sur le marché des fournisseurs, elle représente une contrainte majeure en matière de coûts, car il n’y a aucune garantie quant à la date et au montant du paiement qui sera reçu.
Frais d’inscription au catalogue/frais de présentation/frais de listage
Le détaillant facture des frais de présentation pour attribuer un espace à chaque produit alimentaire. Il s’agit de paiements forfaitaires dus dès l’approbation, sans garantie de durée minimale des ventes. S’il est généralement entendu que l’espace est réservé pour 12 mois, le détaillant n’est pas obligé de respecter ce délai. De nombreux fournisseurs considèrent que l’évaluation des frais de présentation et de listage est la pratique la plus controversée des détaillants, car il n’existe pas de tableau de frais fixes. En effet, ces frais sont établis par des négociations entre le détaillant et le fournisseur.
Frais de déchargement
Il est interdit aux chauffeurs de participer au déchargement de leurs camions dans presque tous les centres de distribution des détaillants. Par conséquent, chaque centre fait appel à une entreprise tierce sur place (connue sous le nom de « déchargeurs » ou « dockers ») pour assurer ce service. Ces frais coûtent de 50 à 500 dollars en fonction du nombre de palettes et du temps nécessaire au déchargement.
Frais sur les marchandises invendables
Au cours de la dernière décennie, la responsabilité des produits endommagés en transit ou en magasin a été transférée du détaillant au fabricant. Ces frais sont facturés au fournisseur sous la forme d’un pourcentage des ventes annuelles (par exemple, 1 à 1,5 % pour les produits de longue conservation) et sont généralement pris en compte dans la tarification de la plupart des produits par les fournisseurs.
Source : Liste élaborée à partir d’informations provenant de diverses sources, dont Simon Dessureault (Université de Guelph) et Sean Lippay (Strategic Food Solutions).
Annexe 2 : Principales constatations du groupe de travail FPT
La concentration dans le secteur de la vente au détail permet aux détaillants d’utiliser leur pouvoir de négociation pour imposer une série de frais aux fournisseurs afin de fournir et de commercialiser leurs produits en magasin. Récemment, la forme et l’ampleur des frais imposés par les détaillants ont augmenté et la manière dont ils sont imposés a changé.
L’imprévisibilité et le manque de transparence dans la façon dont certains frais sont perçus, ainsi que les recours limités et souvent complexes pour la résolution des litiges, ont conduit à une tension générale des relations au sein de la chaîne d’approvisionnement, des détaillants aux producteurs primaires. Cette situation fait également en sorte que l’environnement d’investissement du Canada semble moins attrayant pour certaines entreprises de fabrication de produits alimentaires.
Cette dynamique a d’autres répercussions secondaires; elle empêche les petits transformateurs et producteurs d’accéder au marché, elle entrave l’innovation et elle crée des problèmes particuliers d’approvisionnement et de prix pour les détaillants indépendants et les producteurs locaux auprès desquels ils s’approvisionnent.
Annexe 3 : Membres du Comité directeur de l’industrie
- Denise Allen — Food Producers of Canada
- Diane J. Brisebois — Conseil canadien du commerce de détail - Coprésidente
- Sylvie Cloutier — Conseil de la transformation alimentaire du Québec
- Mathieu Frigon — Association des transformateurs laitiers du Canada
- Michael Graydon — Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada – Coprésident
- Rebecca Lee — Producteurs de fruits et légumes du Canada
- Ron Lemaire — Association canadienne de la distribution de fruits et légumes
- Stéphanie Levasseur — Union des producteurs agricoles du Québec
- Scott Ross — Fédération canadienne de l’agriculture
- Gary Sands — Fédération canadienne des épiciers indépendants
Annexe 4 : Forte concordance entre le Code de conduite proposé et les objectifs stratégiques des ministres FPT
Promotion de la transparence, de la prévisibilité et du respect des principes de traitement équitable :
- Encourager l’entente réciproque pour modifier les accords d’approvisionnement afin de limiter les fluctuations qui ont un effet négatif sur la chaîne d’approvisionnement
- Permettre la protection de la propriété intellectuelle, ce qui favorise un environnement commercial positif et innovant et peut favoriser les investissements dans le secteur de la transformation des aliments
- Promouvoir des prévisions concertées pour une trésorerie prévisible
- Limiter les pratiques de paiement unilatérales et rétroactives, ce qui améliore la prévisibilité pour les entreprises
- Promouvoir l’éducation pour prévenir les différends et renforcer les relations au sein de la chaîne d’approvisionnement, ce qui pourrait avoir des résultats positifs pour les petites et moyennes entreprises (PME) :
- Réduit au minimum les coûts et les délais de règlement des différends pour les membres
- Offre des possibilités de règlement informel des différends, ce qui peut réduire la confrontation
- Reconnaît que les services doivent être accessibles à tous les membres
-
Pesticides et transformation de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Introduction à l’usage et à la réglementation des pesticides agricoles au Canada
Objet
Cette présentation a pour but de donner un bref aperçu :
- du rôle des pesticides en agriculture;
- de la façon dont les produits antiparasitaires sont réglementés au Canada;
- du rôle d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) dans la gestion des pesticides et la lutte antiparasitaire;
- des limites maximales de résidus (LMR);
- de la transformation de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA);
- des grands enjeux liés aux pesticides;
- des points de vue des intervenants.
Le rôle des pesticides en agriculture
Les pesticides sont un outil important pour favoriser la stabilité et la croissance du secteur agricole.
Actuellement à l’échelle mondiale, on perd annuellement en moyenne 35 % du rendement potentiel des cultures à cause des mauvaises herbes, des organismes nuisibles et des maladies.
Sans l’utilisation de pesticides, les agriculteurs canadiens pourraient perdre les trois quarts de leur production de fruits, la moitié de leur production de légumes et un tiers de leur production de céréales, ce qui aurait un impact considérable sur l’approvisionnement et les prix des denrées alimentaires, ainsi que sur la sécurité alimentaire mondiale.
Au total, 130 millions de kilogrammes d’ingrédients actifs de pesticides sont vendus chaque année au Canada, pour une valeur commerciale directe estimée à plus de 3 milliards de dollars.
Les pesticides aident les cultivateurs canadiens à s’adapter à la prolifération et à la migration vers le nord des organismes nuisibles amenée par les changements climatiques.
Les pesticides permettent aussi une agriculture sans travail du sol, ce qui est favorable à la séquestration du carbone et à l’atténuation des changements climatiques.
« Les pesticides jouent un rôle important dans la production alimentaire et permettent de préserver ou d’accroître les rendements et le nombre de fois où une culture peut être produite chaque année sur une même terre. » (Organisation mondiale de la santé, 2020)
La réglementation des pesticides au Canada
Une surveillance réglementaire rigoureuse est requise, car les pesticides qui ne sont pas utilisés conformément aux conditions prescrites peuvent poser des risques pour l’environnement et la santé humaine.
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) est l’organisme de Santé Canada qui est responsable de la réglementation des pesticides conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires.
Les travaux de l’ARLA portent sur les pesticides utilisés en agriculture pour lutter contre les mauvaises herbes, les maladies des végétaux et les dommages causés par les insectes aux cultures et au bétail.
L’ARLA est tenue de procéder à l’évaluation des risques des nouveaux produits avant leur mise en marché, d’effectuer des réévaluations (cycle de 15 ans) et des examens spéciaux des produits homologués et de préciser les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides qui peuvent demeurer sur ou dans les aliments.
Les limites maximales de résidus
Les LMR sont des limites ayant force exécutoire qui correspondent à la quantité maximale de résidus censée rester dans ou sur un produit alimentaire lorsque le pesticide est appliqué selon les directives figurant sur l’étiquette.
De grandes marges de sécurité sont appliquées lors de l’établissement des LMR. Par exemple, il faudrait qu’une personne consomme durant toute sa vie un panier d’épicerie et demi de pommes par jour avant que les résidus de pesticides puissent atteindre un niveau préoccupant pour la santé.
Les LMR s’appliquent à l’échelle du pays tant aux aliments canadiens qu’aux aliments importés. Des LMR manquantes ou non harmonisées entre les pays peuvent entraîner des perturbations commerciales. Le Canada appuie l’utilisation de normes alimentaires internationales fondées sur la science, lorsque cela est possible, afin de protéger les consommateurs et de faciliter le commerce.
Le rôle d’Agriculture et Agroalimentaire Canada dans la gestion des pesticides et la lutte antiparasitaire
AAC collabore avec les agriculteurs pour cerner les problèmes phytosanitaires prioritaires qui affectent l’agriculture canadienne.
Le Centre de la lutte antiparasitaire génère des données pour soutenir la réglementation des pesticides utilisés pour les cultures de faible superficie (par exemple, fraises ou asperges) ou les organismes nuisibles moins courants. Le Ministère collabore au niveau international pour soutenir les agriculteurs lorsque la petite taille du marché au Canada limite l’accès aux produits et aux usages.
Le programme Solutions de rechange pour la lutte antiparasitaire mène des travaux de recherche et de développement sur des méthodes plus sûres de lutte contre les organismes nuisibles et promeut des solutions à moindre risque pour les problèmes prioritaires liés aux organismes nuisibles (par exemple, les biopesticides et la culture de prédateurs naturels pour lutter contre les insectes nuisibles).
Le Ministère cherche également à faciliter l’harmonisation des LMR à l’échelle internationale pour soutenir les exportations de produits agricoles et agroalimentaires canadiens et minimiser les perturbations commerciales.
La transformation de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 4 août 2021, à la suite de plusieurs articles dans les médias francophones critiquant les décisions de l’ARLA, les ministres de la Santé, de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, et de l’Environnement et du Changement climatique ont annoncé une pause dans l’augmentation des LMR. À cette occasion, ils ont aussi annoncé un financement nouveau de 50 millions de dollars sur trois ans afin :
- de procéder à un examen ciblé de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- d’accroître l’accès à des avis indépendants et à des données indépendantes pour appuyer les décisions découlant de l’examen des pesticides;
- d’accroître la transparence.
Cette annonce incluait aussi un financement de 7 millions de dollars à AAC pour soutenir la recherche sur les solutions de rechange à l’usage des pesticides chimiques.
Le 20 juin 2023, le gouvernement a annoncé les prochaines étapes dans le programme de transformation de la réglementation des pesticides, y compris :
- la levée de la pause sur l’augmentation des LMR pour les pesticides au Canada;
- une consultation à venir sur des changements proposés au Règlement sur les produits antiparasitaires;
- l’harmonisation avec le Cadre mondial pour la biodiversité de l’ONU, y compris :
- modifier la Stratégie pour un gouvernement vert afin d’éliminer l’usage de pesticides à des fins esthétiques sur les terres fédérales;
- élaborer des stratégies et des mesures concrètes pour réduire le risque lié aux pesticides au Canada.
Principaux enjeux
La levée de la pause sur les augmentations des LMR
- Santé Canada a annoncé la levée progressive de la pause, en commençant par les propositions les moins complexes, et a cité de nouvelles mesures visant à améliorer la transparence et la disponibilité de données et d’avis indépendants sur les pesticides.
- L’annonce a été bien accueillie par les associations de producteurs, en particulier dans l’Ouest, où l’on estimait que la pause n’était pas fondée sur la science. Les médias francophones continuent de soulever des préoccupations auprès de leur public au Québec.
- AAC continue de plaider en faveur de l’harmonisation internationale des LMR fondées sur des données scientifiques, conformément aux engagements de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La démission du coprésident du Comité consultatif scientifique de l’ARLA
Le Dr Bruce Lanphear, professeur en santé et environnement à l’Université Simon Fraser, a démissionné publiquement de son rôle au sein d’un comité nouvellement formé mis sur pied pour offrir à l’ARLA des avis scientifiques indépendants; il a déclaré que les travaux du comité étaient visés par trop de restrictions et que le système réglementaire était obsolète et protégeait davantage l’industrie des pesticides que la population canadienne.
- Les communiqués de presse diffusés par les groupes de défense de l’intérêt public et la couverture médiatique brossent une image négative de l’organisme de réglementation.
- AAC appuie les efforts pour accroître la confiance du public à l’égard du système de réglementation fondé sur la science de l’ARLA.
Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal (COP-15) – Cible 7
Durant la réunion de décembre 2022, toutes les parties ont convenu de : « Réduire les risques de pollution et l’impact négatif de la pollution de toutes sources, d’ici à 2030, à des niveaux qui ne sont pas nuisibles à la biodiversité et aux fonctions et services des écosystèmes [...] en réduisant de moitié au moins le risque global lié aux pesticides et aux produits chimiques hautement dangereux, y compris par la lutte intégrée contre les ravageurs, fondée sur des données scientifiques, en tenant compte de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance [...]. »
- Les producteurs agricoles appuient l’idée de réduire les risques associés à l’usage des pesticides et sont favorables aux nouvelles technologies, comme l’agriculture de précision. Ils craignent toutefois que la cible 7 ne donne lieu à des objectifs de réduction de l’utilisation des pesticides qui ne tiennent pas suffisamment compte des besoins des producteurs en matière de lutte contre les organismes nuisibles.
- AAC collabore étroitement avec Environnement et Changement climatique Canada, avec les provinces et territoires et avec d’autres partenaires dans l’élaboration d’une approche pour atteindre la cible 7 qui soit en harmonie avec la Stratégie pour une agriculture durable et favoriser des consultations fructueuses avec le secteur.
Le glyphosate
Le glyphosate est le pesticide le plus utilisé au monde; il représente plus de la moitié de tous les pesticides agricoles vendus au Canada chaque année. Son utilisation dans la production de cultures génétiquement modifiées, ainsi que les allégations selon lesquelles il peut causer le cancer, ont placé le glyphosate au centre du débat très polarisé sur les pesticides.
- Les organismes de réglementation continuent de soutenir la sûreté du glyphosate, un outil important pour l’agriculture sans labour. La majeure partie de l’attention médiatique est négative et se concentre sur les décisions rendues par les tribunaux américains et sur la réputation de Monsanto, le fabricant original du glyphosate.
- AAC continue de soutenir l’agriculture durable tout en reconnaissant l’importance qu’ont actuellement les pesticides chimiques dans l’atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et de protection de l’environnement.
La décision découlant de la réévaluation de la lambda-cyhalothrine
La lambda-cyhalothrine est un insecticide synthétique utilisé pour lutter contre un vaste éventail d’insectes nuisibles, y compris les criquets, et sur une grande variété de cultures. En raison de préoccupations pour la santé des enfants, l’ARLA a révoqué plusieurs usages de ce produit qui étaient auparavant permis, et le produit a été retiré du marché à la dernière minute; cela a suscité des inquiétudes et causé de la confusion chez les producteurs de grains. De plus, cela suscite des préoccupations en raison de la dépendance à l’égard des importations d’aliments pour animaux en provenance des États-Unis, où la lambda-cyhalothrine est encore couramment utilisée.
- Les agriculteurs de l’Ouest sont frustrés par la perte d’un outil de lutte antiparasitaire économique qui est encore couramment utilisé aux États-Unis Les ministres FPT mettent sur pied un groupe de travail chargé d’étudier cet enjeu et d’autres enjeux liés aux pesticides.
- AAC collabore avec les fabricants de pesticides pour assurer un approvisionnement adéquat en pesticides de remplacement pour faire face aux problèmes importants causés cette année par les criquets et travaille de concert avec ses homologues américains concernant la divergence entre les LMR qui prendront effet en 2024.
Points de vue des intervenants
Les producteurs agricoles conventionnels
Pour 97 % des cultures au Canada, les pesticides demeurent un outil essentiel sur lequel les producteurs comptent. Tandis qu’ils soutiennent les approches durables qui réduisent les coûts des pesticides, ils craignent des baisses de rendement qui pourraient les rendre non compétitifs. Par conséquent, ils aimeraient des conditions équitables par rapport à leurs concurrents américains (c’est-à-dire, des LMR harmonisées, l’accès aux même produits, etc.).
Les producteurs d’aliments biologiques
Étant donné que seulement 3 % de la production agricole canadienne est biologique, les producteurs sont encore plus préoccupés par le manque d’accès aux pesticides homologués adaptés à la production biologique. Ils s’inquiètent également de la contamination de leurs cultures par des pesticides synthétiques, qui pourrait menacer la certification biologique et l’accès aux marchés internationaux.
Le public
Influencés par les messages publics provenant de diverses sources, la plupart des habitants des centres urbains ont tendance à s’opposer à l’utilisation des pesticides en général, mais ils acceptent mieux les pesticides lorsqu’on leur présente des scénarios spécifiques de lutte contre les organismes nuisibles. Les habitants des zones rurales ont généralement plus d’expérience avec les pesticides et acceptent mieux leur utilisation. Remarque : Les pesticides retiennent davantage l’attention des médias québécois francophones et font face à une opposition plus vive au Québec.
-
Exportation de chevaux aux fins d’abattage
Objet
Présenter de l’information sur la directive de la lettre de mandat d’interdire l’exportation de chevaux aux fins d’abattage, y compris :
- Contexte de la composition et des tendances de l’industrie
- Positions des intervenants et opinion publique
- Évolution récente
Contexte : Composition de l’industrie
- La plupart des exportations se font depuis des aéroports en Alberta.
- Le Japon est la première destination des exportations de chevaux vivants destinés à l’abattage.
- Le Canada abat des chevaux pour la consommation humaine.
- En 2022, on estime qu’environ la moitié de la viande chevaline (52 %) était exportée, la consommation au Canada étant principalement observée au Québec.
- Une partie des chevaux sont élevés expressément à des fins de consommation humaine.
- Le marché canadien de la viande chevaline est en lent déclin (annexe A).
- En 2022, la valeur des exportations de viande chevaline était plus de deux fois supérieure à celle des exportations de chevaux vivants destinés à l’abattage.
Exportations de chevaux aux fins d’abattage en 2022
Exportations de chevaux aux fins d’abattage :
- 2 579 chevaux dont la valeur est évaluée à 18,9 millions de dollars
Principales destinations des exportations de chevaux aux fins d’abattage :
- Japon (100 %)
Provinces d’exportation
- Alberta - 14,7 millions de dollars (78 %)
- Ontario - 2,7 millions de dollars (14 %)
- Manitoba - 1,4 million de dollars (8 %)
Viande chevaline exportée
- 2 300 tonnes dont la valeur est évaluée à 24,3 millions $
Principales destinations de la viande chevaline exportée
- Japon - 17,5 millions de dollars (72 %)
- États-Unis - 3,2 millions de dollars (13 %)
- Suisse - 2,6 millions de dollars (11 %)
Cycle de production et règles de bien-être animal
Acquisition des chevaux (principalement de compétence provinciale)
- Le producteur typique élève des chevaux à des fins multiples, envoyant certains poulains à l’exportation pour abattage.
- Secteur régi par les règlements provinciaux sur le bien-être animal.
Transport terrestre vers le parc d’engraissement (compétence principalement fédérale)
- La Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux liée au transport s’appliquent.
- Comprend souvent un transport interprovincial.
- Mise en application de la loi par l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Parc d’engraissement (principalement de compétence provinciale)
- Chevaux élevés dans des parcs d’engraissement canadiens pendant plusieurs mois.
- Les codes de pratique de l’industrie s’appliquent.
- Les règlements provinciaux en matière de bien-être animal s’appliquent également.
Transport terrestre vers l’aéroport (compétence principalement fédérale)
- La Loi sur la santé des animaux et la règlementation liée au transport s’appliquent.
- Le chargement se fait depuis des remorques dans des caisses de transport spécialisées.
Transport aérien vers un pays étranger (compétence principalement fédérale)
- Approbation de l’ACIA avant le décollage.
- La Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux liée au transport s’appliquent.
- Environ 2 chargements de 100 à 125 chevaux par mois.
- De 20 à 22 heures de transport entre le parc d’engraissement et la quarantaine japonaise.
Engraissement en parc d’engraissement dans un pays étranger (aucune compétence canadienne)
- Au Japon, certains chevaux sont engraissés pendant 6 mois à 4 ans de plus.
- Le Canada n’a aucune compétence.
Abattage dans un pays étranger (aucune compétence canadienne)
- Le Canada n’a aucune compétence.
La situation au Canada
- La question de l’abattage des chevaux soulève des opinions tranchées et variées depuis des décennies au Canada.
- Plusieurs pétitions ont été déposées pour interdire l’exportation de chevaux aux fins d’abattage.
- Dans la pétition la plus récente (février 2023; pétition E-4190; 36 000 signatures), on affirme que le transport depuis le Canada jusqu’au Japon cause aux chevaux un stress important qui les rend à risque de blessure, de maladie et même de décès durant le transport et on demande à ce que l’engagement de la lettre de mandat soit réalisé.
- Plusieurs projets de loi d’initiative parlementaire associés à l’abattage ou au transport des chevaux ont été déposés au Parlement (annexe B). Ils portaient sur :
- Le bien-être animal, comme la restriction du temps passé dans le transport;
- La salubrité des aliments, comme le renforcement des exigences en matière de production de rapports sur les substances qu’il est interdit de donner aux chevaux devant être abattus pour consommation humaine.
- En 2019, la poursuite déposée par la Canadian Horse Defence Coalition (CHDC) contre l’ACIA a été rejetée par un juge fédéral (annexe C).
- La CHDC a porté la décision en appel; l’appel est actuellement en suspens à la demande de la CHDC.
Positions des intervenants et opinion publique
- Les intervenants de l’industrie impliqués dans la production et l’exportation de chevaux vivants ont exprimé des inquiétudes par rapport à une possible interdiction, notamment :
- Les répercussions sur l’économie et les moyens de subsistance des producteurs, y compris les communautés autochtones.
- Les conséquences imprévues d’une interdiction, comme une incidence sur les choix de fin de vie.
- La crainte que cela ne crée un précédent et ne mette en danger la pratique de l’abattage des chevaux au pays, ainsi que l’abattage et l’exportation d’autres espèces de bétail.
- L’abattage de chevaux destinés à la consommation humaine et l’exportation de chevaux destinés à l’abattage, en particulier les conditions de transport aérien, ont beaucoup attiré l’attention dans les médias et sur les réseaux sociaux.
- En février 2021, W5 (CTV) a diffusé une émission intitulée « Investigation of Canada’s Controversial Horse Meat Industry » (enquête sur l’industrie controversée de la viande chevaline au Canada) qui a accru la sensibilisation à ces questions.
- Un sondage d’opinion publique auprès de 1 000 Canadiens a révélé que la majorité des répondants avaient une vision négative de l’exportation ou de l’abattage de chevaux pour consommation humaine (annexe D).
Enjeu – les inquiétudes du public
Les groupes de défense des droits des animaux ont soulevé des préoccupations concernant l’exportation de chevaux pour abattage.
- Sentiment que les conditions de transport aérien sont cruelles et inutiles lorsque l’exportation de viande est une option :
- Les chevaux sont uniques (ils paniquent facilement, ont un fort instinct de lutte ou de fuite, ont une ouïe sensible) et requièrent des soins supplémentaires durant le transport.
- Les aéroports sont des lieux stressants (bruits forts et inhabituels, exposition à des conditions météorologiques extrêmes, longues périodes d’attente, chargement et manutention).
- Il y a des différences notables entre les chevaux élevés pour abattage et ceux élevés à d’autres fins (meilleures conditions de transport aérien).
Toutefois, l’approche canadienne actuelle :
- Est fondée sur la science :
- Les exigences relatives au bien-être des animaux reposent sur des données probantes (annexe E).
- A de solides antécédents en matière de conformité :
- On ne trouve aucune preuve dans les rapports/statistiques pour étayer un problème de bien-être animal (seulement cinq décès de chevaux liés au transport aérien à destination du Japon depuis 2013).
- Absence de non-conformité dans les rapports d’inspection.
- Est soutenue par la loi. La Cour fédérale a statué que l’approche de l’ACIA en matière de mise en application de la loi est légale (annexe C).
Évolution récente
- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Prochaines étapes
███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████Annexe A : Tendances dans l’industrie de la viande chevaline
Nombre de chevaux exporté par motif, hors États-Unis
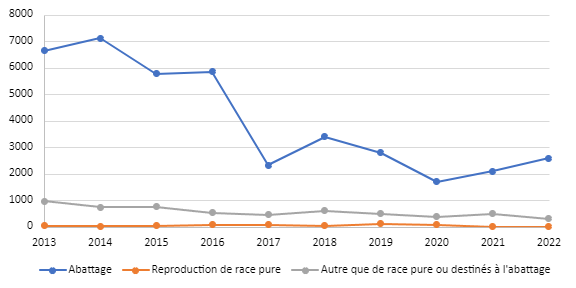
[Description de l’image ci-dessous]
Graphique montrant le nombre de chevaux exportés par destination (abattage, reproduction de race pure et autres) vers des destinations autres que les États-Unis, de 2013 à 2022. Le nombre de chevaux exportés pour l’abattage a diminué de 7 000 en 2014 à 2 600 en 2022. Le nombre de chevaux exportés pour la reproduction de race pure est resté à 120 ou moins au cours de la décennie. Le nombre de chevaux exportés pour d’autres raisons est resté inférieur à 1 000, diminuant au fil du temps.
Nombre de chevaux exporté par motif, hors États-Unis
Année Abattage Reproduction de race pure Autre que de race pure ou destinés à l'abattage 2013 6 635 33 963 2014 7 111 26 735 2015 5 782 34 765 2016 5 839 90 542 2017 2 326 80 456 2018 3 396 37 611 2019 2 800 120 483 2020 1 708 87 385 2021 2 100 8 489 2022 2 579 0 309 - Le nombre de chevaux exportés pour l’abattage diminue :
- 7 000 en 2014 comparativement à 2 600 en 2022.
- Pour les destinations autres que les États-Unis, l’exportation de chevaux pour l’abattage demeure le principal motif d’exportation.
- Aucun cheval n’est exporté aux États-Unis pour l’abattage.
- La plupart sont élevés en vue de l’abattage pour la production de viande.
Valeur des exportations (en millions de dollars) des chevaux vivants destinés à l'abattage par rapport à la viande de cheval
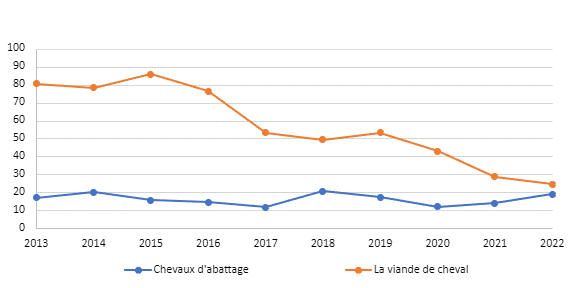
[Description de l’image ci-dessous]
Graphique montrant la valeur des exportations, en millions de dollars, de chevaux vivants destinés à l’abattage par rapport à la viande chevaline, de 2013 à 2022. La valeur à l’exportation des chevaux destinés à l’abattage a fluctué entre 10 et 20 millions de dollars par année de 2013 à 2022. La valeur à l’exportation de la viande de cheval baisse depuis dix ans, les exportations se chiffrant à 80 millions de dollars en 2013 et 24 millions de dollars en 2022.
- La valeur à l’exportation des chevaux destinés à l’abattage fluctue entre 10 et 20 millions de dollars par année.
- La valeur à l’exportation de la viande de cheval baisse depuis dix ans, les exportations se chiffrant à 24 millions de dollars en 2022.
- 72 % de la valeur des exportations de viande de cheval est attribuable au Japon.
- L’abattage de chevaux au pays pour la production de viande a diminué, passant de 82 200 en 2012 à 14 100 en 2022.
Annexe B : Projets de loi d’initiative parlementaire ou émanant du Sénat
- Par le passé, plusieurs projets de loi d’initiative parlementaire associés à l’abattage ou au transport des chevaux ont été déposés au Parlement. Ils portaient sur :
- Le bien-être animal, comme la restriction du temps passé dans le transport;
- La salubrité des aliments, comme le renforcement des exigences sur les substances interdites.
- Un seul projet de loi d’initiative parlementaire (C-571) a fait l’objet d’un vote et a été rejeté (mai 2014).
- D’autres projets de loi sont morts au Feuilleton en raison de la dissolution ou de la prorogation du Parlement.
- Le 20 juin 2023, le député Tim Louis (Kitchener-Conestoga) a annoncé son intention de déposer un projet de loi d’initiative parlementaire pour interdire l’exportation de chevaux aux fins d’abattage lorsque les travaux de la Chambre reprendront à l’automne 2023.
- Le 21 juin 2023, le sénateur Pierre J. Dalphond a déposé au Sénat le projet de loi S-270, qui vise à :
- Modifier la Loi sur la santé des animaux afin d’interdire l’exportation depuis le Canada de chevaux et autres équidés aux fins d’abattage. On considère qu’une personne a exporté un cheval aux fins d’abattage si cette personne sait ou devrait raisonnablement savoir que le cheval ou autre équidé est exporté pour être abattu ou pour être engraissé puis abattu.
- Modifier ledit Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire afin de rendre le régime de sanctions administratives pécuniaires décrit dans ledit règlement applicable en cas de violation de l’interdiction d’exporter des chevaux ou autres équidés aux fins d’abattage.
Annexe C : Affaire présentée à la Cour fédérale
- En 2018, la CHDC a intenté une action en justice contre l’ACIA devant la Cour fédérale.
- La coalition affirme que l’ACIA a autorisé l’expédition de grands chevaux, ce qui viole les dispositions du Règlement sur la santé des animaux.
- En décembre 2019, la poursuite a été rejetée par un juge fédéral.
- Le juge a estimé que l’ACIA participe à la protection du bien-être des animaux pendant l’exportation et qu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable dans l’application de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux.
- Un appel a été déposé; on s’attend à ce que l’appelant demande une suspension de l’appel pendant un an, compte tenu de la lettre de mandat.
- En février 2020, une nouvelle règlementation en matière de transports est entrée en vigueur. Cette nouvelle règlementation fondée sur les résultats a remplacé celle qui est mise en examen dans le cadre de l’affaire judiciaire.
Annexe D : Sondage d’opinion publique (Research Co., 2021)
- Research Co. a effectué un sondage en ligne auprès de 1 000 adultes au Canada.
- Résultats du sondage sur l’exportation de chevaux pour l’abattage et la consommation humaine :
- Deux tiers des Canadiens (67 %) s’opposent à cette pratique, tandis que 22 % la soutiennent et que 12 % sont indécis.
- Seuls 16 % des répondants savaient que des chevaux canadiens ont été exportés pour être abattus et consommés au Japon et en Corée du Sud.
- Seuls 27 % des Canadiens considèrent qu’il est approprié pour les humains de consommer des chevaux, tandis que 65 % jugent cela inapproprié et 8 % sont indécis.
- En revanche, au moins trois Canadiens sur quatre pensent que les poulets (88 %), les porcs (79 %), les dindes (75 %) et les bovins (75 %) sont des sources de nourriture appropriées pour les humains.
- Une majorité de Canadiens pense également que la consommation de six autres espèces animales est appropriée : canards (71 %), moutons (69 %), poissons (68 %), chèvres (64 %), lapins (58 %) et oies (58 %).
Annexe E : Régime canadien de protection du bien-être animal
- Le traitement sans cruauté du bétail est protégé par un ensemble de lois et de règlements provinciaux et fédéraux.
- Les soins aux animaux sur les exploitations agricoles sont de compétence provinciale.
- Le bien-être des animaux durant le transport est de compétence fédérale (Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux).
- Des exigences révisées et plus rigoureuses concernant le transport sans cruauté des animaux sont entrées en vigueur en février 2020 en vertu du Règlement sur la santé des animaux (RSA).
- Ce changement découle de nombreuses années de consultations auprès des vétérinaires, des éleveurs, des transporteurs, des associations, des scientifiques, des gouvernements, du public et des groupes d’intervenants intéressés.
- L’ACIA inspecte tous les chargements de chevaux vivants expédiés par avion pour vérifier que les exigences d’exportation du Règlement sur la santé des animaux sont respectées et que les chevaux sont aptes à voyager et transportés conformément au Règlement sur la santé des animaux.
- Le transport aérien de chevaux est l’activité de transport d’animaux qui est surveillée le plus étroitement au Canada.
- Aucune espèce de bétail n’est visée par une interdiction d’exportation, y compris une interdiction fondée sur les fins ou l’usage final.
- Les mêmes règles s’appliquent, peu importe si les chevaux sont exportés aux fins d’abattage ou à d’autres fins (par exemple, pour les courses de chevaux).
-
Commerce international
État du commerce des produits agroalimentaires au Canada
Malgré des perturbations initiales liées à la COVID-19 et à la guerre en Ukraine dans les chaînes d’approvisionnement agroalimentaires, les échanges commerciaux se sont poursuivis et ont affiché des gains : les exportations ont dépassé 92 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 12,6 % par rapport à 2021.
Comme la moitié de la valeur de la production totale du Canada est exportée, la croissance du secteur repose sur des échanges prévisibles. Or, nous sommes confrontés à une vive concurrence de l’Union européenne, des États-Unis, du Brésil et de la Chine, entre autres.
Le gros des exportations agroalimentaires du Canada est allé aux États-Unis (59,0 %).
- Le Canada et les États‑Unis ont un solide partenariat agricole interrelié, qui a totalisé plus de 91 milliards de dollars en commerce bilatéral de produits agroalimentaires en 2022.
La Chine est le deuxième marché d’exportation de produits agroalimentaires du Canada depuis 2012 – nos exportations y ont augmenté de 5,8 % depuis l’année dernière.
Commerce agroalimentaire au Canada
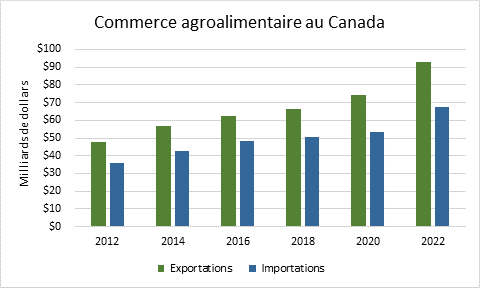
[Description de l’image ci-dessous]
De 2012 à 2022, les exportations et les importations de produits agroalimentaires se sont chiffrées en milliards de dollars. Le graphique montre que les exportations et les importations ont augmenté de façon constante depuis 2010, les exportations étant invariablement plus élevées que les importations.
Exportations Importations 2012 47,7 milliards de dollars 35,9 milliards de dollars 2014 56,5 milliards de dollars 42,9 milliards de dollars 2016 62,6 milliards de dollars 48,4 milliards de dollars 2018 66,3 milliards de dollars 50,3 milliards de dollars 2020 74,1 milliards de dollars 53,7 milliards de dollars 2022 92,7 milliards de dollars 67,3 milliards de dollars Répartition des exportations agroalimentaires du Canada selon les cinq principaux marchés en 2022

Source des données : Global Trade Tracker, fourni par Statistique Canada
[Description de l’image ci-dessous]
Diagramme circulaire montrant les exportations agroalimentaires destinés à divers pays sous forme de pourcentages. Les États-Unis constituent le plus important marché (59 %), suivi de la catégorie Autres (17 %), de la Chine (10,3 %), du Japon (5,8 %), de l’Union européenne, à l’exclusion du Royaume-Uni (4,8 %) et du Mexique (3,2 %).
Contexte commercial mondial
- La tendance mondiale à délaisser la prise de décisions fondées sur la science et le risque et l’adhésion au système commercial international fondé sur des règles à des fins protectionnistes créent des obstacles injustifiés pour les exportations canadiennes.
- Différends commerciaux; prolifération des barrières non tarifaires et nouvelles mesures protectionnistes menaçant le système commercial multilatéral.
- Émergence des technologies numériques et évolution des exigences des consommateurs en matière de transparence, de traçabilité et d’assurance de la durabilité, y compris la pression en faveur du rapatriement et de l’augmentation de la production nationale.
- Les priorités agroenvironnementales, les mesures incitatives et la réglementation constituent des défis et des possibilités au chapitre de la compétitivité du Canada.
- Maladies animales et végétales (influenza aviaire, peste porcine africaine [PPA]) et organismes nuisibles).
- Répercussions des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, des pressions inflationnistes et des situations géopolitiques (notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie).
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) préside un certain nombre de groupes de travail avec le secteur, afin de faire progresser la résolution des problèmes d’accès au marché et de commerce.
Boîte à outils pour le commerce agroalimentaire au Canada
AAC a recours à plusieurs outils pour faire avancer les objectifs du Canada, soit appuyer le système commercial fondé sur des règles, obtenir un accès préférentiel, surmonter les obstacles au commerce et joindre les acheteurs sur les principaux marchés.
Accords commerciaux et négociations
- Reconnaissance du Canada en tant que fournisseur mondial de choix et établissement de partenariats en matière de réglementation
- Accords et négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
- Mise en œuvre des accords de libre-échange (ALE) existants et négociation de nouveaux ALE régionaux/bilatéraux
- Règlement des différends
Collaboration avec des partenaires et des institutions
- Engagement bilatéral avec des partenaires de longue date afin de régler les enjeux commerciaux et de collaborer dans des domaines d’intérêts communs (à savoir la science, l’environnement)
- Participation à des forums multilatéraux
- Activités de coopération technique et de renforcement des capacités avec les partenaires afin de contribuer à l’amélioration des systèmes réglementaires et à l’établissement de relations commerciales fiables à long terme
Accès aux marchés et défense des intérêts du Canada
- Travaux techniques et stratégiques pour faire avancer et régler les problèmes d’accès aux marchés
- Efforts pour faire connaître la rigueur et la vigueur des pratiques exemplaires, des systèmes et des politiques du Canada en matière de sécurité alimentaire, de qualité et de durabilité sur le plan agricole.
Développement des marchés
- Initiatives ciblées pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes à saisir des occasions à l’échelle mondiale
- Outils et ressources de la marque Canada pour promouvoir le Canada comme un fournisseur de choix
Appuyer le système commercial multilatéral fondé sur des règles
AAC mobilise des partenaires commerciaux afin d’appuyer le commerce fondé des règles :
- Négociations de l’OMC sur l’agriculture
- Négociations constantes afin de poursuivre la réforme commerciale en agriculture et de réduire les subventions ayant des effets de distorsion.
- Accords de l’OMC et ALE – protection des engagements
- AAC préside les comités de l’agriculture chargés des ALE.
- Différends commerciaux
- AAC travaille avec Affaires mondiales Canada (AMC) pour défendre et faire avancer les intérêts du Canada dans les cas de différends commerciaux liés à l’agriculture.
AAC collabore avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) afin de préconiser des mesures fondées sur la science et sur le risque qui favorisent le commerce :
- Surveiller les tendances et les problèmes d’accès aux marchés
- Insister de façon multilatérale et bilatérale sur l’importance du commerce pour la salubrité des aliments, la croissance économique, la durabilité de l’environnement et un commerce ouvert et fondé sur la science
- Miser sur les mécanismes de mise en œuvre des ALE pour faire avancer des engagements ambitieux qui cherchent à éviter la mise en œuvre de mesures injustifiées ou inutiles
- L’ACIA participe aux activités des organismes internationaux de normalisation afin d’influer sur l’élaboration de politiques et de promouvoir l’adoption de normes fondées sur la science, de lignes directrices et de recommandations dans le but de faciliter le commerce.
Facteur essentiel au succès : Les accords de libre-échange (ALE) du Canada offrent un accès préférentiel aux principaux marchés de croissance
Le Canada a conclu 15 ALE bilatéraux et régionaux qui visent 51 pays, ce qui offre aux exportateurs canadiens un avantage concurrentiel dans les 2/3 de l’économie mondiale.
En 2022, 79,5 % des exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Canada étaient destinées à des pays signataires d’un ALE.
Les ALE peuvent être un élément important du plan de relance économique du Canada après la pandémie de COVID-19 Les ALE permettent au Canada de conserver et de garantir ce qui suit :
- Un commerce ouvert et fondé sur des règles
- Des chaînes d’approvisionnement diversifiées
- Un accès préférentiel aux marchés pour les produits agricoles canadiens
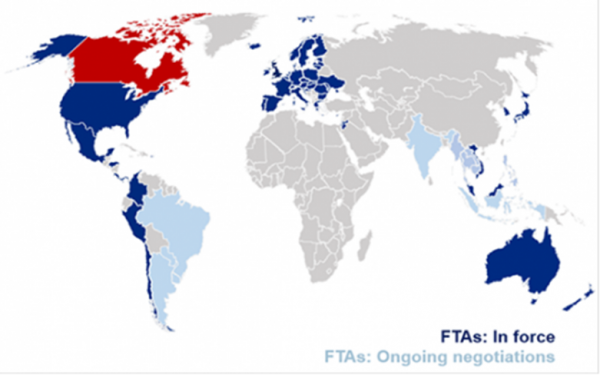
[Description de l’image ci-dessous]
Carte du monde montrant les endroits où des accords de libre-échange ont été établis avec le Canada et les endroits où des négociations sont en cours.
Nations avec lesquelles nous avons des ALE en vigueur : Australie, Brunéi, Chili, Colombie, Corée, Costa Rica, États-Unis, Honduras, Islande, Israël, Japon, Jordanie, Liechtenstein, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Pérou, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Ukraine, Union européenne, Vietnam.
Nations ou blocs commerciaux avec lesquels nous négocions des ALE : Royaume-Uni, Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay), Inde, Indonésie, Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Brunéi, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam).
Négociations d’ALE en cours
Inde, Indonésie et Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE).
Diversification des marchés : Miser sur les possibilités d’exportation et gérer le risque croissant
Les exportations canadiennes de produits agricoles, agroalimentaires et de la mer sont concentrées par marché et par produit. Les efforts de diversification des marchés ont pour but de diversifier les endroits où le Canada exporte des produits, les exportateurs et les produits exportés.
Accroître la part de marché
- Diversifier la gamme des exportations et accroître la part du marché dans des marchés établis.
- Marchés cibles : États-Unis, Union européenne, Japon.
Chercher de nouveaux débouchés
- Poursuivre la recherche de marchés émergents à forte croissance.
- Marché cible : région indo-pacifique.
Défendre les intérêts et gérer les risques
- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
- █████████████████████
La Stratégie pour l’Indo-Pacifique englobe cinq priorités clés touchant tous les secteurs de l’économie.
- Promouvoir la paix, la résilience et la sécurité
- Le Canada est un partenaire actif et engagé dans la région indo-pacifique
- Accroître le commerce, les investissements et la résilience de la chaîne d’approvisionnement
- Établir un futur durable et vert
- Investir dans les gens et les rapprocher
Objectifs
- Soutenir le développement économique durable dans la région et construire une économie nationale plus robuste et résiliente
- Assurer au Canada une croissance et une prospérité à long terme en renforçant et en diversifiant ses relations économiques avec les principales économies de la région indo-pacifique
Résultats prévus
- Élargissement du réseau commercial du Canada
- Renforcement de la réglementation du commerce
- Résilience des chaînes d’approvisionnement
Exemples d’investissements
- Portail commercial canadien en Asie du Sud-Est (24,1 millions de dollars)
- Missions commerciales modernes d’Équipe Canada (45,0 millions de dollars)
- Amélioration des programmes de CanExport (37,7 millions de dollars)
- Bureau de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour la région indo-pacifique (BAAIP) (31,8 millions de dollars)
Le Bureau de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour la région indo-pacifique contribuera à solidifier l’empreinte du Canada
Dans le cadre de la Stratégie pour l’Indo-Pacifique, le Canada mettra sur pied son premier Bureau de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour la région indo‑pacifique à Manille, aux Philippines. Les objectifs comprennent les suivants :
- Renforcer les partenariats avec les principaux partenaires
- Faire progresser la coopération technique et l’échange d’expertise
- Aider les entreprises canadiennes à découvrir de nouveaux débouchés et à diversifier leurs exportations
- Aider le Canada à devenir un fournisseur de choix dans la région
Développement des marchés
Puisque le mandat fédéral-provincial-territorial (FPT) est partagé, le développement des marchés mise sur les gains enregistrés dans l’accès aux marchés et les négociations des ALE pour aider les entreprises canadiennes à saisir les débouchés à l’échelle mondiale, ce qui comprend les initiatives suivantes :
- Information sur les marchés et ressources de renseignement (c’est-à-dire comptes rendus sur les possibilités qu’offrent les marchés d’exportation)
- Promouvoir les avantages des produits agricoles et alimentaires canadiens auprès des acheteurs et des consommateurs
- Activités sur place ciblées (par exemple, campagnes de promotion de la restauration et des ventes au détail; programmes de commerce interentreprises [B2B] virtuels et en personne, etc.)
- Salons professionnels du Pavillon du Canada
- Expertise sur place grâce au Service des délégués commerciaux
- Outils et ressources de promotion de la marque Canada
- Activités et matériel de préparation destinés aux exportateurs
Les activités fédéraux-provinciaux-territoriaux de développement des marchés permettent d’accroître la présence du secteur et son incidence dans les principaux marchés
Fonds de partenariat sur le marché
En 2022-2023, plus de 50 initiatives FPT de développement des marchés ont permis de soutenir 39 réunions interentreprises, salons professionnels secondaires et projets de commerce électronique, et 15 projets de promotion des services alimentaires et de promotion de la vente au détail.
Salons professionnels du Pavillon du Canada
Organisation de six salons professionnels phares qui ont appuyé 205 entreprises canadiennes et ont rassemblé 8 405 prospects. À la suite de leur participation, les entreprises ont déclaré des ventes sur place de 207 millions de dollars, et les ventes anticipées devraient atteindre 1,59 milliard de dollars au cours des 12 prochains mois.
Actualisation de la marque Canada
Lancement du programme actualisé de la marque Canada au sein de l’industrie; plus de 130 organisations inscrites à ce jour, et campagnes de commercialisation numérique et de commerce électronique d’une durée d’un an en cours au Vietnam et au Japon.
Analyse des marchés mondiaux
Soutien à l’industrie et aux provinces et aux territoires grâce à l’accès à des données et à des analyses relatives aux marchés.
Collaboration avec les partenaires fédéraux
Affaires mondiales Canada
AAC dispose de 40 équivalents temps plein (ETP), et l'ACIA compte 11 spécialistes techniques à l’étranger intégrés au Service des délégués commerciaux d’AMC; ils s’occupent en collaboration :
- Des renseignements sur les marchés
- De la promotion du commerce
- De l’accès aux marchés et des politiques commerciales
- Des investissements, de la science et de l’innovation
Agence canadienne d'inspection des aliments
- Organisme de réglementation canadien qui voit à la salubrité des aliments (avec Santé Canada), à la santé des animaux et à la protection des végétaux.
- Ses activités de réglementation permettent d’assurer la qualité des produits alimentaires, végétaux et animaux du Canada.
- Aide à promouvoir le programme de croissance des exportations grâce à ses activités liées à l’accès aux marchés. Par exemple, elle négocie et résout les questions techniques d’accès aux marchés avec ses homologues étrangers chargés de la réglementation, certifie les produits destinés à l’exportation, etc.
Autres ministères et organismes :
- Ministère des Pêches et des Océans
- Ministère des Finances
- Commission canadienne des grains
- Agences de développement régional (Agence de promotion économique du Canada atlantique, PrairiesCan, etc.)
- Agence des services frontaliers du Canada
- Santé Canada
Annexe A : Le Canada s’efforce de résoudre les problèmes d’accès aux marchés et de relever les défis en matière de politique commerciale sur des marchés clés
États-Unis
- Différend lié aux CT pour les produits laitiers fixés aux termes de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique
- Étiquetage volontaire des produits des États-Unis
- Proposition 12 de la Californie, Confinement des animaux d’élevage
- Galle verruqueuse de la pomme de terre à l’Île-du-Prince-Édouard
Union européenne
- Pacte vert de l’Union européenne/Stratégie « De la ferme à la table » (F2F) et l’importance que l’Union européenne accorde à la production durable et à l’environnement
- Obstacles non tarifaires au commerce (par exemple, réglementation sur les pesticides, les médicaments vétérinaires, l’étiquetage, la viande et les chaînes d’approvisionnement sans déforestation, entre autres)
Chine
- Encéphalopathie spongiforme bovine atypique
- Décrets 248/249 (enregistrement des entreprises important des produits alimentaires en Chine)
- Influenza aviaire hautement pathogène et aliments pour animaux de compagnie
- Retards au chapitre de l’approbation des installations et des produits
- ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████